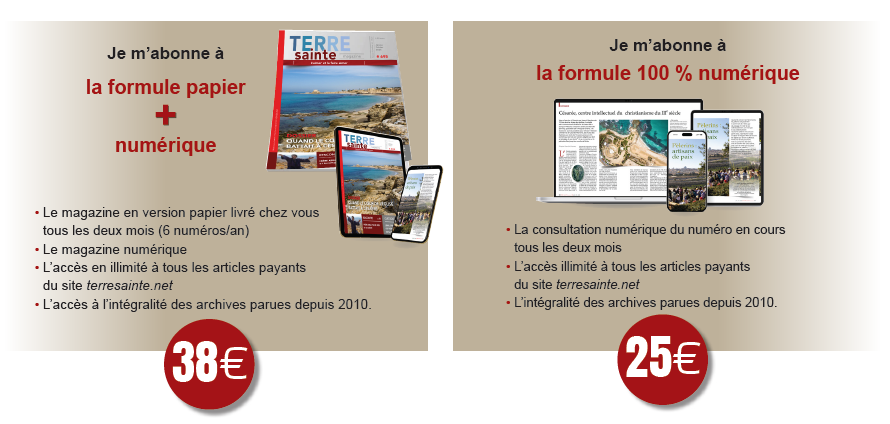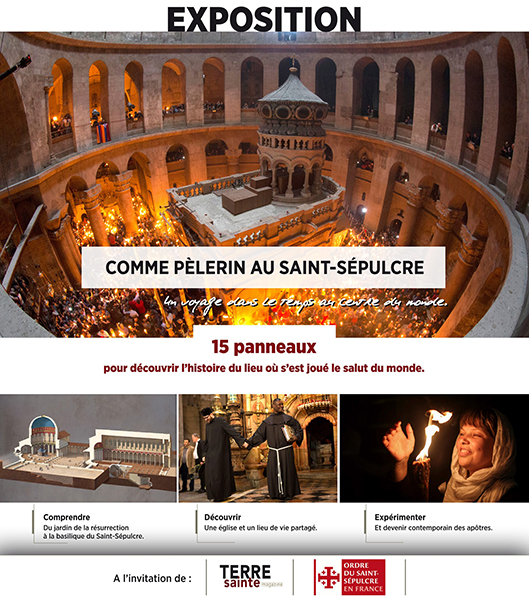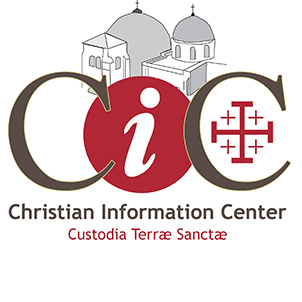Méditation spirituelle pour la paix. Intervention de Mgr William Shomali devant l'Assemblée plénière d'automne des évêques des France réunis à Lourdes - 9 novembre 2025.
L'intervention commence à 18'26" de la vidéo YouTube.
Bonjour à tous,
Avant de commencer ma méditation intitulée « Un regard chrétien sur la paix en Terre Sainte », je voudrais remercier le cardinal Aveline et le Conseil permanent pour m’avoir invité à participer à cette Assemblée plénière. Cela m’a permis de vivre une expérience de communion et de collégialité, et de mieux connaître l’Église de France, qui a toujours été missionnaire — et qui l’est encore.
Merci d’avoir consacré à la Terre Sainte votre après-midi et votre soirée d’hier, ainsi qu’une partie de cette matinée, et d’avoir voté un soutien concret à la Terre Sainte. Ce geste est profondément apprécié.
[Petite note pratique à propos des pèlerinages en Terre Sainte : si l’assurance ne peut être faite en France, elle peut l’être sur place, pour un coût modique. C’est une façon d’éviter certains dilemmes administratifs… Je voulais le dire hier, mais je n’avais pas le droit à la parole. Alors j’en profite aujourd’hui].
Depuis un siècle, la terre qui a vu naître le Prince de la paix est le théâtre d’un conflit ininterrompu.
Israéliens et Palestiniens — deux peuples liés par l’histoire, la géographie et un profond amour pour le même morceau de terre — affirment chacun leur désir de paix. Pourtant, cette paix demeure un mirage, une promesse sans cesse brisée par la vengeance et les revendications.
En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à regarder cette lutte insoluble avec les yeux de l’Évangile. Cette espérance n’est pas un vœu pieux, mais une vision exigeante, enracinée dans le travail ardu de la justice, la puissance transformatrice du pardon et soutenu par une prière fervente.
1. Le cri pour la paix et l’échec de la force
La soif de paix est authentique, dans le cœur des Israéliens comme des Palestiniens ordinaires. C’est le désir d’un parent de Sdérot d’élever ses enfants sans craindre les roquettes ; l’espoir d’une famille de Gaza de vivre dans la dignité, libérée du blocus et des bombardements ; l’aspiration d’un jeune de Cisjordanie à un avenir sans checkpoints ; le souhait d’un Israélien d’une sécurité si profonde qu’elle n’aurait plus besoin d’être prouvée par la force.
Mais la voie de la militarisation et des représailles n’a fait qu’aggraver les blessures, semant les fruits de la haine que les générations successives récoltent. Il faut le dire sans équivoque : la voie de la force n’a pas apporté la sécurité. Elle n’a fait que garantir le prochain cycle de violence.
2. Les récits opposés
Comprendre ce conflit, c’est reconnaître qu’il s’agit d’une lutte entre deux récits puissants et mutuellement exclusifs.
Pour le peuple juif, la terre d’Israël est l’accomplissement d’une promesse divine, c’est la patrie retrouvée après des siècles d’exil et de persécutions culminant dans la Shoah. L’État d’Israël n’est pas qu’un projet politique : il est pour beaucoup un témoignage de la survie juive, un havre de paix, et pour certains juifs messianiques un accomplissement prophétique. La mémoire d’avoir frôlé l’anéantissement fait de la sécurité la pierre angulaire non négociable de l’existence nationale israélienne.
Pour le peuple palestinien, cette même terre est la Palestine, leur patrie ancestrale, ou ils ont vécu durant des générations. La création d’Israël en 1948 fut la Nakba, une perte immense, une dépossession et d’exil, éléments fondateurs de leur identité.
Pour les chrétiens palestiniens, ce lien est doublement profond. Ils se voient comme les descendants des premières communautés chrétiennes, les gardiens fidèles des lieux saints depuis deux millénaires. De ce point de vue, Israël est souvent perçu comme un projet de colonisation.
Ce conflit semble insoluble car chacun perçoit l’autre comme une menace existentielle. Quand la survie même paraît en jeu, le compromis devient un suicide, et le dialogue devient impossible.
Sortir de cette impasse, de ce cercle vicieux, nécessite un changement d’esprit radical : passer du « je dois gagner » à « comment pouvons-nous vivre tous deux en sécurité et en justice ? ». Cela ne peut pas être atteint par les armes qui ne font que renforcer les craintes des deux côtés, mais cela nécessite une percée morale et spirituelle.
3. Les conditions fondamentales d’une paix juste et durable
Pour que la paix passe du rêve à la réalité, certaines conditions sont indispensables.
D’abord, l’honnêteté et la bonne intention. Les dirigeants des deux côtés doivent vouloir la paix plus que la terre, ou la victoire ou leur survie politique. Ils doivent avoir le courage de dire à leur propre peuple les dures vérités sur les compromis nécessaires à la coexsitence.
Ensuite, la reconnaissance de la souffrance de l’autre et de son droit à vivre en dignité.
Les Israéliens doivent entendre la douleur de la Nakba, l’humiliation de l’occupation et le désespoir d’un peuple privé de droits fondamentaux.
Les Palestiniens doivent comprendre la terreur existentielle que la Shoah et l’antisémitisme vécu durant des génération ont gravée dans l’âme juive.
Troisièmement, la communauté internationale doit jouer un rôle crucial et impartial et appliqué, en mettant en œuvre les résolutions de l’ONU qui ont tracé des voies claires longtemps ignorées et écrasées par le veto d’une super puissance.
Enfin, la solution à deux États demeure le cadre le plus réaliste : basée sur les frontières de 1967, avec des échanges de territoires mutuellement convenus, Jérusalem partagée comme capitale des deux États, une solution juste pour les réfugiés palestiniens, et des garanties de sécurité pleines et entières pour Israël. Ce n’est pas une idée radicale, c’est le cadre endossé internationalement qui reconnait les aspirations nationales, légitimes des deux peuples.
4. Les piliers spirituels de la paix
Les accords politiques sont fragiles. Seule une transformation spirituelle peut rendre la paix durable.
- Le respect est le point de départ : reconnaître l’autre non comme un démons mais comme un être créé à l’image de Dieu, ayant le droit de vivre et d’être libre.
- Le pardon est la contribution la plus radicale et distinctement chrétienne dans ce processus. Il ne s’agit pas d’oublier les torts commis ni un déni de justice, c’est plutôt la décision consciente et volontaire de renoncer au droit à la vengeance. C’est le refus de laisser le passé à jamais empoisonner l’avenir. Le pardon brise le cycle sans fin des représailles.
- La réconciliation est le but ultime et la restauration de la relation. C’est le parcours qui mène d’anciens ennemis à devenir voisins et peut-être même un jour en partenaires. Cela ne signifie pas une amitié superficielle mais un engagement mutuel envers un bien commun, où le bien être de l’un est compris comme étant lié au bien être de l’autre.
5. La preuve que la paix est possible, prenons des leçons de l’histoire
Le scepticisme est compréhensible mais l’histoire nous enseigne que les ennemis d’hier les pus acharnés peuvent choisir une voie différente.
La réconciliation franco-allemande, la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, l’accord du Vendredi Saint en Irlande du Nord (il y a des ressemblances avec notre conflit car il y avait un arrière-fond religieux), ou encore la paix entre Israël, l’Égypte et la Jordanie — toutes ces expériences montrent que la paix, même froide, peut tenir.
Mais chaque fois, elle a coûté cher. Sadate et Rabin ont payé de leur vie cette audace. Il faut toujours un sacrifice pour qu’advienne une résurrection.
6. Les ennemis de la paix
Les ennemis de la paix sont nombreux : l’injustice, l’orgueil, la haine, les préjugés, la manipulation de la religion.
À cela s’ajoutent les intérêts géopolitiques et économiques. De puissants intérêts économiques et stratégiques prospèrent souvent du commerce des armes. La prolifération des armes fait de la violence un but.
Il y a aussi l’exploitation de l’identité religieuses qui est un obstacle particulièrement pernicieux. Quand Dieu est enrôlé comme partisan dans le conflit, la lutte devient « guerre sainte », faisant passer le compromis pour une hérésie.
La religion qui devrait être une source de compassion devient une arme pour durcir les idéologies et justifier l’atrocité. Chez Hamas, quand quelqu’un meurt, il est appelé martyre et il va au ciel tout de suite. Donc c’est un encouragement à faire la bataille, même à mourir parce qu’on devient martyre. Quant aux intérêts matériels, ils sont forts. J’en mentionnerai deux : n’oublions pas qu’il y a beaucoup de gaz à Gaza qui vaut des milliards de dollars.
Je me rappelle de Netanyahu, quand on a découvert du gaz dans la mer, il a dit « ; « Dieu a donné à Moïse non pas seulement une terre où coule le lieu et le miel, mais il a donné à Moïse une terre où coule le lait, le miel et le gaz ».
Mais il y a aussi la possibilité d’ouvrir un canal parallèle au canal de Suez, entre la Méditerranée et la mer Rouge et qui s’appellerait le canal de Ben Gourion. Tous les plans [israéliens] sont prêts.
7. La prière et l’unité des chrétiens
Face à ces défis, la prière est essentielle.
Prier, c’est s’engager dans le combat spirituel contre la haine et le désespoir. Nous prions d’abord pour que la sagesse illumine les dirigeants politiques.
Nous prions pour l’intervention divine pour adoucir les cœurs endurcis, pour ouvrir les yeux aveuglés par l’idéologie et pour créer des opportunités de dialogue là où il semble n’en exister aucune. Nous prions aussi pour les victimes, les traumatisés, les endeuillés et les otages.
Nous prions pour les artisans de paix sur le terrain israéliens et palestiniens et ils sont nombreux qui risquent leur sécurité et leur réputation pour construire des ponts. Et il en existe dans les deux camps. [Durant votre dernière visite, Monseigneur, vous avez rencontré des Palestiniens et des Israéliens qui vraiment désirent sincèrement la paix].
De plus, il est impératif que les chrétiens du monde entier unifient leur position. Aujourd’hui, le monde chrétien est polarisé : certains soutiennent sans réserve la politique israélienne au nom du sionisme chrétien, d’autres défendent la cause palestinienne jusqu’à justifier la violence.
Cette division est un scandale qui affaiblit notre témoignage. Nous devons trouver une voie unifiée qui défende la valeur de toute vie humaine, israélienne comme palestinienne, qui condamne l’injustice et la violence d’où qu’elles viennent, et qui proclament l’Évangile de la paix comme la seule alternative véritablement porteuse d’espérance. Cette unité doit se refléter dans notre engagement commun pour une paix juste pour les tous les enfants d’Abraham en Terre Sainte.
Conclusion
La voie vers la paix en Terre Sainte est étroite et semée d’échecs. Elle coûtera beaucoup aux deux peuples.
Elle exigera des Israéliens qu’ils risquent leur sécurité parfaite pour une paix qui est par nature incertaine.
Elle exigera des Palestiniens qu’ils renoncent au rêve d’un rapatriement total et qu’ils acceptent un état démilitarisé plus petit que leur patrie historique.
Mais le coût d’un conflit contenu est immensément plus élevé. Plus d’enfants morts, plus de familles brisées, plus d’âmes rongées par la haine.
La voie de la croix nous enseigne que la rédemption vient par le sacrifice. Le sacrifice exigé aujourd’hui n’est pas de sang, mais d’orgueil, de récits historiques, d’idolâtrie de la terre et de la sécurité au détriment du commandement d’aimer notre prochain.
Prions pour qu’un jour, du fleuve jusqu’à la mer, ce ne soit plus un cri de guerre mais un chant de réconciliation. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées de tous et de tous ceux qui appellent la terre sainte leur foyer. Merci.
Mgr William Shomali est un évêque catholique Palestinien, membre du Patriarcat latin de Jérusalem. Né en 1950 à Beit Sahour, près de Bethléem, il a été ordonné prêtre en 1972. Docteur en littérature anglaise et ancien recteur du séminaire du Patriarcat à Beit Jala, il a occupé plusieurs fonctions clés : chancelier du Patriarcat, évêque auxiliaire de Jérusalem puis vicaire patriarcal pour la Jordanie, et aujourd’hui pour Jérusalem et la Palestine.
Figure respectée du clergé local, il est connu pour sa finesse diplomatique, sa fidélité à la Terre Sainte et son engagement pour le dialogue interreligieux et la paix.
Vous vous intéressez à la Terre Sainte et ses habitants
alors abonnez-vous à Terre Sainte Magazine !