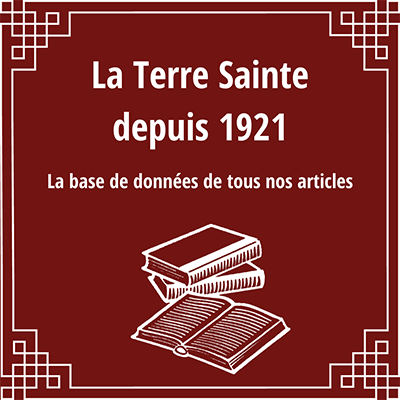Kassam Maaddi a 27 ans, il est né dans le sud de la Colombie d’un père Palestinien et d’une mère colombienne. En 1995, il a alors 7 ans, ses parents décident de quitter l’Amérique latine pour s’installer en Palestine. Depuis, Kassam œuvre à son échelle pour son pays, décidé à construire.
1995. Deux ans après les accords d’Oslo. Yitshak Rabin et Yasser Arafat se sont serré la main sous le regard bienveillant de Bill Clinton sur les pelouses de la Maison Blanche. Le monde croit la paix arrivée entre Palestiniens et Israéliens. Le père de Kassam aussi qui vivait loin de sa Palestine natale depuis 25 ans.
C’est dans cette atmosphère que Kassam a grandi à Taybeh. “Le village ne ressemblait pas au Taybeh d’aujourd’hui, commente Kassam. Il était beaucoup plus rural et encore très marqué par la première intifada (le soulèvement palestinien qui dura de 1987 à 1993 NDLR). L’économie était en plein essor et nous y avons grandi, mon frère Fouad et moi, dans le souvenir des histoires de la Première intifada et de toute la mythologie familiale.”
Lire aussi >> Kassam: « Le manque d’ouverture asphyxie la présence chrétienne en Terre Sainte »
Mais las, Oslo capote et les Palestiniens reprennent le chemin de la révolte. La deuxième intifada éclate en l’an 2000. Kassam a 13 ans. Toute la Cisjordanie s’enflamme et en 2002, les parents de Kassam préfèrent repartir pour les États-Unis. Mais ni Kassam ni son frère ne parviennent plus à s’habituer à l’adolescence américaine. “Nous étions partis en pleine intifada de laquelle nous étions partie prenante. Au village, nous organisions des manifestations sur la place. Pour nous, c’était toute une aventure.”
Cette conscience politique précoce Kassam l’explique ainsi : “Ici, au moment de se coucher, on ne nous raconte pas l’histoire des trois petits cochons. On nous parle des oliviers du grand-père, on nous raconte la première intifada. On grandit avec une mythologie palestinienne et c’est lourd, c’est très lourd. Quand on en prend conscience, cela devient un fardeau et on s’interroge : “On nous a transmis tout ça mais pour en faire quoi ?””.
Un champ de bataille
Pourtant, une partie de la réponse est née chez Kassam dès ce nouveau retour en Palestine fin 2003. Témoin des événements et spectateur des informations télévisées, naissait en lui une vocation de journaliste. “Il faut travailler à donner une image plus réaliste de notre situation. La communication est aussi un champ de bataille.”
Son penchant naturel pour l’écriture, il va l’enrichir de solitudes études en Sciences Politiques. Tout d’abord au campus décentralisé de Menton en France, puis dans le même domaine à Birzeit, l’Université de Ramallah. Un parcours qu’il parachève en 2014 avec l’obtention d’un Master 2 en journalisme à Strasbourg (France).
Pourtant, son rêve de devenir journaliste en Palestine n’est pas encore atteint. Kassam n’a pas encore trouvé d’emploi dans son domaine dans son pays. “La facilité serait de partir. Comme tout bon Palestinien, dit-il en souriant, j’ai de la famille à peu près partout dans le monde. J’aurais plus d’opportunités dans le journalisme dans les pays du Golfe, aux États-Unis ou en Colombie.” Mais quiconque a déjà croisé le regard de Kassam sait qu’il n’est pas homme à choisir la facilité.
Lire aussi >> La jeunesse palestinienne à la recherche d’une nouvelle culture politique
“Mes convictions, ma conception de la vie, ce que je veux vraiment, c’est rester ici. En grandissant ici, on comprend qu’on ne vit pas que pour soi et il y a une part de soi qui revient à ce pays. Cette part a écrit en moi une identité plus importante que celle qui figure sur ma carte d’identité.”
“Aujourd’hui plus que jamais, ce pays a besoin de professionnels qui restent et qui travaillent à le construire. Cette construction est plus que jamais nécessaire. Voilà des années que la société se déchire, que les gens compétents s’expatrient. Si on veut être sincère avec soi lorsqu’on dit qu’on est palestinien et engagé, alors il faut travailler à bâtir cette société ici, en étant sur le terrain.” Le ton de Kassam a changé. Une énergie incroyable l’anime qu’il contient par politesse.
Être chrétien, cela change-t-il quelque chose dans ce désir de construire la société palestinienne dans la situation actuelle ? “Ça ne change pas qualitativement mais c’est la motivation qui est décuplée. Être palestinien suffirait à me motiver, être chrétien c’est en plus. J’ai été élevé proche du milieu de l’Église, et l’on m’a dispensé un enseignement chrétien assez engagé et l’on nous a enseigné, à ma génération, à être chrétien et palestinien à la fois. En voyant comment les choses évoluent ou “dévoluent” aujourd’hui au Moyen-Orient, il est d’autant plus important que les chrétiens portent un témoignage plus fort et qu’ils fassent davantage encore sentir leur présence.”
J’ai confiance
Est-ce plus difficile aujourd’hui d’être chrétien dans la société palestinienne actuelle ? Il n’y a pas d’hésitation chez Kassam quand il répond. “Non. Je suis conscient que ce n’est pas la réponse que tous les chrétiens donneraient, mais personnellement, je n’ai jamais rencontré d’obstacle dans le champ professionnel ou dans la société du fait que je suis chrétien au contraire. Parfois cela suscite la curiosité de certains amis qui n’ont jamais rencontré un chrétien. Parfois même, cela peut tourner à ton avantage. Si je disais : “C’est parce que je suis chrétien que je suis traité comme ça” alors on ferait tout pour me montrer qu’il n’y a pas de discrimination.”
Bien qu’il s’investisse de tout cœur dans l’emploi qu’il a trouvé au bureau de la Caritas à Ramallah, on sent que, ne pas faire le métier de ses rêves, donne à Kassam un sentiment d’incomplétude. Il n’y a pas des moments ou tu regrettes ton choix ? Il respire profondément. “Non. Depuis que je suis rentré de France et après la dernière guerre de Gaza (été 2014), je me suis interrogé, j’ai révisé ma position. J’ai confiance, c’est ce que je veux. Je manquerais à moi-même si je partais ailleurs.” Kassam se détend, il sourit. C’est ça. Il sait. “Il faut comprendre, la Palestine c’est plus qu’un simple endroit.”
Dernière mise à jour: 19/11/2023 21:53