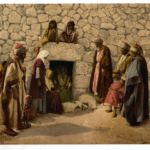À Béthanie, le souvenir de Lazare n’a cessé de façonner les paysages spirituels, architecturaux et sociaux de ce village à l’est de Jérusalem. Au fil des siècles, églises et monastères se succèdent sur le site où, selon l’Évangile, Jésus ressuscita son ami.
Dans un an ou deux, les pèlerins qui se rendent à Al-‘Azariya, le village de Lazare en arabe, la Béthanie des évangiles, pourront découvrir de nouveaux aspects du site. L’ONG de la Custodie, Pro Terra Sancta, en collaboration avec la municipalité de Béthanie, l’université al-Quds et le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités, met la dernière main à 10 ans de travaux de conservation et de valorisation du centre historique de la ville.(1)
Les amateurs d’archéologie et d’Histoire seront comblés en découvrant la richesse d’un site qui ne demandait qu’à se révéler.

Certes, les premières fouilles archéologiques du complexe ecclésiastique situé au-dessus et autour de la tombe vénérée pour être celle d’où Lazare, à l’appel de Jésus fut ressuscité, ont été menées par l’archéologue franciscain frère Sylvester Saller entre 1949 et 1953. Les travaux de restauration et de valorisation réalisés ces dernières années ont permis d’approfondir certains aspects, en particulier le lien entre les premières églises byzantines et croisées et la tombe.
Les premières basiliques et la mémoire sacrée
Le souvenir d’une première église, construite avant 390, nous est transmis par saint Jérôme. Cette basilique à trois nefs était typique des édifices paléochrétiens, avec un atrium séparant le bâtiment du tombeau de Lazare — conservant ainsi, à l’extérieur, le lieu de mémoire sacrée. L’église, sans doute victime d’un séisme, fut reconstruite au VIe siècle, selon un plan similaire mais déplacée vers l’est pour mieux accueillir les fidèles, surtout lors des célébrations de la Semaine sainte.

Cette deuxième église a été décrite par Arculfe, évêque gaulois en pèlerinage vers 680, qui mentionne une grande basilique flanquée d’un monastère. Des mosaïques plus modestes que celles du premier édifice ornaient le sol, et l’architecture recourait à des piliers massifs et des voûtes en coupole. Des peintures et croix gravées sur les murs ont été identifiées, certaines protégées par des contreforts postérieurs.
Mélisende, Yvette et la splendeur monastique
Avec l’arrivée des Croisés en Terre Sainte, Béthanie reprit une importance stratégique et spirituelle. En 1138 la reine Mélisende, souveraine de Jérusalem, acquit le site de la tombe de Lazare auprès des chanoines du Saint-Sépulcre. Elle y restaura l’église et fonda un monastère bénédictin pour sa sœur Yvette, qui en fut l’abbesse. Cette communauté féminine devint l’un des centres monastiques les plus prestigieux du Royaume croisé.
Le couvent bénéficiait de revenus importants, notamment des dîmes de l’oasis de Jéricho, et d’un patrimoine liturgique précieux : calices, croix en or et argent, ornements d’autel. Il accueillait aussi les jeunes filles nobles, comme la future reine Sibylle. Pour assurer la sécurité du site, Mélisende fit bâtir une tour fortifiée, à l’orée du désert, dont on peut voir les vestiges.
Les fouilles entreprises au XXe siècle, complétées entre 2017 et 2022, ont mis au jour une partie du cloître, des salles voûtées, un escalier menant à la tombe, ainsi que des chapiteaux figurés de qualité exceptionnelle, témoins du raffinement architectural du lieu.
De la conquête musulmane à la destruction du monastère
L’occupation musulmane de la région, amorcée en 638, n’interrompit pas l’activité chrétienne à Béthanie. Bernard, moine bénédictin, observe encore en 870 un monastère vivant. Al-Ya‘qūbī et al-Idrīsī, géographes arabes des IXe et XIIe siècles, évoquent le miracle de la résurrection de Lazare, qu’ils identifient à un certain ‘Āzir.
Mais après la chute du Royaume croisé en 1187, Saladin prend le contrôle de la région.
Il ordonne la destruction du monastère et de ses tours défensives, épargnant toutefois les deux églises médiévales. Dès le XIIIe siècle, les récits de pèlerins décrivent une situation dégradée : la troisième église est transformée en étable, la quatrième est réduite à sa crypte.

La mémoire chrétienne survit cependant dans les pèlerinages. En 1289 le dominicain Riccoldo de Monte Croce visite encore le tombeau. En 1384 le Florentin Frescobaldi note que l’église est devenue mosquée. À partir du XVe siècle la figure évangélique de Lazare commence à se fondre dans celle du prophète coranique ‘Uzayr (Esdras). En 1496 Mujīr al-Dīn, chroniqueur de Jérusalem, mentionne que la tombe, désormais un maqām islamique, est celle d’un prophète ressuscité, assimilé à ‘Uzayr. Cette tradition s’impose progressivement, au point d’effacer presque entièrement Lazare dans la mémoire islamique locale.
Les franciscains à Béthanie : gardiens de la mémoire
C’est dans ce contexte de recul chrétien que les franciscains, installés en Terre Sainte depuis le XIIIe siècle, entrent en scène. Vers 1485 le frère mineur Francesco Suriano témoigne que les franciscains détiennent les clés de la tombe de Lazare, alors vénérée par les chrétiens et les musulmans.
Un acte juridique (hogget) daté de 1499 confirme un accord entre le custode de Terre Sainte, Bartolomeo da Piacenza, et le gardien musulman de la tombe, Schiamali Katamani. Ce dernier remet une clé aux franciscains, leur permettant d’y célébrer leurs offices selon l’antique tradition.
En 1574 une étape cruciale est franchie. Le cadi (juge musulman) autorise les franciscains à ouvrir une nouvelle entrée vers la tombe, côté nord, et à en garder les clés. L’entrée d’origine, désormais intégrée à la mosquée, est murée. L’indépendance d’accès au site devient un droit reconnu.

Des témoignages du XVIe siècle renforcent cette image de cohabitation tolérée mais vigilante. Giovanni Zuallardo décrit en 1586 les vestiges du site comme un château devenu mosquée.
Il rapporte que le gardien franciscain a retrouvé un ancien escalier menant à la tombe. Jan van Cootwijk ajoute, lui en 1598, qu’un paiement est exigé pour accéder au sanctuaire et que l’entrée chrétienne, souterraine, est distincte de l’accès musulman.
Déclin, renaissance et reconstruction
Alors que les bâtiments chrétiens tombent lentement en ruine, la mosquée est agrandie. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu’un nouvel essor chrétien émerge. Les franciscains, comme les grecs-orthodoxes, se lancent dans une campagne d’achats fonciers autour du tombeau de Lazare.
Cette nouvelle présence aboutit à deux réalisations majeures : l’église franciscaine Saint-Lazare, consacrée en 1954, et l’église orthodoxe, érigée en 1965. La latine est l’œuvre de l’architecte italien Antonio Barluzzi, célèbre pour ses constructions en Terre Sainte. Le sanctuaire est implanté sur les vestiges des trois premières églises, unissant ainsi la mémoire des siècles passés à une vocation pastorale renouvelée.
Aujourd’hui, l’église franciscaine est le centre de la présence chrétienne à Béthanie. Chaque année, elle accueille des pèlerins venus commémorer la Résurrection de Lazare. La Custodie franciscaine en assure la garde et l’animation liturgique.
Un héritage partagé
Le site de Béthanie reste emblématique du chevauchement entre mémoire chrétienne et foi musulmane. Le maqām musulman, désormais identifié à ‘Uzayr, cohabite avec le sanctuaire franciscain. Deux narrations, deux traditions, mais une même tombe de pierre comme point de convergence.
En gardant vivante la présence chrétienne sur ce lieu sacré, les franciscains continuent d’inscrire leur mission dans le sillage de saint François : être témoins de paix, de dialogue et de fidélité à l’Évangile au cœur de la Terre Sainte.t
- Publié dans Scavi al tempo del Covid nella tomba di Lazzaro a Betania, Publié dans Giornate di Archeologia, Arte e storia del Vicino e Medio Oriente Atti della VII edizione – Milano, 21-23 ottobre 2021 © 2022 Fondazione Terra Santa – TS Edizioni – Milano