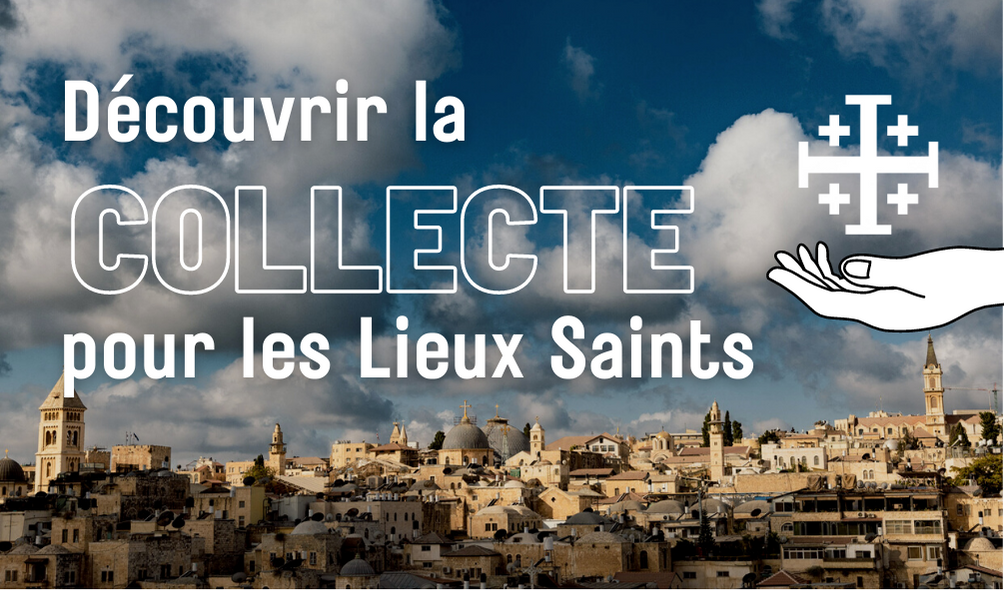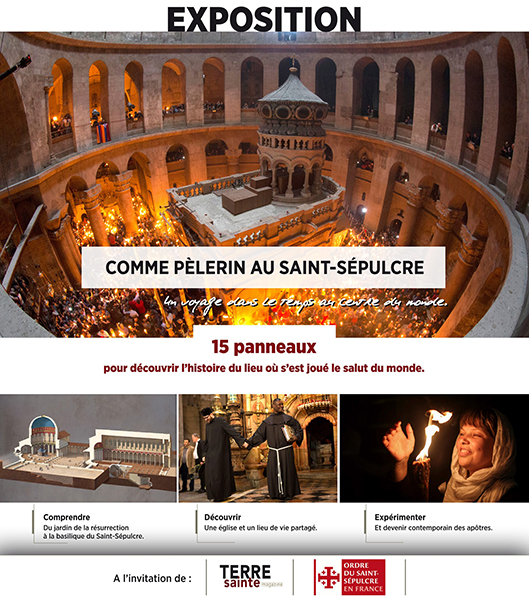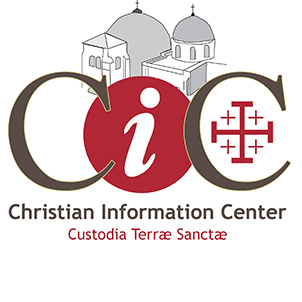Karma Ben Johanan: « Juifs et chrétiens, nos raisons d’entrer en dialogue ne sont pas les mêmes »
Devant la flambée d’antisémitisme qui s’empara du monde dès qu’Israël entreprit ses représailles après les massacres du 7-Octobre, Karma Ben Johanan, qui porte depuis Israël un regard novateur sur le dialogue entre juifs et catholiques, écrivit au pape. Elle lui disait que l’esprit de Nostra Ætate était en danger. Avec elle, nous évaluons les difficultés rencontrées “à notre époque” dans le dialogue depuis deux ans.
L’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a bouleversé le monde juif. Comment cela a-t-il affecté le dialogue judéo-chrétien ?
Avant ce jour, le dialogue judéo-chrétien avait fait des progrès significatifs au cours des six dernières décennies, en particulier au sein de l’Église catholique. Bien que, sur le terrain, de nombreuses communautés catholiques à travers le monde nourrissent encore des préjugés envers les juifs et le judaïsme, le magistère de l’Église et les intellectuels catholiques ont entrepris un profond réexamen de la position de l’Église à leur égard. Un nouveau champ d’études judéo-chrétiennes a ainsi émergé – principalement universitaire, mais ayant contribué à façonner la compréhension du grand public. La réaction de la communauté juive à ces efforts est cependant restée mitigée : tantôt hésitante ou résistante, tantôt ouverte et engagée.
Lire aussi → “Nous devons prendre les juifs comme ils sont” – TSM 665
Puis le 7-Octobre est arrivé, et ce fut un tremblement de terre pour la communauté juive du monde entier. Pour de nombreux juifs, cela avait les accents d’un passé traumatisant. Les promesses du sionisme et de la démocratie libérale semblaient être brisées et l’ancien statu quo ne s’appliquait plus. Il y a eu une montée de l’antisémitisme et l’expérience de la victimisation – que le sionisme avait essayé de surmonter – a refait surface.
Quelle a été la réaction catholique de votre point de vue ?
Dans l’Église, le changement a également été notable. La montée du nationalisme israélien et le déclin du libéralisme en Israël ont rendu plus difficile, pour de nombreux catholiques, de réconcilier leurs valeurs avec celles d’Israël. L’Église s’était investie dans la création d’un espace libéral et démocratique où le dialogue entre juifs et chrétiens pourrait s’épanouir. Mais en dehors du cocon protecteur de l’Europe libérale, et compte tenu des réalités actuelles, maintenir cette vision est devenu beaucoup plus difficile.
La polarisation qui s’est intensifiée depuis le 7-Octobre a rendu plus difficile pour les juifs et pour les chrétiens de comprendre les positions des uns et des autres. D’un côté, les juifs étaient confrontés à une division croissante au sein de leur communauté, et de l’autre, l’Église avait du mal à faire face aux complexités de la situation.
Quelle est la nature de ces complexités qui échapperait aux catholiques ?
Notre société israélienne est complexe et contradictoire. On y trouve un mélange de pouvoir et de vulnérabilité. Il n’est pas facile de concilier ces éléments. La question est de savoir comment maintenir les valeurs morales pendant la guerre, tout en reconnaissant les menaces auxquelles Israël est confronté — non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi de la polarisation interne — alors que le pays évolue de manière à remettre en question son identité même.
Les évolutions de la société israélienne changent-elles les paramètres du dialogue ?
Elles le compliquent alors que nous faisons face à un changement culturel. Les institutions impliquées dans le dialogue ont été construites pour la plupart sur les bases posées par Nostra Ætate, mais aujourd’hui, il y a un décalage. En Israël, le dialogue officiel s’est principalement déroulé avec le Grand rabbinat, qui occupe une position contestée au sein de la société. Beaucoup de choses se passent en dehors de ces cadres institutionnels.
Les sionistes religieux d’Israël, en particulier ceux qui s’intéressent à la théologie, s’engagent avec les représentants catholiques d’une manière qui n’est pas publique ou tape-à-l’œil. Leur intérêt est sincère : ils souhaitent en apprendre davantage sur la théologie chrétienne, notamment sur les questions de laïcité et les approches chrétiennes des relations entre religion et politique.
D’un autre côté les juifs laïcs (1) se sentent souvent exclus du dialogue parce que l’Église a tendance à se concentrer sur les juifs religieux. Il y a une gêne pour les juifs laïcs parce que l’Église considère le judaïsme comme une religion, et les juifs laïcs ne se sentent pas représentés dans ce contexte.
Lire aussi notre dossier → Antijudaïsme Antisémitisme Antisionisme même lutte ?
Finalement, l’Église cherche à s’adresser aux juifs orthodoxes, car ils représentent en quelque sorte le judaïsme authentique, alors qu’ils peuvent se montrer très intolérants voire anti-libéraux. Et ceux qui ont le plus soif de dialogue, qui veulent s’intéresser à l’art, à la musique chrétienne et en comprendre l’essence sont négligés.
Il y a une asymétrie structurelle dans le dialogue judéo-chrétien qu’il est important de comprendre. Les raisons pour lesquelles les juifs s’engagent dans le dialogue sont différentes des raisons pour lesquelles les chrétiens le font. Les dangers ou les menaces auxquels chaque partie est confrontée sont également différents. Cette asymétrie ne signifie pas que le dialogue est impossible, mais elle le rend plus compliqué et plein de défis.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette asymétrie ?
Elle vient du fait que les juifs, même en Israël où ils sont majoritaires, ont besoin de protéger leur identité des pressions extérieures. Le christianisme, lui, a toujours été plus ouvert à l’absorption d’éléments d’autres cultures. Pour les juifs, emprunter à d’autres cultures ou traditions, en particulier au christianisme, peut être considéré comme une menace pour leur identité.
Les juifs d’Europe ont forgé leur identité dans le contexte de l’Europe occidentale. Cela facilite le dialogue interreligieux parce que les termes sont plus ou moins convenus. En Israël, c’est beaucoup plus complexe parce que la religion, la politique et l’appartenance ethnique sont toutes profondément liées.
Comment voyez-vous l’avenir du dialogue judéo-chrétien ?
On pourrait mentionner que la mondialisation de l’Église est un immense défi pour le dialogue judéo-chrétien car le principal investissement dans le dialogue judéo-chrétien a été un investissement occidental en raison des événements en Europe.
Mais, d’un point de vue juif, la première pierre d’achoppement est que les chrétiens ont tendance à parler de spiritualité, de religiosité et de théologie, et finalement ratent parfois la cible. Et quand les juifs parlent de leur lien avec la terre ou de leur lutte contre l’antisémitisme, les chrétiens ne comprennent parfois pas pourquoi ces questions historiques et politiques sont toujours au centre de l’attention. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement parler de théologie ? Cette asymétrie est toujours présente.
Lire aussi → La théologie catholique a des angles morts dans son rapport au judaïsme
D’un point de vue juif, vous ne pouvez pas séparer la religiosité des aspects historiques et politiques des relations judéo-chrétiennes. L’idée que les juifs vivent dans la diaspora, souvent au sein de la chrétienté, a des sous-entendus politiques qu’il est impossible d’ignorer. Cette relation entre juifs et chrétiens a toujours été politique, théologique et profondément liée à l’Histoire. Donc, dans le dialogue, vous devez être conscients de cette complexité.
Les postulats du dialogue font partie du dialogue, et ils ne seront jamais harmonieux. Il y aura toujours des clashs d’une manière ou d’une autre, mais c’est ce qui rend le dialogue si intéressant. Malgré les affrontements, nous apprenons toujours les uns des autres.
Qu’en est-il lorsque le patriarche Pizzaballa parle de la situation actuelle, pensez-vous que ses paroles attaquent le judaïsme ?
Non, absolument pas. Je crois que le patriarche Pizzaballa est un parfait exemple de quelqu’un qui comprend la complexité des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Je ne l’ai jamais trouvé partial – et je ne l’envie pas. Il doit naviguer dans des circonstances extrêmement délicates et polarisées. Cela dit, plus la guerre s’éternisait, plus il devenait difficile pour les gens de s’identifier au camp israélien. D’une part, cela se comprend compte tenu des horreurs de la guerre et des pertes humaines considérables à Gaza. D’autre part, les problèmes d’Israël n’ont pas disparu et le Hamas, toujours clandestin, a joué un jeu très sale, cherchant à maximiser le nombre de morts palestiniens pour gagner des points dans la bataille de l’opinion publique.
Ce qui est plus troublant, cependant, c’est le manque de contact direct entre les juifs israéliens et les chrétiens arabes locaux. Il nous est relativement facile d’engager le dialogue avec les chrétiens européens, mais le dialogue avec les chrétiens arabes ici est beaucoup plus difficile. Cela est dû en partie au fait que beaucoup d’entre eux adoptent des positions anti-normalisation et sont donc réticents à interagir avec les juifs. C’est aussi parce que nous, juifs israéliens, associons le christianisme à l’Occident et peinons à concevoir un christianisme non européen, même si nous-mêmes représentons en grande partie un judaïsme non européen. Ce fossé est profondément regrettable. Je ressens un profond sentiment d’échec face au manque de contacts authentiques entre les communautés juives et chrétiennes locales.
Plus qu’un prénom, un destin
Karma Ben Johanan est maître de conférences au département de religions comparées de l’Université hébraïque de Jérusalem. Elle siège également au conseil académique du Centre d’études du christianisme, de l’Institut Avraham Harman d’études sur le judaïsme contemporain et de l’Institut Stephen Roth d’études sur l’antisémitisme et le racisme contemporains de l’Université de Tel Aviv. Elle dirige un projet financé par le Conseil européen de la recherche, intitulé : “Christosemitism : European Christian Anti-antisemisism, 1945-2020”.
Née dans une famille juive laïque, elle a reçu un prénom bouddhiste, en hommage à la conversion de sa mère au bouddhisme après son divorce avec son mari, devenu rabbin orthodoxe. Son nom de famille, “Ben Johanan”, qui signifie “fils de Jean”, a une résonance chrétienne marquée, comme elle aime à le souligner avec un sourire, bien qu’il provienne de la famille polonaise de son mari. Son destin semblait prédestiné à l’étude des religions. Elle est l’auteure de Jacob’s Younger Brother : Christian-Jewish Relations after Vatican II (Harvard University Press, 2022).Mère de trois enfants, elle a reçu plusieurs prix universitaires, dont le prix Dan David, la plus importante récompense mondiale en Histoire, pour sa thèse de doctorat. En octobre 2025, elle a reçu le prix Mount Zion des moines bénédictins de l’abbaye de la Dormition à Jérusalem.
- Le terme laïc dans l’acception israélienne signifie aussi bien non pratiquant que non croyant.
- Le terme laïc dans l’acception israélienne signifie aussi bien non pratiquant que non croyant. ↩︎