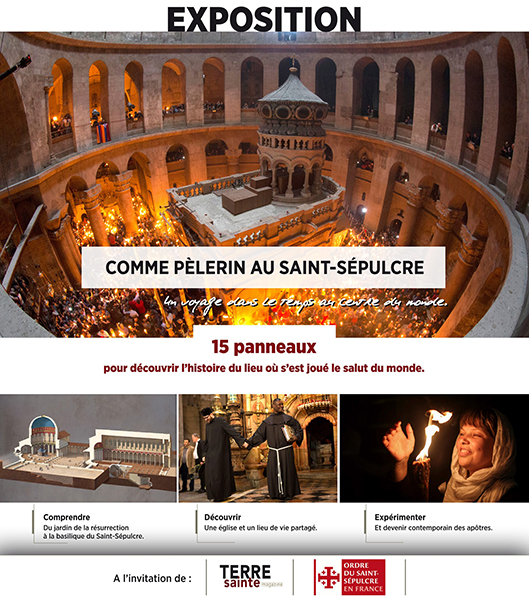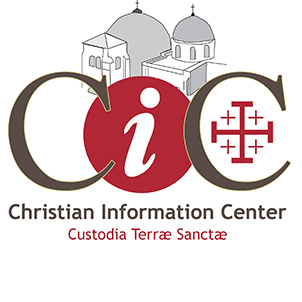Message du Cardinal Pizzaballa, intervention du Directeur de l’œuvre d’Orient et du Consul Général de France.... La Terre Sainte a rejoint les évêques de France. Comme annoncé par Mgr Aveline, une attention particulière s’est portée sur la Terre Sainte durant l’Assemblée en plénière à Lourdes. Des paroles fortes et une espérance qui ne renonce pas.
À l’initiative du cardinal Jean-Marc Aveline, qui a voulu placer la Terre Sainte au cœur de l’Assemblée plénière des évêques de France réunis à Lourdes du 4 au 9 novembre, deux voix de Jérusalem ont profondément marqué les participants : celle du cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin, et celle de Mgr William Shomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine.
Leur message commun est sans ambiguïté : tout est à reconstruire — non seulement les pierres, mais surtout les cœurs. Ils ont remercié l’Église de France prête à se montrer solidaire dans ce rôle de relèvement, puisque les évêques ont voté positivement en ce sens, glissait Mgr Shomali.
Lire aussi → Texte intégral et vidéo du message du Patriarche des Latins, le Cardinal Pizzaballa
Depuis Jérusalem, le patriarche Pizzaballa avait enregistré un message diffusé vendredi 8 novembre. cette intervention fut empreinte à la fois de gravité et d’espérance. Le cardinal a d’abord dressé le constat d’un pays exsangue, où la guerre a laissé derrière elle des ruines immenses : maisons, écoles, hôpitaux, infrastructures, tout est à rebâtir.
Mais, a-t-il souligné, la plus grande dévastation n’est pas matérielle, elle est humaine. Les blessures de la peur, de la haine et de la méfiance sont profondes, et c’est précisément là que commence la mission de l’Église : reconstruire le tissu social, retisser les liens entre Israéliens et Palestiniens, et raviver la confiance là où la guerre a tout brisé.
Appel au retour des pèlerins
Paradoxalement, c’est la paroisse qui a le plus souffert, celle de Gaza, qui donne au patriarche le plus d’espérance. Malgré les pertes et la peur, les jeunes y réclament des responsabilités et veulent servir. « Donnez-nous une mission, un but, quelque chose à accomplir », lui disent-ils. Leur foi active, leur désir d’avancer malgré tout deviennent pour lui un modèle de ce que l’Église doit être aujourd’hui : une communauté vivante, ancrée dans la souffrance mais tendue vers la reconstruction.
Dans son message, le patriarche a remercié la Conférence des évêques de France pour sa proximité constante. Il a évoqué la visite, en août dernier, du cardinal Aveline et de ses vice-présidents en Terre Sainte, venue comme un signe de fraternité dans un moment difficile. Mais il a exhorté à aller plus loin : la solidarité spirituelle ne suffit plus. Il faut que les pèlerins reviennent, nombreux. Les diocèses, les paroisses, les groupes doivent reprendre le chemin des Lieux saints.
C’est ainsi que, physiquement et spirituellement, la France et la Terre Sainte pourront se reconnecter et redonner souffle à des familles qui vivent de l’accueil des pèlerins. Le patriarche n’a pas cherché de formules diplomatiques : il a parlé comme un pasteur à d’autres pasteurs, leur confiant que le soutien matériel, certes, est nécessaire, mais que la présence des pèlerins est une respiration vitale pour l’Église-mère de Jérusalem.
À cette parole fraternelle du patriarche a répondu, à Lourdes, celle de Mgr William Shomali. Dans sa méditation intitulée Un regard chrétien sur la paix en Terre Sainte (texte intégral et vidéo en suivant le lien), il a offert une lecture spirituelle d’un conflit qui, depuis un siècle, déchire la terre où est né le Prince de la paix. Israéliens et Palestiniens, a-t-il rappelé, partagent un même amour pour un même sol, mais leurs récits s’opposent comme deux miroirs qui refusent de se refléter.
Pour les Israéliens, la terre d’Israël est la promesse accomplie, le refuge après des siècles d’exil et de persécutions, la garantie d’une sécurité vitale. Pour les Palestiniens, la même terre est celle de leurs ancêtres, perdue en 1948 lors de la Nakba, symbole de dépossession et d’exil. Entre ces deux mémoires inconciliables, la paix paraît introuvable parce que chacun perçoit l’autre comme une menace à son existence.

Mgr Shomali a dit sans détour que la voie de la force avait échoué. « La militarisation et les représailles n’ont jamais apporté la sécurité ; elles n’ont fait que préparer le prochain cycle de violence. Rompre ce cercle infernal suppose un changement de regard, un courage politique et spirituel : passer du « je dois gagner » au « comment pouvons-nous vivre ensemble dans la justice et la sécurité ».
La paix aura un prix
Une paix véritable, a-t-il ajouté, exige de l’honnêteté, la reconnaissance sincère de la souffrance de l’autre, et la volonté de vouloir la paix plus que la victoire. La communauté internationale, elle aussi, doit cesser les doubles discours et faire appliquer les résolutions qu’elle a votées. Pour Mgr Shomali, le cadre le plus réaliste reste celui des deux États, fondé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem partagée, une solution juste pour les réfugiés et des garanties de sécurité pour Israël.
Mais la paix politique ne suffit pas si elle ne repose pas sur une conversion spirituelle. C’est ici que le prélat a rappelé les vertus évangéliques du respect, du pardon et de la réconciliation. Le respect, c’est reconnaître dans l’autre, même ennemi, un être créé à l’image de Dieu. Le pardon, c’est refuser la logique de la vengeance sans renoncer à la justice. La réconciliation, enfin, c’est l’œuvre la plus difficile : celle qui transforme d’anciens ennemis en voisins capables de construire ensemble un avenir commun.
Lire aussi → La Terre Sainte au cœur de l’Assemblée des évêques de France
Mgr Shomali a aussi nommé les ennemis de la paix : l’orgueil, les préjugés, les manipulations politiques ou religieuses, les intérêts économiques liés à la guerre, et cette tentation d’instrumentaliser Dieu pour justifier la violence. Quand la religion devient drapeau, a-t-il dit, elle trahit sa vocation.
Face à cela, il a insisté sur le rôle de la prière, véritable combat spirituel contre la haine et le désespoir, et sur la nécessité d’une unité des chrétiens. Trop souvent, le monde chrétien se déchire entre un soutien inconditionnel à Israël et un militantisme aveugle pro-palestinien. Cette division, a-t-il averti, est un scandale qui affaiblit le témoignage chrétien. L’Évangile de la paix ne saurait être sélectif : il vaut pour chaque vie, israélienne ou palestinienne.
La paix, conclut-il, aura un prix. Elle demandera aux Israéliens de risquer une sécurité parfaite pour une paix incertaine, et aux Palestiniens de renoncer à certains rêves pour obtenir une liberté réelle. Mais le coût de la guerre est infiniment plus lourd : des enfants morts, des familles brisées, des peuples désespérés. La voie du Christ, celle de la croix, enseigne que la rédemption passe par le sacrifice — non plus de sang, mais d’orgueil, de peur et d’idolâtrie.
Lire aussi → Rencontrer et soutenir les pierres vivantes de Terre Sainte !
Dans le même élan, Mgr Shomali a glissé un mot plus concret : pour ceux qui hésitent à repartir en pèlerinage, les assurances peuvent être prises directement en Terre Sainte, à faible coût. Manière simple de dire que des solutions existent aux atermoiements et qu’il est temps de venir, vraiment.
Enfin, le vendredi 8 novembre, d’autres voix s’étaient fait entendre : Mgr Hugues de Woillemont, directeur de l’Œuvre d’Orient, et Nicolas Kassianides, Consul général de France à Jérusalem, ont également pris la parole. Leurs interventions ont élargi le cercle de cette solidarité ecclésiale et diplomatique.
À Lourdes, cette session de la Conférence des évêques de France a donc marqué une étape nouvelle. Au-delà des discours, c’est une communion qui s’est exprimée, une promesse de fidélité renouvelée entre l’Église de France et l’Église de Jérusalem. Et depuis la Terre Sainte, le message est clair : que cette fidélité devienne action, prière et présence. Parce que, malgré les ruines et la peur, la vie continue à jaillir là où les chrétiens décident encore de croire que la paix reste possible.