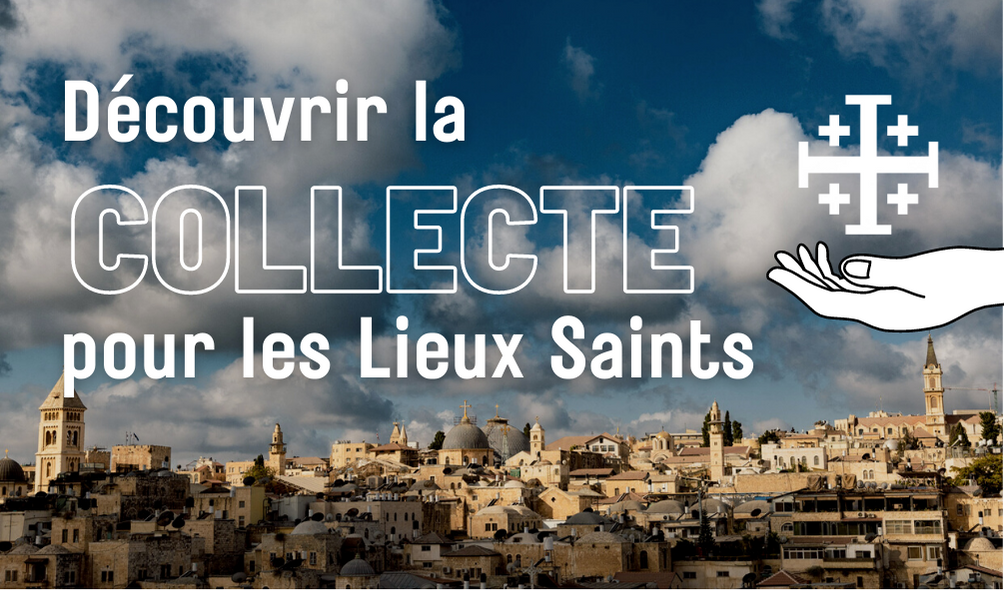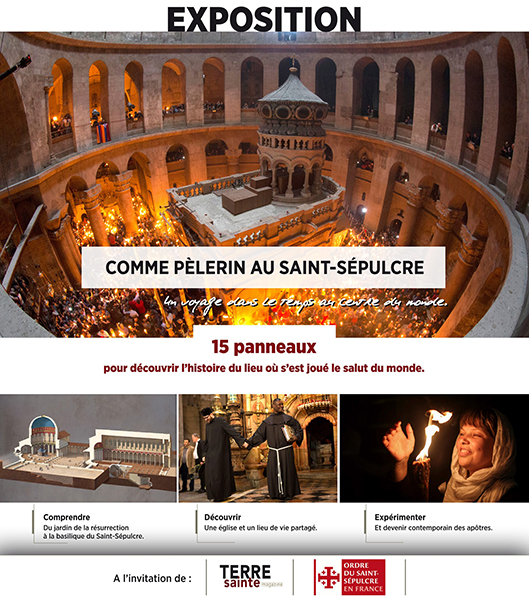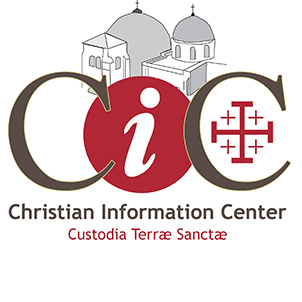Dans la ville fantôme de Bethléem, cette pauvreté qui rampe
Asad Giacaman, lunette noire et chemise soignée, tient une petite boutique dans la rue de la Grotte du lait, à Bethléem. Voilà un an qu’il n’arrive plus à honorer le loyer de son échoppe. “Le local appartient à l’Église grecque-orthodoxe, qui me demande 50 dinars jordaniens (environ 60 €) par mois. Je ne gagne même pas cette somme”, souffle le commerçant, âgé de 73 ans. Asad devrait être à la retraite, mais aucun système de sécurité sociale publique n’existe en Palestine. Il ouvre donc sa boutique tous les jours, au cas où un touriste passerait par là.
Lire aussi → Bethléem annonce le retour des festivités de Noël
À l’âge d’or des pèlerinages, dans les années 2015-2019, Bethléem accueillait en moyenne 1,5 million de visiteurs par an. Travailler dans le tourisme était l’assurance d’un revenu facile et confortable si on acceptait de ne pas compter ses heures.

Depuis le Covid-19, et le 7-Octobre 2023, la dépendance de la ville envers le tourisme s’est muée en une crise économique d’une ampleur inégalée par rapport au reste des Territoires palestiniens occupés. Elle s’ajoute au retrait des 160 000 permis des travailleurs en Israël, et à la faillite de l’Autorité palestinienne qui ne verse que des bouts de salaires à ses 130 000 fonctionnaires.
Des signes visibles de pauvreté
Le taux de chômage est estimé à 65 % à Bethléem en 2025, contre 30 % pour le reste de la Cisjordanie, selon un rapport de la Banque mondiale. En seulement 14 mois, l’indice de développement humain (IDH) de la Cisjordanie a diminué de 6 %, ce qui représente une perte équivalente à 16 années fastes.
Les signes de pauvreté, habituellement invisibles dans une société très solidaire, se multiplient. “Plus de la moitié des familles de nos 900 élèves n’arrivent plus à payer leurs frais de scolarité”, détaille sœur Intisar Sharam, directrice de l’école Terra Sancta pour les filles, qui facture 780 € par an et par enfant. C’est l’établissement privé le moins onéreux de la ville.
Lire aussi → Reconnaissance de la Palestine : le « Et après? » des chrétiens de Terre Sainte
“Les familles chrétiennes sont les plus vulnérables, car beaucoup travaillent dans le tourisme et l’argent économisé jusqu’ici a été dépensé”, expose la jeune directrice qui se retrouve dans l’incapacité de payer les salaires de ses 80 enseignants. C’est la Custodie de Terre Sainte, elle aussi durement touchée par les conséquences économiques de la guerre, qui assure les paiements.

“Aujourd’hui, de nombreuses familles n’ont pas assez d’argent pour s’acheter à manger”, souligne Grace Ballut, directrice adjointe de l’école : “On sent que nos élèves vivent avec le poids des problèmes financiers de leurs parents. D’autant qu’ils sont déjà très affectés par la brutalité d’une guerre qu’ils vivent à travers leur téléphone. Ils ont du mal à étudier, à se concentrer…”
Émigration en hausse
D’après le rapport de la Banque mondiale, le taux de pauvreté à court terme est passé d’environ 12 % avant le conflit à près de 28 % fin 2024. “Cette crise décime les classes moyennes et pousse les classes les plus pauvres vers le mode survie”, juge Raja Khalidi, directeur de l’Institut palestinien de recherche sur les politiques économiques.
Au patriarcat latin de Jérusalem, les chiffres franchissent des records : “On a constaté une augmentation de 600 % des demandes d’aide financière, nous sommes submergés par la pauvreté”, expose George Akrouch, directeur du développement. Les gens sont incapables de satisfaire leurs besoins fondamentaux, ils n’ont que l’Église vers qui se tourner.” Il estime que chaque mois, 40 % des chrétiens de Cisjordanie bénéficient de leur programme humanitaire : “On n’a jamais vu ça.”
Lire aussi → Églises : une année sur la brèche
Ces difficultés économiques et les incertitudes géopolitiques poussent les Palestiniens à imaginer leur avenir ailleurs. La minorité chrétienne, qui a souvent de la famille à l’étranger, est la première à partir. Le patriarcat latin de Jérusalem estime que 162 familles chrétiennes ont émigré depuis le 7-Octobre, soit environ 648 personnes si on multiplie par quatre (la moyenne dans un foyer chrétien en Cisjordanie).
“Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un avenir pour nos enfants”, glisse Grace Ballut pour tenter d’expliquer cette émigration : “J’ai grandi pendant l’Intifada, c’était dur, mais à l’époque on se souciait peu de la guerre : on a toujours vécu avec, et on arrivait à se projeter. Le contexte actuel rend cela impossible. On ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait.”