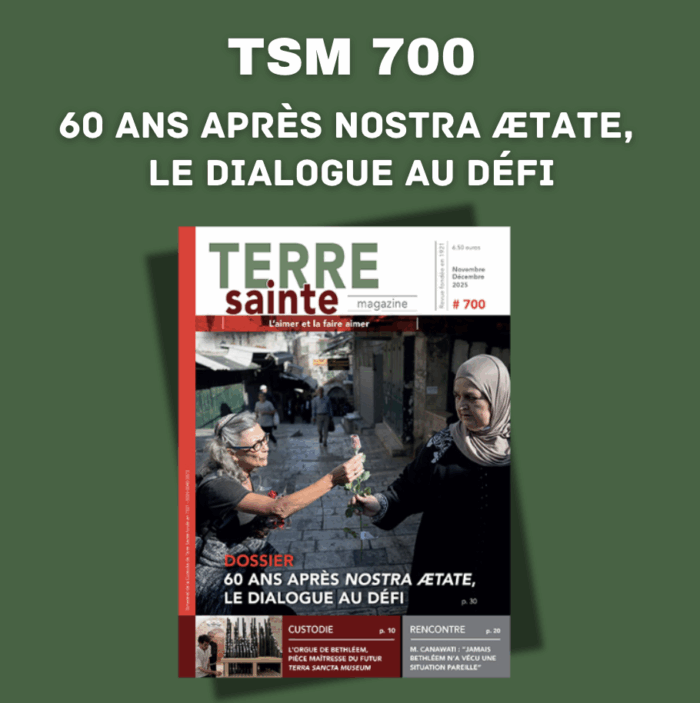Écouter les pierres vivantes: trois voix chrétiennes au milieu de la tourmente
Un résumé des questionnements, des difficultés et des espoirs des chrétiens de Terre Sainte. En écoutant les trois intervenants invités par les organisateurs de leur Ve Congrès international, les commissaires de Terre Sainte ont pu entendre avec leurs mots les Pierres vivantes de cette terre.
Du 19 au 25 novembre 2025, Jérusalem accueille le Ve Congrès international des Commissaires de Terre Sainte sur le thème : « Ambassadeurs de la paix : écouter, soutenir, annoncer la Terre Sainte ». L’après-midi du premier jour, le 19 novembre, a été consacré à « l’écoute des pierres vivantes » — ces chrétiens locaux que l’on cite si souvent, sans vraiment leur donner la parole.
Sur le podium, trois visages de cette Église minoritaire mais déterminée à tenir bon :
- Mgr Rafic Nahra, évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem pour la partie du diocèse située en Israël
- le P. Amjad Sabbara ofm, franciscain de la Custodie, curé de Nazareth après six années comme curé de Jérusalem
- Elias Habash, responsable des Scouts catholiques arabes de Jérusalem, né et élevé dans la Vieille Ville, sur la Via Dolorosa.
La journaliste italienne Alessandra Buzzetti (TV2000) animait l’échange. De ce dialogue serré ressort un diagnostic sans fard : identité fragilisée, violence endémique, tentation de l’exil, épuisement face à la guerre. Mais aussi une ligne de conduite très nette : refuser la haine, tenir par la foi, et compter sur la solidarité concrète, notamment celle des pèlerins.
« Minorité dans la minorité » : l’identité sous pression
D’emblée, Mgr Rafic Nahra plante le décor avec quelques chiffres. En Israël, explique-t-il, « on compte environ 185 000 chrétiens, dont 140 à 145 000 Arabes chrétiens. Cela représente à peine 1,8 % de la population, et environ 7 % du monde arabe en Israël. Nous sommes une minorité dans la minorité. »

Mais c’est moins le nombre que la crise d’identité qui l’inquiète. Il raconte une rencontre avec des jeunes : « Une jeune fille a levé la main et m’a dit : “Pour nous, le problème, c’est que nous ne savons pas qui nous sommes. Je suis israélienne ? Arabe ? Palestinienne en Israël ? Chrétienne dans un pays majoritairement juif ?” Ce n’est pas anecdotique. C’est un problème très difficile à vivre. »
Lire aussi → Les ambassadeurs de la paix se retrouvent à Jérusalem (12/11/2025)
La géographie éclatée du Patriarcat latin n’arrange rien : la même famille peut avoir des membres à Gaza, à Haïfa, à Jérusalem ou en Jordanie — avec un fils sous l’uniforme de l’armée israélienne. « Nos communautés sont partout, et cela rend tout extrêmement délicat », résume l’évêque.
À cela s’ajoute la guerre, non seulement à Gaza mais aussi au nord, face au Hezbollah. « Dans le nord, certains de nos chrétiens vivent à proximité du Liban et subissent les bombardements. Les autres ressentent la guerre dans l’ambiance générale : au début, il y avait un silence total. Personne n’osait parler. Un mot de travers au travail pouvait vous coûter cher. »
Violence mafieuse et exil silencieux
La fracture se creuse aussi au quotidien : chrétiens arabes travaillant avec des collègues juifs traumatisés par le 7 octobre, familles restées en Cisjordanie ou à Gaza, médias israéliens qui ne parlent des Arabes ou des Palestiniens « que quand ils commettent un attentat ». Résultat : les chrétiens arabes « sont pris en étau » entre deux récits antagonistes.
Moins visible à l’extérieur, mais tout aussi destructrice, Mgr Nahra pointe l’explosion de la violence criminelle dans la société arabe en Israël : « Depuis le début de l’année, on compte plus de 230 personnes assassinées dans la société arabe. Mafia, extorsion, menaces, biens brûlés… Et seulement 10 % des cas traités par la justice. Les gens n’ont plus confiance. Certains ont peur même d’aller à la police, parce qu’ils savent que l’information peut arriver aux familles mafieuses. »
Lire aussi >> À la frontière avec le Liban, la minorité chrétienne en empathie avec ses voisins juifs
Face à cela, beaucoup fuient :
- déplacement vers des villes jugées plus sûres (par exemple la ville mixte de Nof HaGalil, devenue « la quatrième ville chrétienne d’Israël » à cause de l’afflux depuis Nazareth)
- départ à l’étranger (Chypre, Grèce, États-Unis…)
- achat d’appartements hors du pays « au cas où il faudrait envoyer les enfants ».
« L’émigration de notre peuple est un problème très sérieux », martèle l’évêque. Que dire alors à ceux qui veulent partir ? Pour lui, une seule raison peut retenir durablement : la conscience d’une mission : « Si cette conviction n’habite pas le cœur, ils partiront. Si la vie est trop difficile, ils chercheront un endroit plus paisible. Ceux qui restent sont ceux qui ont compris qu’ils ont une mission ici. »
À Jérusalem, une jeunesse à bout de souffle
Depuis la Via Dolorosa, où il est né entre la 6ᵉ et la 7ᵉ station, Elias Habash voit de près ce que vivent les jeunes chrétiens de la ville.

« Pendant ces deux ans de guerre, les jeunes ont affronté une réalité très dure, très “compétitive”, dit-il. Jérusalem est devenue une petite ville étroite, étouffante. Beaucoup de pression, beaucoup d’armes visibles dans les rues, de contrôles, surtout pour les Arabes. Les jeunes ne savent plus s’ils ont un avenir ici, s’ils pourront étudier, travailler, se marier. Ils ont arrêté de penser au futur. »
Lire aussi→ Francesco Ielpo: « “Être proche” est peut-être le plus grand travail » – (15/09/2025)
Responsable des Scouts catholiques arabes de Jérusalem, qui rassemblent 250 à 300 enfants et jeunes de 6 à 25 ans, il a pris avec ses chefs une décision radicale : « Nous avons triplé nos efforts. Il fallait remplir leur temps, les rassembler sous notre regard, leur offrir des alternatives : camps, sports, musique, rencontres… Nous avons passé plus de temps avec eux qu’avec nos propres familles. Mais ça a marché. Cette période est passée “en douceur” parce que nous étions ensemble. »
Un choix fort a été posé : pas de téléphones portables pendant les activités. « Quand un jeune entre dans le bâtiment scout, il n’a plus besoin de son portable. Nous avons été plus malins : nous avons multiplié les activités pour qu’ils n’aient pas le réflexe de regarder les vidéos violentes, la propagande, les réseaux. En camp, ils n’avaient qu’une demi-heure par jour pour appeler leur famille. C’était très difficile, mais maintenant, quand nous regardons en arrière, nous nous demandons nous-mêmes comment nous avons réussi. »
Au cœur de cette pédagogie, la dimension spirituelle est assumée : « Quand tu fais face à un problème, tu n’as qu’un endroit où aller : Dieu, Jésus et la Vierge Marie. Nous avons travaillé très dur avec la paroisse pour ramener les jeunes autour de l’Église. Je dirais que nous avons réussi à 80 %. »
Lire aussi >> Reconnaissance de la Palestine : le « Et après? » des chrétiens de Terre Sainte
Sur la « douceur » dont parlent les deux prêtres, Elias est clair : « Être doux, ce n’est pas être faible. Ce n’est pas avoir peur de la vérité. Nous sommes forts par notre foi, notre culture, notre éducation. Nous sommes minoritaires, mais l’Église et la communauté, tant qu’elles restent unies, sont puissantes, même en minorité. »
Les scouts, à leurs mesures, tissent aussi des liens au-delà des murs : échanges avec les troupes de Ramallah, Bethléem ou Taybeh, grands rassemblements avec près de 200 enfants de Palestine, activités communes avec des scouts musulmans à l’intérieur même des murailles de la Vieille Ville. « Nous sommes ouverts, dit Elias, et c’est une source de force. »
« Notre mission, pas la valise » : la réponse pastorale du P. Amjad
Le père Amjad Sabbara, lui, part d’éléments très concrets : les finances des familles. À Jérusalem, environ 35 % des paroissiens vivaient du tourisme : hôtels, guidage, services aux pèlerins…

« Beaucoup comptaient sur la saison d’octobre à décembre pour couvrir leurs dettes. Puis tout s’est arrêté. Les groupes ont annulé, les réservations sont tombées une à une. Et le père de famille se retrouve devant cette question : “Que faire ? Comment payer ce que je dois, comment assurer l’avenir de mes enfants ?”. »
Dans le même temps, l’espace public se ferme. Après le 7 octobre, explique-t-il, n’importe quelle parole critique à l’égard d’Israël pouvait valoir enquête, arrestation, ou au minimum des ennuis. L’illusion d’un pays pleinement démocratique s’est fissurée. On se tait dehors, on parle à voix basse à la maison.
Puis vient la nouvelle de la souffrance des chrétiens de Gaza. Là, quelque chose bascule : « Le plus beau, dit le père Amjad, c’est que malgré leurs propres difficultés, les chrétiens de Jérusalem se sont mobilisés pour collecter de l’argent, via le Patriarcat, pour Gaza. Nous avons compris que notre rôle, face à cette guerre, était d’être comme le Bon Samaritain pour ceux qui souffrent. Pas de devenir des experts en analyse politique. »
Le choix de la paroisse est clair – faire de la pastorale, pas des déclarations :
- aide accrue pour les frais de scolarité ou d’université
- visites de familles, écoute patiente
- insistance sur la mission plutôt que sur le simple « statut » chrétien
« Nous avons changé tout notre programme de jeunes, explique-t-il. Avant, nous travaillions sur la question “Comment vivre mon identité ?”. Maintenant, nous disons : “Mon identité naît de ma mission.” Je suis ici parce que le Seigneur m’a confié une mission dans ce pays. C’est cela qui me porte. »
Il ne cache pas que certains n’en peuvent plus : sept familles de sa paroisse ont quitté le pays depuis le début de la guerre. Mais la paroisse garde le lien, par téléphone ou par mail. « Car ce n’est pas simple de recommencer une vie ailleurs, dans une autre culture. »
La douceur comme refus de la vengeance et du mensonge
Invité à préciser ce qu’il entend par « douceur« , le père Amjad revient à la théologie la plus simple : « Nous avons beaucoup insisté sur une chose : Jésus ne nous a pas menti. Il nous a dit qu’il ne nous laisserait pas seuls, mais aussi que nous devrions souffrir, porter la croix, vivre au milieu de l’ivraie. La force vient de l’invisible qui donne sa force au visible. »
Cette douceur n’est pas une passivité. Mgr Nahra la résume en une phrase nette : « Pour moi, la douceur, ce n’est pas ne rien faire. C’est refuser deux choses : la violence et le mensonge. Si nous entrons dans la logique de la vengeance, l’Église est morte. »
Or la tentation est partout :
- discours de ministres appelant à « faire sortir tous les Palestiniens de Gaza »
- peur que l’autre « prenne ma place et me chasse »
- montée simultanée des fondamentalismes juifs et musulmans
La réponse, pour le franciscain, se joue dans une conversion réelle : rencontrer le Christ vivant dans la liturgie, et non se contenter de « pratiquer » ; redonner place au sacrement du pardon, où l’on apprend concrètement à renoncer à la vengeance ; accompagner personnellement les jeunes en direction spirituelle.
« Nous avons pris au sérieux cette parole de saint Paul sur “ce qui manque aux souffrances du Christ”. Chacun de nous porte une part de la passion du Christ pour cette terre. Sommes-nous convaincus de cela, oui ou non ? C’est la vraie question. »

Dialogues fragiles, gestes héroïques
Tout n’est pas noir. Malgré la peur et les tensions, Mgr Nahra connaît des gestes de courage silencieux, souvent invisibles hors du pays :
- des rabbins ou des médecins pour les droits humains qui franchissent les checkpoints pour aller aider des Palestiniens agressés par des colons, au risque d’être traités de traîtres par leur propre camp
- des jeunes Israéliens qui s’interposent entre un tracteur de colons et des paysans palestiniens en train de récolter les olives
- l’histoire de cet Israélien qui a donné un rein à un Arabe, en pleine guerre.
« Se tenir devant un tracteur, je ne le ferais pas moi-même, avoue l’évêque. Ce sont des exemples héroïques. Ils existent, mais ils restent une petite minorité. »
Au niveau ecclésial, le Patriarcat tente aussi de rassembler des jeunes qui ne vivent pas le conflit du même côté :
- jeunes des communautés hébréophones (souvent enfants de migrants ou convertis) très intégrés à la société israélienne
- jeunes arabes de Galilée, parfois engagés dans l’armée, parfois beaucoup plus sensibles à la souffrance des Palestiniens
Une fois par an, une messe commune est organisée. « Certains refusent de venir, dit Mgr Nahra, parce qu’ils estiment que “ce n’est pas le même monde”. Mais ceux qui viennent découvrent que nous sommes une seule Église. Nous prenons même soin d’équilibrer les langues : le Credo une fois en hébreu, une fois en arabe… C’est un petit “statu quo”, mais au moins, il existe. »
En parallèle, universités et ministères organisent des programmes interreligieux formels. Ils touchent un cercle restreint, souvent toujours les mêmes. Et la peur de se faire photographier avec « l’autre camp » pour finir le lendemain sur les réseaux sociaux freine bien des bonnes volontés.
Lire aussi >> Chrétiens dans la guerre: à Jaffa, le défi de la coexistence
Le père Amjad, lui, insiste sur l’enjeu éducatif à long terme, à Jérusalem comme à Gaza : « Ma plus grande peur, ce sont tous ces orphelins de Gaza. Quelle éducation recevront-ils ? Si leur seule perspective est une certaine forme d’éducation islamique tournée vers la revanche, alors la vengeance viendra tôt ou tard. »
Il décrit aussi la duplicité imposée dans certaines écoles de Jérusalem, obligées de jongler entre manuels palestiniens et programmes israéliens, cachant les uns lorsque les inspecteurs des autres arrivent. « Dans la tête de l’élève, cela creuse une division supplémentaire : qui sommes-nous vraiment ? »
Pour lui comme pour l’évêque, il faudra un travail sérieux sur les curriculums scolaires, chrétiens, musulmans et juifs, une fois passée la phase la plus aiguë de la crise. Pas des slogans, mais une réflexion de fond sur l’histoire enseignée, la place de l’autre, la vérité des faits.
« Rendre la Terre Sainte respirable » : l’appel aux commissaires
À la fin, Alessandra Buzzetti demanda aux trois intervenants ce qu’ils veulent dire directement aux commissaires de Terre Sainte — et, à travers eux, aux Églises du monde. La réponse est directe.
Pour Mgr Nahra, deux messages :
- Ramener les pèlerins, progressivement mais résolument.
« Nous voyons déjà Nazareth revivre un peu. Quand les pèlerins reviennent, la ville reprend vie, et avec elle l’espérance. »
- Parler de cette terre d’une manière qui unit au lieu de diviser.
« Ce qui m’effraie, c’est la haine qui grandit dans le monde, chez des gens qui n’ont jamais rencontré ni Palestinien ni Israélien, mais qui se déchirent intérieurement sur ce conflit. Ne prenez pas position trop vite. Informez-vous, réfléchissez, comprenez. Ici, tout le monde souffre. Je ne dis pas que tout est égal, chacun a ses responsabilités, mais tout le monde souffre. Cherchez un langage qui rassemble, pas un discours noir-ou-blanc. »
Le père Amjad renchérit sur l’enjeu très concret de la présence des pèlerins :
« Pour les 35 % de paroissiens qui vivent du tourisme, le retour des pèlerins rend la dignité, la possibilité de continuer à rêver, à mettre des racines. Pas seulement à Jérusalem, mais aussi à Bethléem et ailleurs. Nous avons beaucoup parlé de “pèlerinages de solidarité” : c’est maintenant qu’ils sont nécessaires. »
Quant à Elias Habash, il met les chiffres sur la table :
« En Palestine, 70 % de la population chrétienne dépend directement ou indirectement des pèlerins. Nous, comme scouts, nous faisons notre possible pour convaincre les jeunes de ne pas émigrer. Mais vous, en ramenant les pèlerins, vous êtes plus forts que nous. Aidez-nous à garder les chrétiens ici. Nous avons besoin les uns des autres. »
En choisissant comme thème « Écouter les pierres vivantes », le congrès des commissaires de Terre Sainte ne s’est pas offert un simple slogan. À Jérusalem, ce 19 novembre, les pierres ont parlé clair : identité blessée, jeunesse sous pression, tentation de la fuite, colère rentrée. Mais aussi une conviction tenace : la douceur évangélique n’est pas une faiblesse, c’est un refus obstiné de la violence et du mensonge.
Aux « ambassadeurs de la paix » de partager ces paroles dans leur action, non comme un récit de plus, mais comme un mandat : faire connaître la complexité de la Terre Sainte, encourager des pèlerinages de solidarité, et soutenir ceux qui ont choisi de rester comme chrétiens dans la terre de Jésus — non par romantisme, mais parce qu’ils ont compris qu’ici se joue leur mission.