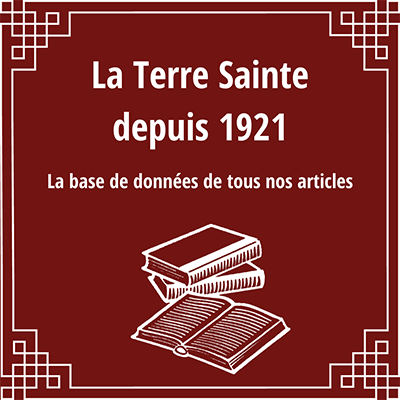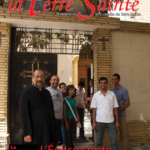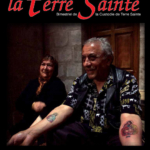L’Eglise chaldéenne catholique s’origine dans « l’Église assyrienne d’Orient » qu’on nomme aujourd’hui assyrienne d’Orient. Celle-ci est l’ancienne Église de Perse qui, au Ve siècle, adopta la doctrine de Nestorius. Ainsi est-elle aussi connue sous le nom d’Église perse ou nestorienne. Par contre, l’Église chaldéenne est constituée des membres de cette même Église qui, à partir du XVIe s., se sont unis à Rome. Il s’agit en fait de deux Églises sœurs.
Les origines ethniques des chrétiens assyriens et chaldéens, implantés dans leurs foyers traditionnels de Perse, de Mésopotamie et du Kurdistan, ne sont pas sûres. Eux-mêmes se considèrent comme des héritiers directs des peuples assyrien et chaldéen, bien connus des textes bibliques.
L’évangélisation de ces territoires, situés hors des limites du monde romain, est attribuée par la tradition à l’apôtre Thomas et à son disciple Addai. Cependant, il est plus probable que l’évangélisation des Assyriens et des Chaldéens fut l’œuvre de missionnaires judéo-chrétiens et syriens du Ier siècle, originaires d’Édesse. L’évangélisation progressa rapidement. Dès le IIIe siècle l’Église de Mésopotamie possède sa liturgie propre et est organisée en diocèses qui dépendent de l’Église mère d’Antioche. Un siècle plus tard, on voit se fonder sur son territoire de prestigieuses écoles de théologie, dont la plus connue, celle de Nisibe, appelée plus tard «École des Perses», fut une pépinière de saints et de sages. Au milieu du IVe siècle, alors que s’achève à peine l’ère des persécutions contre les Églises occidentales, la dynastie sassanide perse déchaîne à son tour une ère de persécutions contre la communauté chrétienne perse. La plus cruelle fut celle de Chapor II, qui dura de 341 à 379 et fit d’innombrables martyrs.
Expansion missionnaire en Asie
A partir du VIe siècle, l’Église perse connaît une époque extraordinaire d’expansion dans les pays de l’Est et du Sud. Elle fonde des diocèses dans les États de Qatar, de Koweït, de Bahreïn et d’Oman. Au VIIIe siècle, on a la preuve de l’existence d’un royaume chrétien à Kachgar, en Asie centrale. Mais ce sera au temps des Abbassides, alors que l’empire musulman est gouverné depuis Bagdad par des califes semi-perses, que les chrétiens nestoriens bénéficieront d’un traitement spécial. C’est, pour l’Église perse, l’époque de sa plus grande splendeur. Ses moines, « les porteurs de lumière » sont les protagonistes de cette épopée. Ils s’engagent sur la Route de la Soie, pour aller évangéliser l’Asie. Ils parviennent au Turkestan, en Mongolie, en Chine, au Tibet et en Inde, fondant des chrétientés sur leur passage. Aux environs du IXe siècle, l’Église nestorienne comptait 245 diocèses, en des endroits aussi divers que Le Caire, Jérusalem, Samarkand et Pékin. Selon Mgr Alichoran, la communauté nestorienne était composée de 60 à 80 millions de fidèles. Un chiffre très élevé pour l’époque. On ne connaît pas d’explication logique à ce phénomène d’expansion missionnaire, unique dans les annales des Églises orientales.
Les siècles de décadence
En Asie Centrale, la situation ira se détériorant à la fin du XIIIe siècle , quant aux régions d’ancienne implantation nestorienne: la Mésopotamie, la Perse et le Kurdistan, la conquête de la Turquie actuelle, au XIVe siècle, par les Turcs-Ottomans, et l’apparition d’un chiisme violemment antichrétien en Perse séfévide ne firent qu’y affaiblir le christianisme, impuissant face à la conversion plus ou moins forcée de ses fidèles à l’islam. Au XVe siècle, l’insécurité était telle pour les chrétiens nestoriens qu’ils se virent contraints de se replier dans les montagnes inaccessibles d’Hakkari et d’Azerbaïdjan occidental, dans l’actuel Kurdistan. C’est dans cette région pauvre, inhospitalière et au climat rigoureux, qu’ils vécurent jusqu’ à la première guerre mondiale.
—
Lire aussi dans le Dictionnaire de théologie catholique, l’article du Cardinal Tisserant sur l’Eglise nestorienne.
Dernière mise à jour: 20/11/2023 11:50