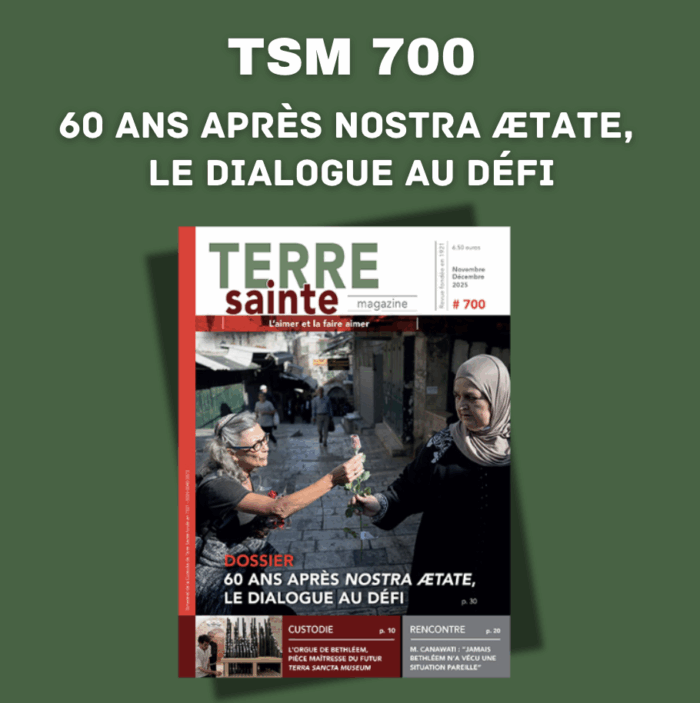Directeur de l'ONG Rabbins pour les droits de l'homme, Avi Dabush est de retour au kibboutz Nirim, deux ans après les attaques du 7-Octobre. Rabbin et activiste aux multiples casquettes, il revient sur ces 732 jours, passés à militer pour la paix au cœur de la guerre.
Deux ans après les attaques du 7-Octobre, vous êtes de retour à Nirim. Quels sont vos sentiments ?
Ce n’est pas facile. D’abord parce que la région s’est transformée en mémorial géant. Pour nous, les résidents, c’est difficile, car nos communautés doivent rester des lieux de vie. Ensuite, parce que la guerre est très proche. Les maisons tremblent à cause des bombardements sur Gaza. La frontière est à trois kilomètres seulement. Parfois, les bruits de la guerre me réveille, et j’ai l’impression que je vais revivre le 7-Octobre à nouveau.
Nous nous sommes réinstallés fin août, après avoir vécu six mois à Eilat, puis un an et demi à Beer Sheva. C’était nécessaire de déconnecter de cet endroit, mais c’est aujourd’hui nécessaire d’y revenir : je ne veux pas oublier qu’il y a la guerre. C’est une question de valeurs. De la même manière qu’on ne peut pas ignorer ce qui s’est passé le 7-Octobre, on ne peut pas ignorer ce qui se passe à Gaza. C’est une maladie de l’âme d’ignorer la réalité pour se concentrer seulement sur soi. Cela créé de l’indifférence, voire de la violence envers les autres.

Ces deux années de guerre ont-elles changé votre rapport à la foi, et à la religion de manière générale ?
Nous vivons des temps confus. J’ai grandi dans un milieu sioniste religieux, à Ashkelon, où la foi est très associée à la pratique religieuse. Aujourd’hui, je me suis éloignée de cette pratique institutionnelle pour vivre quelque chose de plus spirituel, de plus ouvert, de plus méditatif, de plus proche de la vie elle-même.
Lire aussi >> Marche interreligieuse à Jérusalem, une lueur d’espoir dans un contexte sombre
Ces deux dernières années, on a tous ressenti cette impuissance, cette impression de ne pas en faire assez. Je suis convaincu qu’un des choses principales qu’on peut faire, c’est d’être là. D’être là, sans forcément chercher à comprendre. D’être là, pour regarder, autant à l’intérieur de soi, que vers l’extérieur. D’être là, auprès de ceux qui ont besoin, que ce soit les familles d’otages, ou les palestiniens en Cisjordanie.
Vous finissez la plupart de vos posts Facebook avec les mots « Je crois ». En quoi croyez-vous ?
J’ai commencé à écrire ça le 7-Octobre. Un célèbre chanteur israélien a écrit ces paroles : “L’être humain crie ce qui lui manque : il lui manque la confiance, il crie “confiance””. J’ai écrit “je crois”, parce que je n’y croyais plus. Aujourd’hui, je veux croire qu’on peut faire une différence. Je veux croire que si on a le pouvoir d’abîmer quelque chose, on a aussi le pouvoir de le réparer. Je veux croire en un beau futur, où l’on aura trouvé le moyen de vivre ensemble, Israéliens et Palestiniens, en sécurité et en harmonie, entre la rivière et la mer. C’est une question de volonté politique.

En tant que rabbin et activiste des droits de l’homme, pensez-vous avoir une mission ?
J’ai été ordonné au sein du Rabbinat israélien, un programme de l’institut Shalom Hartman, plutôt libéral, et qui voit les rabbins comme des leaders. On peut être des « rabbins publics », sans communauté fixe. C’est ainsi que je me définis : j’utilise ma voix, mon histoire, ma position en tant que directeur de Rabbins pour les Droits de l’Homme, et mon engagement au sein du parti Les Démocrates (ancien parti travailliste, ndlr), pour défendre et agir en faveur d’un projet de société alternatif.

Au-delà de la guerre physique, Israël traverse aujourd’hui une guerre des valeurs. La force, promue par le gouvernement israélien actuel, n’est pas le seul langage du judaïsme. La justice et les droits de l’homme en font aussi partie. Nous devons assumer de défendre ces valeurs, et arrêter d’en avoir peur.
C’est pour cela qu’il est important pour moi de parler aux jeunes générations. Près de 73% des 18-24 s’identifiaient comme étant de droite début 2023. J’ai récemment rencontré les élèves d’une école très libérale. Ce fut dur pour eux d’entendre ce que j’avais à dire. On me répondait : “Mais comment peux-tu parler de paix ? Comment peux-tu faire confiance aux Palestiniens ?” Nous devons leur parler plus.
Comment êtes-vous passé du monde sioniste religieux à celui, diamétralement opposé, qui milite pour la paix ?
Ma famille est « mizrahi », originaire de Libye et de Syrie. Très à droite et orthodoxe, mais respectueuse de l’autre, bien que mes parents n’aient jamais appelé ça « droits de l’homme ». Nous vivions à Ashkelon, et étions donc représentif de ce qu’on appelle aujourd’hui les « périphéries », marginales géographiquement et socio-économiquement.
Lire aussi >> À Kerem Shalom, une prière interreligieuse pour la paix
En 1993, je suis parti étudier le judaïsme à Jérusalem. J’ai participé aux manifestations contre les Accords de paix d’Oslo. C’était très violent. Mes camarades estimaient être plus juifs que ceux qui soutenaient les accords, et surtout, ils ne proposaient aucune alternative. Leur seul argument, c’était que le peuple palestinien n’existait pas. Je ne me suis pas reconnu dans cette manière de penser. Plus tard, j’ai rejoins la vie publique, et le parti de gauche Meretz.

Vous faîtes aujourd’hui parti du parti Les Démocrates. Serez-vous candidats aux prochaines élections ?
Je vois l’engagement politique comme un autre moyen d’action, un moyen de réparer. Au sein du parti, je suis en charge des périphéries : de connecter ces marges, traditionnellement proches du Likoud et fervent partisans de Benyamin Netanyahou, à la gauche.
Nous n’avons pas le choix. Nous devons gagner les prochaines élections (prévues pour l’automne 2026, ndlr). La société civile et les manifestations, aussi cruciales soient-elles, ne sont plus assez. Il faut traduire cette contestation en un mouvement politique. À mon échelle, je pense qu’entrer en politique est la bonne chose à faire, bien qu’il soit plus simple de rester dans la société civile. Mon rêve, ça serait d’être ministre des Finances, pour qu’enfin l’argent de ce pays soit investi dans les bonnes priorités.