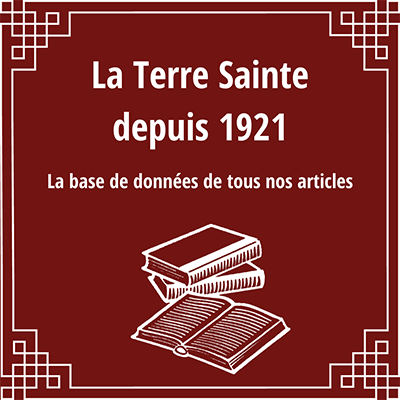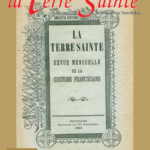L’Église melkite « emprunte à deux cultures opposées résumant en elle toutes les contradictions du christianisme oriental. Byzantine de rite, elle participe pleinement à la tradition religieuse locale (…) et partage ave l’Église sœur orthodoxe une insurmontable méfiance à l’égard des visées « impérialistes » et latinisantes qu’elle continue de prêter à Rome. Mais catholique de foi et d’appartenance, elle se voit — non sans injustice — étiquetée comme Église étrangère par les orthodoxes et même suspectée d’être l’instrument du prosélytisme romain. Surmonter cette contradiction ne peut être le fait des seuls melkites, victimes des préjugés où s’attardent encore les deux familles religieuses auxquelles ils se rattachent. Il faudrait que le Vatican, en reconnaissant aux grecs catholiques une véritable autonomie, manifeste qu’il accepte pleinement le fait chrétien oriental et que l’orthodoxie, en les admettant dans sa tradition rituelle, montre qu’elle a conservé le sens de l’universalité de l’Église. Alors l’Église melkite, tiraillée jusqu’à présent entre catholicisme et orthodoxie, pourrait être le terrain de leur rencontre et offrirait par anticipation, l’image qu’aura sans doute l’Église de la réconciliation.
Les relations entre Rome et l’Église grecque catholique n’ont cessé d’être délicates et de reposer sur un malentendu fondamental. En rejoignant le catholicisme, la plupart des melkites n’entendaient nullement dépouiller leur particularisme oriental et renoncer à leur autonomie pour être incorporés dans l’Église romaine. Le retour à l’unité devait, à leurs yeux, s’incarner dans une communion d’Églises sœurs, canoniquement autonomes, égales en droits (reconnaissant à Rome une primauté qui ne saurait valoir juridiction universelle. Pour la curie au contraire, ce ralliement signifiait, à terme, latinisation des rites et subordination à l’autorité romaine. L’incompatibilité des deux démarches, que les incertitudes de la politique pontificale au XVIIIe siècle et l’interminable crise de croissance de l’Église melkite ont longtemps occulté » est apparue pleinement lorsque, en 1847, Rome a décidé le rétablissement d’un patriarcat latin en Terre sainte. Cette initiative, qui justifiait avec éclat les soupçons des orthodoxes à l’égard des intentions romaines, a mis les melkites en porte à faux : entre cet embryon d’Église latine d’Orient et les Église orientales séparées, leur mission n’avait plus guère de sens. Aujourd’hui encore, la suppression du patriarcat latin est une revendication du patriarche melkite, qui ne manque pas de rappeler qu’il a lui-même juridiction sur Jérusalem et que la vocation naturelle de son Église est d’y représenter l’ensemble des catholiques orientaux. Dans ce contexte, l’existence d’un second patriarcat catholique n’aurait aucune justification, sinon la mise en œuvre d’une politique de latinisation (dont Rome se défend désormais).
L’autre revendication majeure des melkites est la reconnaissance d’une pleine autonomie dans leur vie ecclésiale, conformément à la tradition patriarcale de l’Orient, le droit d’intervention du Saint-Siège se limitant à ce qui touche la foi et l’universalité de l’Église. Malgré les progrès apportés à cet égard par le concile Vatican II, la réalité demeure bien loin de leurs vœux. n
Extrait de Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens d’orient : des origines à nos jours, pages 330-331 Fayard 1995
—
Ces lignes gardent une part d’actualité mais 15 ans se sont écoulés. Les patriarches (melkites mais aussi latins) et les papes ont changé. Si des tensions demeurent entre Rome et l’Eglise Melkite, elles touchent principalement à l’administration de l’Eglise melkite dans la diaspora et non en Orient. Des tensions qui ont pu s’exprimer lors de l’Assemblée spéciale du Synode pour le Moyen Orient. Mais précisément, en convoquant ce synode Rome a montré combien sa perception des Églises orientales était en pleine évolution. Il est donc permis d’espérer que l’Eglise catholique se dirigeant vers sa pleine unité interne pourra de mieux en mieux travailler à l’unité avec les Églises orthodoxes. Du chemin reste à faire.
Dernière mise à jour: 21/11/2023 11:44