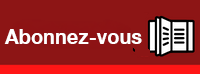À voir ce pays vivre et se battre, on se demande si c’est inéluctable. Ce n’est pas faute d’entendre des paroles de paix sincères ou non. Mais commence-t-on au commencement ? Comment les enfants sont-ils élevés ? Quelle éducation reçoivent-ils à l’école sur celui qui est si proche et si lointain ? Première approche.
L’Histoire est la même, certes. Les faits sont là. Et pourtant, devant eux s’en est fait de l’objectivité, la subjectivité de celui qui les interprète prend le pas. Que l’Histoire soit à la merci de celui qui la raconte est un vieil adage. Lorsqu’il s’agit du conflit israélo-palestinien, chacun revendique son point de vue avec force et en fait la référence absolue si bien que les programmes éducatifs d’un côté comme de l’autre s’en trouvent affectés.
Mais alors que les Israéliens et les Palestiniens sont condamnés à s’entendre, dans la recherche d’une solution au conflit qui les déchire, la conception de « l’autre » devient un élément décisif pour avancer dans la bonne – ou dans la mauvaise – direction. Que l’on en soit conscient ou non, la manière dont l’Histoire est enseignée n’est pas sans conséquence. Et plus encore dans cette région où aucune solution ne sera trouvée sans entente entre les deux parties.
Noam et Amjad
Les données du problème sont les suivantes : classe de géographie dans un collège de Tel Aviv. Neuf heures du matin. Imaginons Noam, 13 ans, écoutant le cours de son professeur de géographie. À la même heure, mais à quelque 70 kilomètres plus à l’est, Amjad, 13 ans également, est aussi en cours de géographie, mais en Cisjordanie, dans la ville de Bethléem. Le premier cours est en hébreu, le second en arabe, le contenu ne devrait-il pas être identique dans les deux cas ? Cela ne va pas de soi. Alors que Noam écrit « Israël » pour désigner l’ère géographique comprise entre la Mer Méditerranée et le Jourdain, Amjad quant à lui s’applique à écrire « Palestine » pour nommer le même territoire. À la fin de la journée, alors que ni l’un ni l’autre n’ont pris conscience de l’importance et de la gravité de ce qui s’est passé en classe, le germe du problème est déjà en terre. Même s’ils vivront plusieurs années jusqu’à ce que les conséquences du cours de géographie de ce lundi viennent vraiment à la lumière, elles finiront par resurgir, et Noam comme Amjad, enfants imaginaires à qui pourraient se substituer des milliers d’élèves palestiniens ou israéliens, seront chacun enfermés dans cette conception de la « non-existence » de l’autre, dans cette conception réductrice, sans aucun espoir d’entente.
L’enseignement : une arme
Depuis la création de l’État d’Israël il y a soixante-trois ans, une douzaine d’affrontements armés ont progressivement déformé l’image que les uns ont des autres pour finalement en arriver à une diabolisation mutuelle. La preuve en est : le conflit dure, sans que l’on trouve de solution pour le résoudre. Au point que l’espoir de paix qui passe par les nouvelles générations d’Israéliens et de Palestiniens tient quelquefois pour inexorable la séparation les uns des autres.
Le magazine La Terre Sainte est allé à la rencontre de professeurs et d’élèves des deux camps, afin d’essayer de comprendre la dynamique employée dans les écoles. Comment l’Histoire est-elle enseignée ? Quelle image chacun transmet-il de l’autre ?
Le débat sur les programmes enseignés dans les écoles palestiniennes et israéliennes remonte aux années 90, lorsque les premières organisations non-gouvernementales commencèrent à analyser la question.
Le rapport publié en 2001 par le Centre pour le Suivi de l’Impact de la Paix (CMIP – Center for Monitoring the Impact of Peace) selon lequel les livres scolaires des six premières années d’école utilisés par les écoles palestiniennes « plantent les germes de la haine au cœur des futures générations palestiniennes de par la délégitimation de l’existence d’Israël, la recherche implicite de la destruction d’Israël, la diffamation d’Israël, et l’encouragement au militarisme et à la violence », eut l’effet d’une bombe. De nombreuses enquêtes furent alors lancées des deux côtés. Des rapports furent publiés soulignant comment les programmes israéliens se référaient aux Arabes comme à des personnes « primitives », comment ils passaient outre des faits cruciaux comme la question des réfugiés suite à la guerre de 1948, ou comment sans avoir besoin d’entrer dans les détails, l’Occupation n’était pas une seule fois mentionnée dans leurs livres.
De la domination ottomane, on passait directement au Mandat britannique puis à la naissance de l’État d’Israël et à la séparation des Territoires Palestiniens, entre Gaza et la Cisjordanie. De tels raccourcis ont donné lieu à un véritable imbroglio au niveau des programmes éducatifs. D’un côté, le Ministère de l’Éducation israélien qui élabora son propre programme éducatif, lequel fut mis en place à travers tout l’État d’Israël naissant après la guerre de 1948. De l’autre, la Cisjordanie restée sous le contrôle de l’administration jordanienne, suivant donc le programme jordanien tandis que Gaza se devait de suivre le programme égyptien. La situation perdura jusqu’en 1967. En effet, suite à la Guerre des Six Jours et à l’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-est et de Gaza, l’éducation passa sous l’administration des autorités israéliennes. Cependant, les programmes jordanien et égyptien continuèrent à être suivis en Cisjordanie et à Gaza durant les premières années suivant la guerre des Six Jours.
À partir de ce moment-là et jusqu’à la création de l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) dans les années 90, il existait trois types d’écoles dans les territoires occupés : les écoles gouvernementales sous le contrôle de l’autorité de l’Administration Civile israélienne, les écoles de l’UNRWA, organisation des Nations Unies mise en place pour venir en aide aux réfugiés palestiniens, et enfin les écoles privées, la plupart du temps instituées par des ordres religieux. Mais cette division n’était pas satisfaisante semble-t-il et suite aux Accords d’Oslo en 1993, la naissance de l’ANP et la création du Ministère de l’Éducation palestinien, le nouveau défi de l’éducation palestinienne a été pris au sérieux. Il s’agissait d’une tâche difficile, celle d’unifier les différents programmes de Gaza et de la Cisjordanie afin de créer de toutes pièces un nouveau programme proprement palestinien. Un travail qui prit plusieurs années.
Tandis que le programme palestinien s’attache à construire l’identité nationale du futur État palestinien, de son côté le programme israélien, s’attèle à consacrer l’identité juive d’Israël. Le problème est d’expliquer aux futures générations scolarisées à qui appartient cette terre que chacun revendique pour sienne.
Quelle grille de lecture ?
« En tant que professeur d’Histoire je me vois dans l’obligation de dire à mes élèves que leurs livres scolaires ne sont pas sans partis pris » rapporte Madame Lillia Musleh, professeur d’Histoire au collège allemand de Jérusalem, Schmidt College. Cette professeur, venue enseigner à Jérusalem dans ce collège mais qui n’est ni juive ni palestinienne poursuit : « La première question que je pose à mes élèves est d’identifier de quel point de vue se situe le livre. Tout au long de l’année scolaire, je les invite à ne pas perdre de vue quel est l’auteur du livre, surtout à l’heure où il s’agit d’interpréter les faits historiques que nous avons au programme », poursuit-elle. Le collège prépare les élèves de Première et Terminale soit au Tawjihi (équivalent du baccalauréat), l’examen requis par le programme palestinien, soit à l’examen GCE (General Certificate of Education) de Grande-Bretagne. « Jusqu’en 2010, j’ai utilisé des livres scolaires britanniques, et d’ailleurs j’enseignais en anglais », affirme Mme Musleh. Le livre utilisé par la classe de Première, auprès d’élèves âgés de 16 ans en moyenne, est « Le conflit israélo-arabe » de Tony Rea et John Wright. « Je l’avais choisi car il me semblait que les auteurs s’efforçaient d’exposer aux lecteurs les deux points de vue qui trop souvent s’excluent mutuellement. Et en aucun cas ils n’essayent d’endoctriner, bien au contraire, ils encouragent les lecteurs à arriver à leurs propres conclusions » souligne la professeur, non sans ajouter qu’il est important de rappeler que ses élèves ont un cours sur la Seconde Guerre Mondiale et l’Holocauste avant de commencer à aborder le conflit israélo-palestinien.
Mais ce qui est possible à titre expérimental dans une école privée chrétienne est-il exportable ? Un programme commun aux Palestiniens et aux Israéliens où seraient exposées les deux grilles de lectures de l’histoire aiderait sans aucun doute à transformer les idées reçues que les uns ont des autres. Mais à l’heure actuelle, cette possibilité n’est pas envisagée, pas même dans un horizon lointain. Le problème est que ni les uns ni les autres ne sont disposés à renoncer à l’influence sociologique, conçue comme une arme, que représente le contrôle du programme académique. Céder consisterait alors à devoir raconter l’Histoire à la lumière de la vérité, ce qui pour chacun des deux groupes voudrait dire renoncer à la raconter de leur seul point de vue subjectif et affectif.
Dans tous les cas, la véritable difficulté réside dans le fait qu’il y a encore des sujets qui ne sont pas clairs et qu’il est donc difficile d’inclure dans les livres, notamment les questions des frontières d’Israël et du futur État palestinien, le statut de Jérusalem, la gestion conflictuelle de l’eau, ou le statut des réfugiés palestiniens. Il y a des choses semble-t-il que l’on apprend mieux en étant confronté à la réalité de la vie que sur les bancs de l’école.
Les uns comme les autres l’affirment dès que l’on aborde le thème du conflit : « Nous n’apprenons rien sur ce qui se passe, nous le vivons tous les jours… Nous avons tous perdu des êtres chers dans ce conflit ». L’affirmation est aussi juste dans la bouche d’un Israélien que d’un Palestinien, c’est pourquoi il est si difficile de s’asseoir pour négocier, d’essayer de regarder de l’avant lorsque durant toute une vie on vous a obligé à regarder en arrière, pour ne pas oublier. S’il y a une chose que ces deux peuples ont en commun en plus de cette terre, c’est bien la souffrance.
L’histoire se conjugue au présent
« La première fois que j’ai appris l’existence du conflit ?… Je ne crois pas l’avoir appris à l’école, j’ai grandi en étant conscient de cet état de faits » rapporte un étudiant israélien de 17 ans qui préfère garder l’anonymat. « Je me souviens que lorsque j’avais 5 ou 6 ans, un kamikaze s’était fait exploser dans le centre commercial à côté de chez moi » raconte-t-il. « C’est depuis ce moment, je crois, que nous suivons tous le conflit à la maison, en regardant les informations, ce qui explique aussi que généralement les jeunes adoptent le point de vue de leurs parents » conclut-il. Preuve encore que les leçons tirées de la réalité sont plus faciles à apprendre que celles des livres. Et il en est de même pour les étudiants palestiniens de l’autre côté du mur de séparation. La présence constante de l’occupation israélienne, les incursions nocturnes de l’armée et surtout les attaques militaires dans la bande de Gaza ont été leurs professeurs d’histoire et ils n’ont pas besoin d’en savoir plus : les « autres » sont leurs ennemis.
Ce même jeune israélien de 17 ans, sur le point de commencer son service militaire, répond avec sincérité à la question de l’image qu’il a des Palestiniens. « Il va de soi qu’en vivant ici et en voyant constamment les informations à la télévision qui nous montrent des terroristes, on finit par voir les Palestiniens comme ça, comme des ennemis, toujours en conflit ».
Une jeune israélienne de la région de Ra’anana explique que le conflit fait partie de sa vie. « Je me souviens avoir entendu parler d’attaques terroristes presque tous les jours, et surtout je me rappelle comment ma mère, toujours inquiète, ne nous laissait pas aller dans les endroits où il y avait beaucoup de monde, elle évitait toujours les foules, par peur des attentats ». Cependant, au collège, son professeur d’histoire a toujours exposé les deux points de vue. « D’un côté il y a avait l’occupation israélienne de la Palestine rendant la vie des habitants si misérable que la tension grandissait et faisait croître la probabilité d’attaques terroristes. Et de notre côté, Israéliens, nous ne pouvons pas baisser la garde parce que sinon nous serions dans une situation bien pire encore ». À la fin de la discussion, cette jeune israélienne n’hésita pas néanmoins à proposer une alternative à cette vision réductrice que les uns ont des autres. « Le mieux serait d’essayer de voir les choses de l’autre côté, ce que pensent les autres et ce qui les incite à agir de cette façon ».
Une formation partiale et insuffisante
De son côté, Haia Dakwar, jeune de Galilée âgé de 17 ans appartenant aux 1,5 million d’Arabes qui vivent dans les territoires israéliens, raconte comment il a aussi grandi avec le conflit, mais de manière différente. « Mon grand-père a été expulsé de sa maison pendant la guerre et il nous a souvent raconté son histoire lorsque nous étions petits, nous savions ce qui était arrivé » explique-t-il. Haia convient néanmoins avec les étudiants israéliens que la formation reçue sur le conflit à l’école reste insuffisante.
Les critiques du programme éducatif israélien retiennent l’omission de certains faits historiques, comme par exemple l’absence totale de référence à l’occupation de la Cisjordanie. Il est clair que quiconque considère sienne la totalité d’une terre, ne s’y référera pas avec l’expression « occupation ». Le bât blesse côté également israélien lorsque les juifs appuient l’identité juive d’Israël sur une représentation caricaturale des Arabes désignés comme des personnes « primitives » et « non civilisées ». Comme l’explique Monsieur Fadel Jubran, de la Faculté d’Éducation de l’Université de Bethléem, spécialiste de la représentation des Palestiniens et des Israéliens dans les livres scolaires, citant une étude de 2005 publiée par Bar-Tal et Teichman : « le Ministère israélien donne les grandes lignes pédagogiques et scolaires comme des objectifs sociaux à atteindre, tandis que le contenu des livres scolaires quant à lui reflète la connaissance que le groupe dominant de la société essaye de répandre parmi ses membres ».
«En définitive, poursuit M. Jubran, les livres scolaires ont un rôle considérable dans la manière dont se constitue et se développe la mémoire collective des habitants d’un pays. Pour ce qui est d’Israël et de la Palestine, l’alternative consisterait peut-être à mettre en place un troisième programme qui, comme le suggèrent les experts, exposerait les deux points de vue. Le fait de se mettre dans la peau de l’« autre », même si nous ne nous partageons pas les mêmes idées, pourrait être le point de départ d’une compréhension plus grande de la situation. En tous cas, il est clair que l’image de l’« autre » telle qu’elle est présentée par ces deux programmes antinomiques est inquiétante, et que les futurs négociateurs de paix devront apprendre à comprendre leur adversaire s’ils veulent un jour aller plus loin que leurs prédécesseurs dans cette lutte pour trouver une solution viable au conflit.»
Jérusalem, un cas à part
Lorsqu’en mars dernier, les écoles privées de Jérusalem-Est qui perçoivent des subventions israéliennes reçurent une notification du Ministère de l’Éducation à propos des changements pour l’année académique 2011-2012, personne ne s’est vraiment réjoui. En effet, dès la rentrée, ces écoles se sont trouvées dans l’obligation d’utiliser uniquement les livres préparés par l’Administration Éducative de Jérusalem (JEA), branche de la Municipalité et du Ministère.
La situation à Jérusalem reste singulière dans la mesure où quatre autorités distinctes dirigent le système éducatif de la ville : le Ministère israélien, le WAQF islamique, le secteur privé et l’UNRWA, cette dernière s’adressant exclusivement aux réfugiés palestiniens. Il y a aussi deux programmes différents, selon les écoles. De 1948 à 1967 le programme jordanien était encore suivi à Jérusalem, puis l’éducation passa sous contrôle israélien jusqu’aux années 90 et les Accords d’Oslo, date à laquelle la ville sainte commença à utiliser le programme palestinien.
Jérusalem compte 50 écoles et 38,785 étudiants. 48 % des étudiants palestiniens de Jérusalem en dépendent.
Écoles privées à Jérusalem : 68 qui scolarisent 22,500 étudiants palestiniens.
Dernière mise à jour: 31/12/2023 21:08