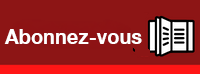La porte du couvent arménien franchie, un nouveau monde s’offre à la vue du chanceux visiteur. Un lieu séparé du reste de la chaotique vieille ville de Jérusalem, et dont la tranquillité fut conservée pendant des siècles par la petite communauté qui y réside. Aujourd'hui, on compte près d’un millier d’habitants dans le quartier arménien, soit dix fois moins qu’en 1948.
Au milieu des rues et ruelles parcourues par les touristes entre la porte de Jaffa vers le mont du Temple, le couvent arménien est une cité dans la cité, un ieu qui bien souvent reste inaccessible aux touristes et aux étrangers. Ce quartier arménien, qui fait partie intégrante du centre historique de Jérusalem, possède son jardin secret.
Pour visiter la petite enclave, un seul moyen : trouver un guide parmi le millier d’habitants du quartier. Ici, un jeune Arménien, Apo Sahagian, accepte de tenir ce rôle. À l’entrée, deux touristes sont arrêtés par l’un des gardes : entrée interdite.
Dans les premières heures de l’après-midi, le quartier est calme, rares sont les passants au milieu des deux places et des ruelles du couvent, à part quelques prêtres vêtus de noir. C’est samedi, la messe dans la cathédrale de Saint-Jacques est sur le point de commencer. À l’intérieur : une douzaine de religieux ouvrent la cérémonie. Au centre de l’église, un fauteuil attend le patriarche, qui fera son entrée parmi les fidèles dans quelques minutes.
« L’église de Saint-Jacques représente pour nous le début et la fin » explique Apo, 23 ans, musicien et auteur de nouvelles. « C’est ici qu’ont lieu les baptêmes, et c’est ici qu’ont lieu les funérailles. La vie d’un arménien de Jérusalem commence et s’achève dans cette église ».
La visite continue : autour de la place principale – «notre place Tahrir », selon Apo – on y trouve deux bibliothèques, l’ancienne imprimerie et une clinique. Juste avant le bureau de poste, juste après le musée. Tous les bâtiments sont en pierre blanche, comme le reste de la vieille ville. Les balcons et les escaliers sont colorés de pots de fleurs et de cactus. Tout appartient au patriarcat, qui gère le quartier arménien depuis l’époque des Croisades, lorsque les Arméniens ont commencé à migrer en Palestine : «Chacun de nous possède une maison, nous pouvons en faire tout ce que nous voulons, sauf la vendre », explique le jeune guide.
Vendre à un non-Arménien ne serait pas toléré. La communauté, présente depuis des siècles, reste aux prises d’une non intégration volontaire : une minorité entre deux peuples en conflit. Ce qui s’explique par la nécessité de maintenir en vie leur identité, de préserver leurs racines, et de ne pas perdre le lien qui les unit aux communautés arméniennes dispersées dans le reste du monde arabe.
Le choix des Arméniens vivant à Jérusalem, à l’intérieur des murs de la vieille ville, est symbolisé par le quartier fermé dans lequel ils résident. A l’intérieur, on trouvera tout ce qu’il faut pour mener une existence indépendante et sans ingérence extérieure.
«Aujourd’hui en Palestine on compte quatre communautés arméniennes – explique Apo. Outre celle de Jérusalem, les Arméniens vivent aussi à Jaffa, Haïfa et Petah Tikva. Les origines sont diverses, chaque communauté s’est installée dans différentes périodes historiques, toutes liées aux déportations, aux exils et aux massacres. Le noyau de la communauté est née au cours de la période des Croisades : ce sont les Kaghakatsiner, les plus intégrés dans le monde arabe, parce que présents depuis des siècles. La seconde vague d’immigration a suivi le génocide perpétré par la Turquie, à partir de 1915 : les descendants des survivants sont appelés Kakhtaganer, ce qui signifie réfugiés. Je suis l’un d’eux, mon grand-père a fui la Turquie en 1921 après avoir été déporté au Sud. Il voulait gagner la France, mais après une escale au port de Jaffa, il a décidé de rester ».
La troisième phase de la migration remonte à 1991, lors de l’effondrement de l’Union soviétique : les Arméniens de Russie, les Hayastantsiner, ont atterri en Israël. Bien que chrétiens, beaucoup d’entre eux se sont déclarés juifs pour pouvoir immigrer, mais ils n’ont pas cherché à s’intégrer.
« Ces arrivées en plusieurs phases ont créé un symptôme de séparation partielle au sein de la communauté » continue Apo. Il existe une cinquième communauté arménienne, à Bethléem. Mais elle est ici depuis si longtemps qu’elle s’est arabisée. Beaucoup de membres portent des noms et des prénoms d’origine arabe, c’est pourquoi le reste de la population arménienne ne les considère pas comme arméniens. La fermeture vers la société extérieure est presque totale : jusque dans l’utilisation de la langue. Les Arméniens parlent arménien et anglais, mais ils s’expriment difficilement en arabe ou en hébreu, alors qu’ils connaissent très bien les deux langues ».
Le couvent qui se trouve au cœur du quartier est lui aussi un espace fermé. A l’intérieur, il y a des clubs de jeunes, une école qui enseigne tous les grades, une clinique, deux bibliothèques, l’église et la cathédrale, le cimetière et un musée. Le nécessaire pour vivre de façon autonome.
« Il y a très peu d’enfants qui ont des amis arabes ou juifs à l’extérieur. Une forme de protection de l’identité, qui sombre dans la peur de l’autre. Les Juifs nous considèrent comme des étrangers, les Arabes nous associent aux Israéliens. Il suffit de regarder par quels termes nous les nommons : il est difficile pour nous de parler de « Palestine », d’ « Israël », de « palestiniens » ou d’ « israéliens ». Pour nous, ce sont des arabes ou des juifs, et c’est tout. Inconsciemment, nous maintenons ainsi une distance avec le conflit, auquel nous n’avons pas l’intention de participer. Les Arméniens se sentent écrasés entre deux autorités différentes, et choisissent la neutralité ».
Par conséquent, la conception est la même pour Jérusalem : le rêve de la communauté arménienne est de voir un jour la ville sainte ouverte, internationale. « D’une certaine manière les Arméniens sont les seuls à avoir adoptés l’identité socio-politique de Jérusalem – continue Apo – Jérusalem comme un pont entre les immigrés et les autochtones. Nous nous définissons comme des « jérusalémites », et je pense que notre vision de la ville est la plus enracinée. Dans le cas d’un accord entre Israéliens et Palestiniens, ce que nous voulons, c’est une Jérusalem ouverte à tous, et non pas la capitale d’un État ou d’un autre. Cela nous permettrait de préserver notre identité, mais aussi de renforcer les liens avec les communautés arméniennes du le Moyen-Orient, à Beyrouth, à Damas, à Alep ».
« Si nous étions obligés de prendre parti, nous évaluerions la meilleure option en fonction de nos intérêts. Et finalement, c’est le patriarcat qui déciderait. À l’intérieur de la communauté, toute décision importante est prise collectivement. Placer les besoins du groupe avant ceux du particulier est encore une fois une manière de préserver l’identité ethnique et nationale ».
Pourtant, malgré le désir de séparation, la communauté arménienne s’ouvre lentement à l’extérieur : «Les Arméniens qui se marient avec des chrétiens palestiniens sont de plus en plus nombreux. Une «menace», surtout lorsque c’est la mère qui est palestinienne, car elle passe plus de temps que le père avec les enfants, qui finissent par se sentir plus arabes qu’arméniens ».
A cela s’ajoutent les difficultés typiques de ceux qui vivent dans ce pays : les Arméniens – minorité ethnique – sont confrontés à la même réalité qui réside à l’extérieur de l’oasis du couvent. La guerre de 1948, puis celle de 1967 ont frappé la communauté, la réduisant de manière significative : ils étaient 10 000 habitants en 1948 à Jérusalem, et aujourd’hui ils ne sont plus qu’un millier. La première vague de migration vers l’Europe et les États-Unis remonte à 1948, à la Nakba et à la naissance de l’État d’Israël. Puis, la guerre des Six Jours (1967) et l’occupation israélienne de Jérusalem-Est ont divisé la communauté : certains ont aujourd’hui la citoyenneté israélienne, d’autres doivent se contenter d’un droit de résidence à Jérusalem, tout comme les Palestiniens de la ville. Loin, mais tout près.