
Dans un ouvrage très documenté de presque 800 pages consacré à “la ville trois fois sainte”, le journaliste Marius Schattner et l’historienne Frédérique Schillo s’attachent à raconter les “ruses” de l’archéologie, quand les découvertes ne répondent pas aux attentes des savants ni surtout à celles de leurs sponsors - institutions, mécènes, etc. - qui financent leurs travaux.
Il est fréquent que les fouilles n’étayent pas les récits nationaux, la pierre contredit le Livre. Entre la science et la foi le choc est inévitable mais pas à sens unique.
Dans votre livre, il est beaucoup question des ruses de l’archéologie à Jérusalem, qu’entendez-vous par “ruses” ? Des exemples ?
Marius Schattner : Comme toute science l’archéologie a sa propre logique. Les résultats des fouilles ne sont pas toujours conformes aux attentes des archéologues et encore moins des institutions qui financent leurs travaux, qui ont souvent leur propre agenda. Cela n’enlève rien à leur valeur, car de ces contradictions peuvent naître de nouveaux paradigmes.

Frédérique Schillo : Le Tombeau des Rois en fournit le premier exemple. L’archéologue français Félix de Saulcy croit avoir découvert le tombeau des rois de Juda, alors que l’hypogée qu’il a étudié – et il est le tout premier à fouiller à Jérusalem en 1863 – ne date que de l’époque romaine.
MS : Autre exemple, contemporain cette fois : les fouilles de surface menées en Cisjordanie après sa conquête par Israël en juin 1967, menées par le professeur Israël Finkelstein. Elles ont renforcé la thèse de l’émergence graduelle d’une population israélite dans les hautes terres de Canaan, contraire au mythe biblique d’une conquête sanglante par Josué, repris au XXe siècle par le jeune État d’Israël.
Vous tracez un portrait plutôt flatteur du père Lagrange. Incarne-t-il à vos yeux un modèle de critique entre foi et raison (dans le contexte de son époque) ?
MS : Je dirais plutôt une figure attachante et, dans un sens, tragique. Il aspirait à associer la science et la foi mais se soumettait aux contraintes draconiennes du Vatican. Un projet irréalisable en son temps, ce qui lui a valu les foudres de l’Église et des menaces d’excommunication.
Des archéologues israéliens continuent de faire des découvertes importantes, sans exclusive ni préjugés religieux ou idéologiques. Sont-ils écoutés, reconnus, aujourd’hui face à leurs collègues religieusement/idéologiquement motivés et au récit national israélien ? Ou bien silenciés ? Instrumentalisés ?
FS : On ne peut pas réduire les débats en cours chez les archéologues israéliens à une opposition entre scientifiques éclairés d’un côté et fanatiques ultra-nationalistes de l’autre. Pour commencer, le mythe de l’archéologue fouillant la pioche dans une main, la Bible dans l’autre, a fait son temps. Seule une minorité travaille encore ainsi. Une des figures les plus frappantes de ce courant était l’archéologue Eilat Mazar, une scientifique reconnue, issue d’une grande lignée d’archéologues, à qui l’on doit des découvertes importantes. Mais elle disait aussi avoir identifié le palais du roi David ; thèse réfutée par l’immense majorité de ses confrères.
MS : Paradoxalement, ce sont les archéologues les plus engagés dans la construction d’un récit national israélien, financés par des organismes visant à “judaïser” des quartiers de Jérusalem, qui se retrouvent en minorité. Début avril, quand le gouvernement a voulu interdire la participation d’un chercheur critique de la colonisation au fameux colloque annuel de l’Israël Exploration Society (IES), ses membres ont préféré annuler carrément la rencontre. Fait sans précédent. Jamais on n’avait vu une telle instrumentalisation politique de l’archéologie en Israël, mais jamais non plus elle ne s’était heurtée à une résistance aussi unanime.

Un exemple du choc entre science et foi est l’ouverture du tombeau présumé du Christ. Vide. L’archéologue grecque qui a présidé aux travaux a affirmé que tous les instruments électroniques avaient cessé d’émettre. Et si c’est elle qui avait raison ?
FS : La question n’est pas tant de savoir si elle a raison ou tort, mais comment se fabrique une légende. La scientifique aurait pu ne pas rapporter ce fait, si tant est qu’il s’est produit de la façon dont il est relaté. Elle aurait pu aussi en parler en invoquant des raisons techniques, mais elle a choisi le mystère. Ici, c’est la foi qui opère. C’est absolument fascinant à observer et cela nous renvoie, inconsciemment, à d’autres récits légendaires de la Terre Sainte.
Vous écrivez que pour les Palestiniens, l’archéologie revient à “Fouiller sans terre”. Peut-on décoloniser l’archéologie en Terre Sainte ? La dépolitiser ?
MS : Côté palestinien, la situation est dramatique. Les chercheurs ne peuvent fouiller en principe que sur 40 % du territoire de la Cisjordanie et Jérusalem leur est interdite. En pratique encore moins. Sans compter l’absence de moyens, en dépit d’un soutien venu de l’étranger et de la présence d’équipes internationales. Ils doivent aussi tenir compte d’impératifs politiques internes et font face à un dilemme : comment traiter objectivement de l’ancien Israël quand l’archéologie sert à leurs ennemis comme titre de propriété et pour nier leurs droits sur ce territoire ?
Les enjeux (géo)politiques ne sont jamais loin de l’archéologie : quelle(s) leçon(s) tirer des tensions récurrentes autour du Tombeau des Rois ?
FS : Le Tombeau des Rois fait partie des quatre domaines nationaux français avec l’église Sainte-Anne, l’Éleona et l’église d’Abou Gosh. C’est le seul à ne pas être lié au christianisme : on y trouve le mausolée généralement attribué à la reine Hélène d’Adiabène, une reine juive kurde du Ier siècle, dont le sarcophage a été rapporté par de Saulcy au Louvre, ainsi que la tombe d’un saint juif du Ier siècle. Le problème vient du fait qu’il se trouve à Jérusalem-Est, dans la partie conquise en 1967 par Israël et annexée en 1980. Or la France n’y reconnaît pas la souveraineté israélienne. Deuxième pomme de discorde : le site a été acheté par les frères Péreire “pour le conserver à la science et à la vénération des enfants d’Israël”, puis légué à la France en 1886. Aujourd’hui il est ouvert à tous publics, sur simple inscription, et il n’a pas vocation à devenir un lieu de prières juif. Cela n’empêche pas des groupes ultra-nationalistes et religieux de revendiquer, parfois violemment, le caractère sacré du site pour contester le droit de propriété de la France.
“Nous rêvons d’une archéologie qui ne soit pas un instrument de conquête, de revanche, mais d’un pont, et on en est loin”, écrivez-vous. La science a-t-elle définitivement perdu ?
Au moment où l’archéologie appuie et justifie toutes les revendications identitaires/nationalistes ?
FS : C’est précisément au moment où l’archéologie est érigée comme arme politique, une véritable arme de destruction massive de l’Autre, qu’il faut en rappeler le sens premier : mettre au jour le passé, sans négliger aucune période. C’est en reconnaissant la présence de l’Autre dans l’Histoire que l’on pourra commencer à lui faire une place dans le présent.
De votre point de vue, de la pierre ou du Livre, qui gagne à la fin ?
FS : La pierre, mais même dans sa confrontation avec le Livre, elle lui reste indissociable. Quand les Britanniques ont décidé que tous les bâtiments de la Ville sainte devaient être construits en pierre de Jérusalem afin de recréer, ou plutôt de façonner, un lien sensible et palpable avec le passé antique de la Ville, même le visiteur le plus détaché de la religion ne peut aujourd’hui que s’en émouvoir.
Après ce livre, avez-vous encore “la foi” dans l’archéologie ?
MS : Encore plus qu’avant. Car en dépit de l’instrumentalisation dont elle continue de faire l’objet, l’archéologie met au jour des découvertes importantes, interpelle nos visions de l’Histoire et pose de nouvelles questions.
FS : Assurément, et cette foi vient des avancées techniques extraordinaires réalisées par les archéologues israéliens, dont on peut critiquer beaucoup de choses mais certes pas la rigueur scientifique. Israël est de ce point de vue à la pointe de la recherche.
En conclusion, face au risque de l’instrumentalisation politique ou religieuse, Marius Schattner et Frédérique Schillo plaident avec conviction pour une archéologie “qui ne soit pas un instrument de conquête ou de revanche mais un pont” entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd’hui, en plein massacre à Gaza, au moment où la colonisation s’accélère en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée, il est à craindre que ce passionnant plaidoyer reste un vœu pieux.
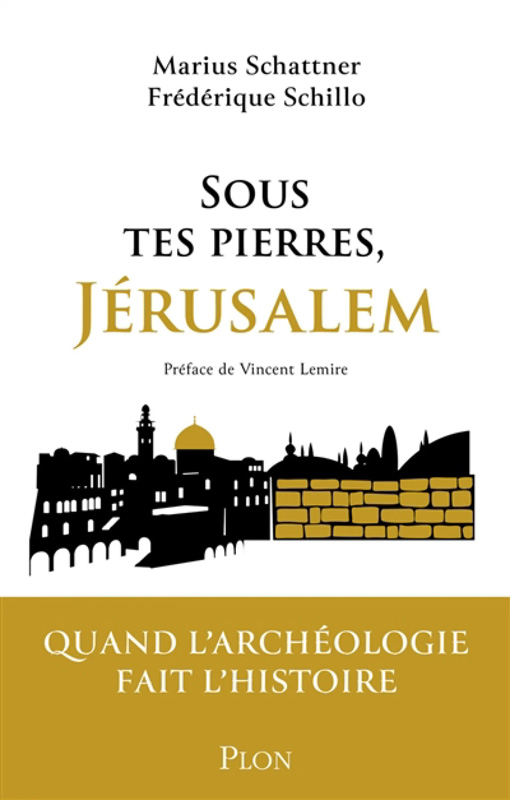
Sous tes pierres, Jérusalem
Auteurs : Marius Schattner, Frédérique Schillo
Préface de Vincent Lemire
Éditeur : Plon 2025
ISBN
22 59 25 31 56, 97 82 25 92 53 154
749 pages
Marius Schattner est journaliste, ancien correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) à Jérusalem. Auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-arabe (La Guerre du Kippour n’aura pas lieu – André Versaille, 2013) et la société israélienne (Israël, l’autre conflit – André Versaille, 2008-).
Frédérique Schillo est historienne, spécialiste d’Israël et des relations internationales. Co-autrice de La Guerre du Kippour n’aura pas lieu –
André Versaille, 2013-.


