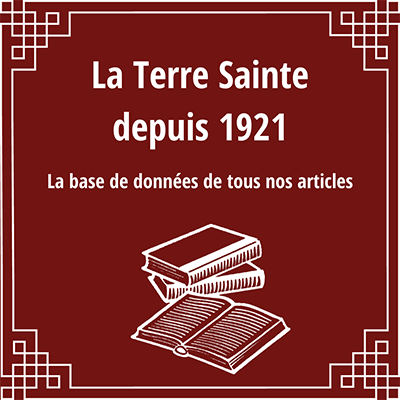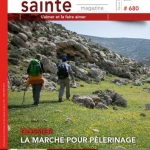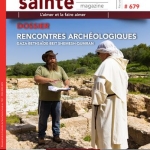Trois sites archéologiques sont supposés être Bethsaïde, la ville perdue des apôtres Pierre et André. La découverte, à l’automne 2021, d’une église byzantine qui pourrait recouvrir la maison des deux frères, rend celui d’El-Araj, situé sur les rives nord du lac de Tibériade, plus prometteur.
Iota, alpha, kappa. IAK. L’inscription n’est que parcellaire, mais les archéologues sont formels. C’est bien le mot grec « diakonos », diacre, qui se détache du fragment de mosaïque qu’ils viennent de mettre au jour. Un peu plus loin, dans un autre carré de fouille, ils ont trouvé une belle dédicace à un évêque faisant état d’une rénovation de l’édifice. Le tout dans un style richement décoré propre à l’époque byzantine (IV-VIIe siècles ap. J.-C.). Les archéologues qui fouillent le site d’El-Araj depuis 2014 sont aux anges : « Il n’y a plus aucun doute, une église se dressait bien ici à l’époque byzantine », s’enthousiasme Mordechaï Aviam, le directeur des fouilles issu du Kinneret College. Et il ne s’agirait pas de n’importe quelle église : grande et décorée avec goût, elle pourrait recouvrir les restes de la maison de Pierre et André, disciples de Jésus originaires de la ville de Bethsaïde que l’on croyait perdue.
Lire aussi >> Bethsaïde: la ville perdue des Apôtres, retrouvée
À l’époque du Christ, c’est un petit port de pêche sans prétention qui acquiert le statut de polis par décision de Philippe le Tétrarque, gouverneur de la région en 30 ap. J.-C. L’historiographe Flavius Josèphe raconte que la ville est à cette occasion rebaptisée « Julias », en l’honneur de la fille de l’empereur Tibère. Les évangiles relatent qu’en plus d’avoir vu naître plusieurs des disciples, Bethsaïde est le lieu du miracle de la guérison d’un aveugle (Mc 8, 22-26) avant d’être condamnée par Jésus pour son manque de foi (Mt 11, 21).
Église des apôtres
C’est un certain Willibald, évêque bavarois en pèlerinage en Terre Sainte en 725, qui mentionne le premier l’existence d’une église sur le site : “Et de là, ils se rendirent à Bethsaïde, la résidence de Pierre et André, où se dresse maintenant une église sur le site de leur maison”, dit son récit de voyage, connu sous le nom de Hodœporicon. “Les éléments concordent et nous encouragent à faire le lien entre les deux édifices”, avance prudemment Mordechaï Aviam.
Ces découvertes s’accompagnent toutefois d’un mystère. Les murs originaux de l’église ont disparu, remplacés par d’autres, qui, plutôt que d’entourer les mosaïques, les traversent en les coupant. Plus étrange encore, aucun d’eux n’est doté de portes. À ce stade, impossible de savoir à quand remonte leur construction, ni quelle était leur utilité. “Le grand tremblement de terre qui a frappé la région en 749 a probablement détruit l’église, explique le directeur des fouilles. À partir de là, nous avons deux hypothèses : soit les Croisés se sont servi des fondations restantes pour y élever leur sucrerie, la structure sans porte pouvant alors correspondre à la cave de cette usine ; soit on a voulu protéger les mosaïques en les scellant entre des murs.”
Toujours est-il qu’après 749 et la conquête musulmane, l’église et la ville de Bethsaïde sont tombées dans l’oubli. “Ce fut le cas de nombreux petits lieux saints du christianisme qui n’avaient pas l’aura de Nazareth, Bethléem ou Jérusalem”, glisse Mordechaï Aviam.
Depuis le XXe siècle, la compétition est acharnée pour retrouver ce qu’il reste de la ville perdue. Trois sites clament, à ce jour, être Bethsaïde : Messadiye, Et-Tell et El-Araj. Si le premier est le candidat le moins probable, faute de découvertes suffisantes, le second est fouillé depuis plus de 30 ans et possédait jusqu’en 2017 le titre de favori. C’est à cette date, et après seulement trois ans de fouilles, que l’outsider El-Araj a fait une percée avec la mise au jour d’un bain public datant de l’époque romaine.
Creuser plus
La preuve, selon l’archéologue du Kinneret College, que la ville s’est dotée d’infrastructures typiquement romaines après son élévation au rang de cité : “Nous avons aussi découvert une habitation datant de la période romaine à une centaine de mètres de l’église, et une étude géophysique a montré que toute la zone était urbanisée”, indique l’archéologue en désignant une large plaine de la main : “Une vraie ville s’étendait ici. Et il s’agissait de Bethsaïde-Julias.”
Autre point fort du site : sa proximité avec le lac de Tibériade. “Et-Tell est situé à plus de 2 km du lac. C’est improbable pour un village de pêcheurs”, souligne frère Dominique-Marie, de l’École biblique et archéologique française à Jérusalem. En 30 années de fouilles, ce site, perché sur une colline, a surtout dévoilé d’incroyables fortifications datant de l’âge du Fer. Rami Arav, directeur des fouilles à Et-Tell depuis 1987 estime ainsi avoir découvert la capitale du royaume biblique de Geshur, qui coexistait avec le royaume de David au Xe siècle avant notre ère (livres de Josué et de Samuel). Les découvertes relatives à l’époque romaine sont plus modestes : “Des pièces frappées des noms de Philippe le Tétrarque et de Julia, un probable temple, quelques habitations… Rien qui atteste vraiment la présence d’un centre urbain contemporain de Jésus”, avance Mordechaï Aviam.
Chaque archéologue prêche pour sa paroisse. Pour Rami Arav, El-Araj n’était qu’un camp militaire au Ier siècle ap. J.-C. : “Les bains publics n’existaient pas dans le sud du Levant à cette époque. Les premiers ont été construits dans des camps”, pointe l’archéologue d’Et-Tell. Néanmoins, de plus en plus d’experts s’accordent pour dire que le site reste prometteur. “Il nous faut creuser encore, et plus profond, pour atteindre la période romaine et peut-être la fameuse maison des apôtres. Comme à Capharnaüm !”, se projette déjà Mordechaï Aviam. Les trouvailles faites durant cette cinquième saison de fouilles devraient encourager le financement d’une sixième en 2022. El-Araj est loin d’avoir livré tous ses secrets.
Dernière mise à jour: 20/05/2024 15:22