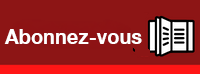Peut-être Abdel Mohsin al-Qattan a-t-il choisi lui-même ce lieu. Au sommet d’une crête trône un cube de verre et d’acier, haut de cinq étages – le centre de la fondation dont il rêvait depuis des décennies. De là-haut, la vue embrasse, sous des cieux tourmentés, une plaine immense. Cinquante kilomètres plus loin, une petite ville apparaît à contre-jour, devant la Méditerranée qui scintille. C’est Jaffa, le port de Jérusalem, l’un des berceaux du nationalisme palestinien, que la famille du philanthrope, né dans cette ville, a dû fuir lors de la guerre israélo-arabe de 1948 – pour ne plus jamais revenir.
Alors âgé de 19 ans, il étudiait les sciences politiques à Beyrouth. Il change de voie et choisit le commerce, pour subvenir aux besoins de sa famille réfugiée. Il lance ensuite une entreprise de construction au Koweït. Il amasse une fortune. Mais l’enfant de Jaffa n’oublie pas la Palestine. Il se lance dans la politique, entre au parlement de l’OLP, qu’il finit par quitter, déçu par les querelles de factions et le verrouillage du pouvoir par Yasser Arafat. Il décide de mettre ses moyens au service de la culture.

Une fondation culturelle entre tradition et modernité s’est inscrite dans le paysage. Des œuvres exposées, du public, le pari semble réussi pour que la Palestine développe cette dimension que représente sa culture propre. © Photos Qattan Foundation
En 1993 Abdel Mohsin al-Qattan lance une fondation au Royaume-Uni où il réside. Les débuts sont difficiles, entre l’euphorie des accords d’Oslo et les temps sombres des intifadas. À partir de 1998 les premiers projets voient le jour en Palestine. C’est la première étape. L’ambition : mêler à chaque fois culture et éducation en se concentrant sur les élèves, les professeurs et les jeunes artistes. L’organisation lance en 2000 deux bourses qui alternent chaque année, l’une pour les arts plastiques, l’autre pour l’écriture, en veillant à ce qu’elles assurent un soutien financier et l’aide à la réalisation concrète des œuvres. La fondation met en place des programmes d’été, des résidences d’artistes, des formations de théâtre pour les professeurs palestiniens, un centre éducatif à Gaza auquel 10 000 enfants sont inscrits…
La culture dans sa diversité
La deuxième étape, c’est ce bâtiment, pour centraliser les activités de la fondation. Ce cube de verre et d’acier est censé symboliser un phare. À la fois centre opérationnel des initiatives culturelles palestiniennes, espace de création et d’exposition, c’est aussi un lieu de vie. Il contient une bibliothèque, un amphithéâtre, des ateliers d’artistes, des espaces modulables, une galerie, des logements, un club de gym. Une vaste terrasse, sur laquelle on pose coussins et fauteuils en été, mène à un restaurant où les habitants de Ramallah viennent contempler au loin une mer à laquelle nombre d’entre eux n’ont pas accès, à cause des restrictions de déplacement. De près ou de loin, la fondation touche à présent 65 000 personnes, via ses différents programmes.

Les terrasses, c’est un mode de vie dans tout l’Orient, chaque maison a la sienne. Il ne pouvait en être autrement pour ce bâtiment culturel palestinien.
En bout de salle le portrait d’un homme pourfendu seuls ses yeux fatigués percent encore, de part et d’autre de la fêlure du tableau. Cette fracture est en lui et hors lui.
Dont Reem Masri, arrivée il y a deux mois dans le premier atelier, un vaste espace à l’immense baie vitrée, qui donne sur une crête plantée d’immeubles et d’oliviers. L’artiste plasticienne, 30 ans, le regard rempli de questions encore non résolues, travaille sur le même thème depuis huit ans : comment l’Occupation envahit à la fois le paysage et l’identité. “Je suis sans cesse en recherche. Ici, on me donne les moyens d’expérimenter. En Palestine, on manque de galeries, d’institutions pour nous soutenir”, dit Reem Masri, devant ses toiles, où un paysage sauvage apparaît hanté par des pans de murs translucides, qui ressemblent trait pour trait à ceux de la barrière de séparation israélienne qui enclot le territoire palestinien.
Les artistes trouvent ici un espace non seulement pour créer, mais aussi pour rechercher et sortir de leur isolement. “Ce n’est pas facile de s’imposer comme artiste auprès de sa famille. On n’est pas pris au sérieux. Ça ne ressemble pas à un vrai métier. Mais l’avantage ici, c’est que d’autres artistes palestiniens passent, et nous encouragent. On se sent moins seuls”, dit Rani Charabati, un peintre souriant de 22 ans, qui vient de terminer sa résidence de trois mois.
La fondation Qattan inscrit les artistes dans un réseau local et international, ce qui les aide à s’affirmer. Plus encore pour des femmes comme Rawan Bazbazat, 41 ans, créatrice de bijoux : “C’est normalement un métier d’homme. On me disait que c’était trop dur pour moi. Mais j’ai tenu bon. Je dirigeais des projets de développement. On se sentait toujours sous-estimé en tant que Palestinien, on ne faisait jamais les choses assez bien. Mais j’ai réalisé que nous avions un patrimoine exceptionnel dans la joaillerie, la Palestine a été une terre de passage, du Yémen au Maroc. Alors j’ai tout arrêté et je me suis formée. Pendant ma résidence j’ai travaillé sur les amulettes qu’on fabrique ici depuis des milliers d’années. C’est un domaine de recherche sans fin !”, s’enthousiasme la créatrice.

Rawan Bazbazat. © Photos Qattan Foundation
Construire un tel espace est en soi un miracle, dans le contexte de l’Occupation. Les meilleurs ouvriers travaillent côté israélien, où ils sont deux à trois fois mieux payés. Du retard s’est accumulé, à cause du matériel retenu aux douanes de l’État hébreu, qui contrôle toutes les entrées du territoire palestinien. Les étagères de la bibliothèque ont été mises de côté sans raison pendant trois mois. Du verre pare-balles pour les galeries, indispensable pour accueillir les prêts d’œuvres, n’était toujours pas arrivé lors de l’inauguration en 2018. L’ensemble a coûté quelque 18 millions d’euros. La fondation fonctionne avec un budget de 4,25 millions, issus du fonds Qattan, et de donateurs étrangers, comme l’Union européenne ou des ONG internationales… “Nous tenons à notre indépendance. Nous ne recevons pas d’argent de l’Autorité palestinienne, même si celle-ci envoie des éducateurs se former chez nous !”, dit Majd Hajjaj, cadre de la fondation.
Certaines critiques émettent l’idée que ces sommes seraient plus utiles ailleurs. “Même pour certains de nos propres concitoyens, nous semblons peut-être un luxe injustifiable, un phare décadent d’une culture étrangère, trop avant-gardiste et inadaptée à un environnement conservateur palestinien et arabe. Mais l’avenir recèle aussi beaucoup de potentiel. Comme de nombreux peuples de la région, nous restons une société jeune, pleine d’espoir, d’ambition et de dynamisme. La fragmentation causée par la guerre, les déplacements et l’exil n’a pas réussi à effacer notre cohérence en tant que société, même si elle l’a durement et violemment mise à l’épreuve”, écrit son directeur Omar al-Qattan, le fils d’Abdel Mohsin, dans un texte rappelant l’histoire de la fondation.

Rani Charabati. © Photos Qattan Foundation
Une peinture qui parle du pays
Les artistes sont régulièrement mis en valeur dans la galerie, la plus grande de Ramallah. Le jour de notre visite, deux expositions sont présentées. La première porte sur un projet de préservation du patrimoine architectural palestinien. La seconde, les tableaux des peintres soutenus par la fondation. Perchés sur des portants de fer stabilisés par de lourdes pierres brutes, ou pendus sur de lourdes tentures rouges, dans des salles sombres et silencieuses, ils illustrent une grande variété de styles. Dans les figuratifs on voit des œuvres marquées par une ruralité fantasmée, pasteurs dans le désert, vergers d’oliviers. Quelques portraits, un couple de pâles fedayin, des enfants sur des toits blancs. Un tank impressionniste progresse dans une ville indistincte, oppressée par des nuages anthracite. Parfois, c’est abstrait. Un tableau brille d’éclats de rouge sur des aplats jaunes et verts, traversé par des traits noirs et nerveux. En bout de salle le portrait d’un homme pourfendu – le support est traversé par une fêlure. Les épaules voûtées, les habits sombres recouverts d’arabesques, émergeant d’un tourbillon, son visage est méconnaissable – seuls ses yeux fatigués percent encore, de part et d’autre de la fêlure du tableau. Cette fracture est en lui et hors lui.
Par-dessus tout la fondation A. M. Qattan a réussi à s’imposer comme un lieu de vie. Malgré les restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus, qui heurte de plein fouet la Cisjordanie en cet hiver 2021, malgré le temps maussade, la bibliothèque est comble d’étudiants studieux. Le café-restaurant ne désemplit pas. Les enfants courent sur la terrasse. L’institution, encore jeune, vit au présent tout en pariant sur l’avenir.t
Dernière mise à jour: 04/04/2024 16:45