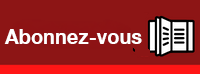Victorine Alisse: un regard sur ceux qui cultivent la Terre Sainte
Sa série photo s’intitule « Israël/Palestine : qui cultive la terre ? » Vingt clichés : 10 pris dans des kibboutz israéliens, 10 autres dans le village de Wadi Fukin, en Cisjordanie occupée, qui lui ont valu la Bourse du Talent 2022 et d’être exposée à la BnF jusqu’au 13 mars. Devenue photographe après un master en action humanitaire et relations internationales, Victorine Alisse a aujourd’hui à coeur de mettre en lumière les personnes marginalisées (monde de la rue, de l’agriculture…) grâce à ses « discussions photographiques ».
TSM : Questionner le lien à la terre a un sens particulier en Israël et en Palestine, où l’aspect territorial du conflit est enraciné dans les esprits. Qu’est qui vous a amené à documenter ce sujet ici ?
Victorine Alisse : Les grands parents de mes deux côtés étaient agriculteurs. J’ai moi-même grandi à la ferme. Cette curiosité autour de la relation qu’entretiennent les agriculteurs à leur terre est née après le décès de mon grand-père. En parallèle, j’ai découvert le travail de la photographe américaine Dorothea Lange, qui raconte la pauvreté dans les campagnes américaines. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire autour des agriculteurs en France. Il y a eu un premier projet photo, en 2020, baptisé “Le lien à la terre” avec un journal local “Terre et territoires”. Quant à la Terre sainte, j’y suis venue à 19 ans, lors d’un pèlerinage. On n’a pas la même perception d’un territoire en fonction du contexte dans lequel on est. On ne pose pas le même regard sur les choses. Ce n’est que plus tard, lorsque j’ai entendu parler de kibboutz et de moshav, ces structures agricoles traditionnelles en Israël, que je me suis dit que j’avais envie d’aller voir.
Lire aussi : Fatima Shbair: « Avec mes photos, j’essaye de raconter le vrai Gaza »
Quand on parle d’Israël et de la Palestine, les premières images qui viennent sont celles des champs en feu, des oliviers arrachés… Et c’est vrai. Mais moi ce qui m’intéresse, c’est le lien universel à la terre. Il n’y en a qu’une, mais elle est cultivée par deux populations en conflit depuis des années. Qu’est ce qui les y accroche ? Comment ils la perçoivent ? C’est ce que j’ai voulu interroger avec cette première série de photos, prises en novembre 2021 et en mars 2022. Elle cherche les ponts dans le travail de la terre entre Israël et les territoires palestiniens. Ce sont des faits, des témoignages, des constats.
Vous parlez de « discussion photographique » pour présenter votre travail, de quoi s’agit-il exactement ?
Lors de mes reportages, j’essaye de m’immerger au maximum dans les communautés qui m’hébergent, que ce soit dans les kibboutz ou dans les fermes palestiniennes. Je documente et photographie toutes leurs journées. Je partage des moments avec eux. Au retour, je trie, édite, et imprime mes photos, puis j’y retourne. Et je demande aux gens que j’ai rencontré d’écrire autour de leur portrait ou d’une autre photo, comment ils vivent leur lien à leur terre. Le fait de montrer des photos, ça fait avancer une discussion.

Après quelques jours en immersion dans le village palestinien de Wadi Fukin, Victorine Alisse y est retournée avec ses tirages pour recueillir les témoignages des habitants ©Cécile Lemoine/TSM
Par exemple, une femme du village Palestinien de Wadi Fukin a choisi une photo de la colonie de Beitar Illit, qui fait face au village. Elle a tracé plein de croix sur le tour. Une manière d’exprimer sa colère. Tout d’un coup, ces photos avec leurs écritures donnent tout son sens à la situation. Des personnalités se dessinent. La population agricole se raconte : on voit ceux qui ont étudié, qui sont capables d’écrire ou pas.
Et comment se vit ce lien à la terre de part et d’autre du mur, alors ?
En Israël, il y a une perte du lien : de moins en moins de jeunes veulent devenir agriculteurs. C’est un secteur qui reçoit peu d’aide de l’Etat… Le projet sioniste s’est pourtant nourri du travail de la terre. Les premiers juifs qui sont arrivés ici sont devenus agriculteurs. Par la suite, ils ont développé des technologies hyper performantes en gestion de l’eau. En l’absence de main d’oeuvre, les agriculteurs israéliens ont donc recours à des travailleurs thaïlandais, ou parfois palestiniens. Les salaires sont 3 fois plus élevés côté israélien. On est en plein dans la dimension économique : ces ouvriers travaillent la terre pour subvenir aux besoins de leur famille.
Lire aussi : Tensions en Israël : les Gazaouis interdits de venir y travailler
Daniel, un agriculteur retraité du Kibbutz Nahal Oz, près de la frontière avec Gaza, me racontait qu’il a choisi de vivre là pour être loin du bruit de la ville. Il s’y sent bien, alors qu’on est quand même dans une zone en tension. Dans sa perception du territoire, le conflit est parfois à peine abordé. La zone de tension, elle n’est pas notée. C’est complètement l’inverse chez les agriculteurs palestiniens. Un des hommes de Wadi Fukin a écrit un long texte autour de sa photo. Son message : “Il faut que je cultive ma terre, sinon l’occupation et les militaires vont me la prendre. »
Après 4 séjours, vous êtes de retour en janvier. Quelle va être la suite de votre travail ?
Après les « ponts », j’ai voulu aller de part et d’autre, en profondeur, creuser les spécificités. Mais j’ai du mal à m’arrêter (rires). J’aimerais retourner chez les agriculteurs de Tulkarem, qui habitent près du mur de séparation. Les faire écrire autour de leurs photos. L’idée de ce travail aussi, c’est d’aborder les problématiques spécifiques au monde agricole. La réalité est différente quand on est agriculteur dans une vallée au pied d’une colonie, ou près du Jourdain où la sécheresse est une problématique.
En Israël, j’aimerai retourner dans les kibboutz de Nahal Oz et de Saad. La façon dont s’entremêlent religion et terroir m’intéresse beaucoup. A la fin de la fête de Soukkot, les Juifs ont des prières en faveur de la pluie… Une deuxième série photo naitra de ces séjours. Mais rien n’est figé. Les photos existent sans les témoignages. Elles évoluent. Une photo vit à travers les rencontres. L’objet en tant que tel aussi ; l’objet abîmé, déchiré, a aussi un sens. Si un jour un agriculteur a ce geste, je la garderai déchirée, parce que ça veut dire quelque chose.
Il y a une vraie fibre sociale dans votre travail…
C’est comme ça que j’ai commencé. Je voulais porter la voix des gens. Il y a des univers dans la photographie, et c’est pour ça que je fais ce métier. Pour la rencontre. J’aime aller là où il n’y a pas grand monde. La photographie de presse est un monde exigeant. On construit des images. Moi j’essaye de déconstruire des façons de voir qui sont parfois ce que la presse attend, pour aller vers des choses plus vraies. Des témoignages de gens. Je ne me sens pas photojournaliste, mais photographe. Dans le sens où j’expérimente.♦
Le travail de Victorine est actuellement visible à la BnF, dans le cadre de l’exposition « La photographie à tout prix » organisé jusqu’au 12 mars. Détails et infos pratiques.
Rendre visible les marginalisés
Sa série photo s’intitule “Israël/Palestine : qui cultive la terre ?” 20 clichés : 10 pris dans des kibboutz israéliens, 10 autres dans le village de Wadi Fukin en Cisjordanie occupée, qui lui ont valu la Bourse du Talent 2022 et d’être exposée à la BnF de décembre à mars 2023. Devenue photographe après un master en action humanitaire et relations internationales, Victorine Alisse, 30 ans, a aujourd’hui à cœur de mettre en lumière les personnes marginalisées grâce à ses “discussions photographiques”.