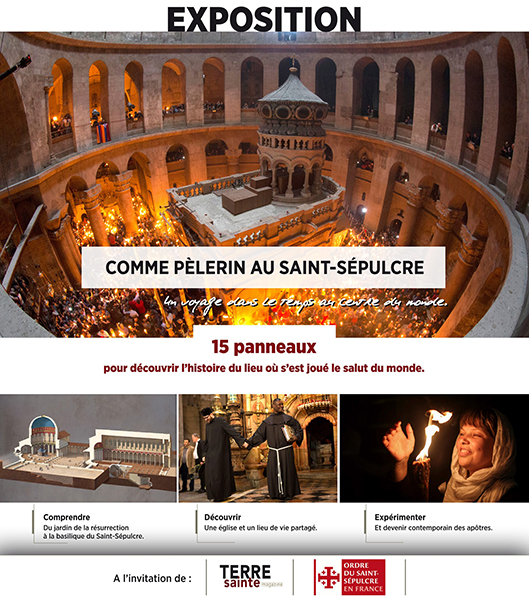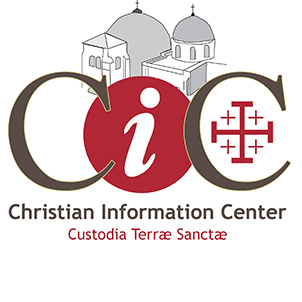Que faut-il pour faire une bonne pâte ?

Hier comme aujourd’hui, deux éléments sont indispensables dans toute cuisine, le levain et le sel. Comment sont-ils envisagés dans les textes bibliques ? De l’Ancien Testament au Nouveau, petit parcours de saveurs.
Le Royaume des cieux levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que le tout ait levé” peut-on lire dans Mt 13, 33, ou Lc 13, 20 qui utilisent la même métaphore. Sachant qu’une mesure c’est quarante-cinq litres, on obtient cent-trente-cinq litres pour cette image choisie par Jésus, ce n’est pas une petite préparation ! On retrouve ici l’habitude qu’a le Christ, dans ses enseignements, d’exagérer les chiffres, afin de faire réagir ses auditeurs. Pensons aux dix-mille talents du débiteur féroce en Mt 18, 23-35 ; à l’arbre gigantesque issu de la minuscule graine de moutarde en Mc 4, 30-32.
Sans plus d’explications pour cette parabole, Jésus laisse entendre encore la petitesse du Royaume, appelé cependant à devenir, après un départ infiniment modeste, aussi important et indispensable que du ferment dans une pâte. C’est l’aspect positif du levain, le hames en hébreu. Mais dans d’autres passages, eux aussi répétés chez Matthieu et Marc, le levain a une connotation négative : “Méfiez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens ; alors les Douze comprirent que Jésus avait dit de se méfier, non du levain dont on fait le pain, mais de l’enseignement des Pharisiens et des Sadducéens.” -Mt 16, 6.
Voir aussi >> 📺Le pain, du quotidien au divin
“Gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain d’Hérode” ; Mc 8, 15 ajoute ici le rôle pervers et souvent cruel du fils d’Hérode le Grand. Saint Paul conseille ses “paroissiens” de Corinthe avec la même résolution : “Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes ; car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi donc célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité.” -1Co 5, 6-8.
Le raisonnement de l’apôtre des nations se fonde sur la fête juive de Pâques, au cours de laquelle aucun ferment ne doit être utilisé, dans aucune préparation à base de céréales, blé, orge ou épeautre. Durant toute la semaine pascale ne sont consommés dans les maisons juives que des pains azymes, fines galettes plates, et c’est cette sorte de pain que Jésus a rompu et partagé avec les Douze la dernière fois qu’il a dîné avec eux, puisqu’il vivait cette huitaine de fête avec eux.
Entrons en cuisine
Comment comprendre ces contradictions sur le levain ? Utiliser du levain, revient forcément à introduire dans une future pâte – un mélange de farine avec un liquide, lait, eau ou bien huile – un élément ancien, datant d’au moins quelques jours ; car il faut en moyenne une petite semaine pour faire monter ou “pousser” un levain, qui est un produit issu d’une fermentation : l’ajout d’un peu d’édulcorant, sucre, sirop ou miel, accélérera encore le processus. C’est dans ce sens qu’il est assimilé par saint Paul à du “vieux” et par Jésus à un élément qui, puisque traditionnel, est toujours le même, rabâché comme un vieux discours, et qui, non seulement ne se renouvelle pas, mais empêche d’appréhender ce qui est nouveau.

Il est donc à prendre avec méfiance, si ce n’est à proscrire totalement. C’est d’ailleurs pour cela que, durant la semaine de Pessah, la Pâque juive, l’absence totale de levain veut signifier que l’on se détache de tout ce qui précède afin d’accueillir l’entière nouveauté du printemps, vrai renouveau, et de la fête du Salut, de la libération d’Égypte. La tradition orale juive précise en effet : “Tout produit issu de cinq espèces de céréales, blé, orge, épeautre, avoine et seigle, qui, sous l’influence de ferments et sous l’action de la chaleur ou de l’humidité, subit le processus chimique de la fermentation.”(1)
Lire aussi >> Pâque juive: pourquoi cette nuit n’est-elle pas comme les autres ?
Les ménagères, et les boulangers, prépareront donc des matsot, pains azymes, durant les huit jours de la fête printanière. L’aspect négatif du levain, dont Jésus veut prémunir ses disciples, c’est la tradition dans ce qu’elle a de figé, ce que nous appelons justement le pharisaïsme, qui ne permet pas un regard neuf et refuse en définitive le jaillissement messianique tel qu’il se présente dans la personne si originale de Jésus… qui est bien le Messie attendu, mais pas du tout tel que ses contemporains l’attendaient.
Ajoutons du sel
Après avoir énoncé les Béatitudes, premières paroles publiques de Jésus selon l’Évangile de Matthieu, le Christ déclare à ceux qui se sont approchés de lui, les disciples : “Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel se dénature avec quoi sera-t-il salé ?” -Mt 5, 13. Littéralement : “Si le sel devient fou, s’il est hors de lui-même” ; terme plus fort que “affadi” ou seulement “dénaturé quant au goût”.
Comme pour le levain, on peut retenir deux aspects concernant cet ingrédient. D’abord c’est le sel qui donne saveur aux aliments auxquels il est mélangé. “Va-t-on manger un aliment fade ? et, sans sel, le blanc de l’œuf a-t-il quelque saveur ?” questionne Jb 6, 6. Ensuite, parce qu’il permet la conservation, il se trouve lié à l’idée de pérennité, de “durable” : “Les prêtres revendent ce qui leur est sacrifié et en tirent profit, mais leurs femmes en salent une partie sans rien distribuer au pauvre et à l’impotent” reproche Ba 6, 27. On comprend par cette remarque du prophète que les épouses des prêtres gardent dans leurs propres celliers ce qui, en réalité, appartient aux familles qui ont commandé le sacrifice, en particulier les plus indigentes, et ce, après l’avoir salé… pour le conserver.
Lire aussi >> La matza, le pain de la Pâque juive
L’image de la durabilité va alors concerner l’Alliance : “Tu saleras toute oblation que tu offriras et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l’alliance de ton Dieu.” commande Lv 2, 13 dans le chapitre concernant les offrandes végétales. “C’est là une alliance éternelle par le sel devant le Seigneur.” déclare Moïse aux prêtres chargés de faire les sacrifices, d’animaux cette fois -Nb 18, 19. Et enfin : “Le Seigneur, Dieu d’Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, c’est une alliance de sel, berît melah, pour lui et pour ses fils” -2Ch 13, 5.
Il est à noter que dans le Proche-Orient ancien les alliances conclues ne duraient que jusqu’à la mort d’un des contractants et n’étaient pas reportées sur leurs successeurs ; il fallait alors rédiger un nouveau contrat avec les héritiers ou les représentants des signataires, sans qu’on soit assuré de leur agrément. Mais Dieu, qui n’est pas un partenaire comme les autres, offre à son peuple une alliance éternelle qui, de sa part, ne sera jamais remise en question. On la dit infrangible.
De Moïse à Jésus
Selon le récit de Matthieu, Jésus inaugure son enseignement “sur la montagne” ; l’évangéliste établit ainsi un parallèle fort avec Moïse, monté auprès de Dieu sur la plus haute montagne du désert du Sinaï pour y recevoir la Loi, afin de la faire connaître au peuple. Une “retraite” de quarante jours en présence de Dieu. Après quarante jours de jeûne au désert, Jésus, nouveau Moïse, associe donc ses disciples à l’acte qui scelle l’Alliance. Il fait d’eux une offrande “salée” en vue du Salut du monde ; et par cette parole les voilà devenus à la fois “mangeables”, comestibles, savoureux, mais surtout “durables”.
On lit dans le Talmud une même réflexion : “Tout aliment doit être salé pour être conservé ; l’argent aussi doit être salé pour être conservé ; avec quoi ? avec le sel de la charité”. Autre notion qui n’est pas si éloignée de ce que disait Jésus dans le “Discours sur la montagne”. Marc va s’intéresser aussi au sel, mais dans le contexte des relations fraternelles : “C’est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi l’assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres”. -Mc 9, 50.
De même Paul s’adressant aux Colossiens : “Que votre langage soit toujours aimable et assaisonné de sel.” -Col 4, 6. Gageons que Jésus a souvent vu sa mère préparer les pains et gâteaux de la maisonnée ainsi que les matsot pour les jours de fête. À partir de ces images qui lui sont familières, il enseigne les grandes vérités de l’Évangile. C’est avec du levain… positif ! et du sel que la pâte du Royaume sera goûteuse et bien levée.