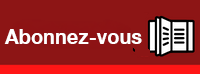L’Institut Français du Proche-Orient (Ifpo) organisait le week end dernier deux journées de colloque sur le sujet : «150 ans de contribution française à l’archéologie palestinienne». L'occasion pour les participants de voir comment cette archéologie en Palestine doit encore évoluer pour devenir une archéologie palestinienne.
(Jérusalem) – Vendredi 21 et samedi 22 septembre, l’Institut Français au Proche-Orient (Ifpo) organisait deux journées de colloque sur le sujet : «150 ans de contribution française à l’archéologie palestinienne». L’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (EBAF) et l’université de Birzeit en Cisjordanie accueillirent l’événement.
Frédéric Desagneaux, Consul Général de France, a introduit la série de conférences, soulignant « l’importance du patrimoine pour la reconnaissance internationale de la Palestine ». Roula Maaya, ministre du Tourisme et des Antiquités prit la parole à son tour pour retracer l’historique de la collaboration franco-palestinienne.
Estelle Villeneuve, collaboratrice au Monde de la Bible, a montré comment la recherche archéologique française avait évolué depuis les années 1860. Elle expliqua que l’expression Terre Sainte, utilisée par les premiers archéologues français lorsqu’ils parlaient de la Palestine, était significative. Il s’agit en effet d’un terme qui, dans l’usage occidental, cantonne la région à son histoire biblique. En venant en Palestine, la plupart des archéologues cherchaient à illustrer la Bible. Au lieu de s’interroger scientifiquement sur les objets trouvés, ils leur prêtaient des identités souvent hasardeuses afin de justifier le récit biblique. Ce procédé apologétique, que l’on nomme archéologie biblique, a donné lieu à des conclusions hâtives et souvent fausses.
Le père Pol Vonck, en charge du musée (fermé au public) des Pères Blancs Missionnaires d’Afrique à Sainte-Anne, put ainsi montrer à l’assistance l’aiguille qui, selon le père Gré initiateur du musée, aurait servi à Adam et Ève pour la confection de leurs vêtements après la faute originelle !
L’archéologue Félicien de Saulcy, présent en Terre Sainte dans les années 1850, pensait quant à lui pouvoir réfuter l’incroyance des hommes par ses fouilles. Idées préconçues, manque de discernement… la plupart de ses théories ne sont plus retenues aujourd’hui.
D’autres archéologues ont su éviter cet écueil comme les diplomates français en place à Jérusalem à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. D’une grande rigueur intellectuelle, Paul-Emile Botta, Consul de France de 1848-1855, était passionné par tous les types de découvertes. Il ne restreignit pas ses travaux aux fouilles de sites bibliques et accompagnait ses comptes-rendus de dessins très précis, pour prouver ce qu’il avance. Il avait conscience de ses limites et avouait parfois son impuissance : « Je dois donner des éléments qui seront interprétés par des spécialistes. » Quant à Charles Clermont-Ganneau, vice-consul à Jaffa en 1881, il est tellement méticuleux qu’il devient spécialiste des faux.
Les approches de Victor Guérin comme de Melchior de Voguë firent aussi l’objet de communications passionnantes.
La figure du père Marie-Joseph Lagrange, présentée par Jean-Baptiste Humbert dominicain de l’Ebaf, mérite qu’on s’y arrête. Fervent croyant – le procès en vue de sa béatification a été ouvert en 1988 – et bibliste hors-pair, le père Lagrange fonde en 1890 à Jérusalem l’École pratique d’études bibliques « sans raison » : « il a 35 ans, il n’est pas spécialiste de l’Orient, il n’a pas de budget ». Mais il est doué d’une grande honnêteté intellectuelle.
« Et il part à la découverte du sud, il s’intéresse à tout », explique le père Humbert.
« Selon ce que l’on concevait de l’archéologie de l’époque, c’est-à-dire que les monuments devaient être mis en parallèle avec des inscriptions, avec des sources historiques, il se fait d’abord épigraphiste. »
Mais un événement va être déterminant dans la démarche de Lagrange. Avant 1896, il fit la traversée du Sinaï à dos de chameau. Il est passionné par son voyage mais sa conclusion est que l’exode ne peut s’être fait par le Sinaï. Le lieu ne convient pas. Sa méthode historico-critique l’amène à conclure que ce qui est raconté dans le récit ne peut s’être déroulé dans la géographie. C’est sur cette critique historique des textes qu’il fondra l’École biblique.
Quand il écrit ses premiers commentaires de livres de l’Ancien Testament suivant sa méthode, Rome réagit. Par trois fois, il est rappelé à l’ordre par le Saint-Siège pour ses publications.
Il passera alors au Nouveau Testament dont il fera la critique historique mais il ne s’intéressera pas aux sites archéologiques du Nouveau Testament.
Ce sont les archéologues américains qui reprendront le flambeau d’une archéologie biblique apologétique. Les Dominicains se concentreront sur Jérusalem, tout Jérusalem, à toutes les époques, privilégiant l’anthropologie, distinguant l’héritage des hommes, à la vérité divine du texte.
Pour conclure ce colloque, auquel participèrent archéologues et conservateurs français et palestiniens, Hamdan Taha, directeur du département des Antiquités et du patrimoine culturel, a rappelé que l’intérêt des Français pour la Terre Sainte est plus ancien que leur collaboration à l’archéologie, rappelant les visites des pèlerins comme l’anonyme de Bordeaux qui vint à Jérusalem en 333 et de tous les pèlerins qui se sont succédés en passant par les croisés jusqu’aux campagnes napoléoniennes.
Il salua bien sûr le travail des archéologues français dans la contribution à l’archéologie de Palestine. Puis il s’interrogea sur l’essence et la vocation d’une archéologie palestinienne qui avait pour vocation à ses débuts de rechercher les traces bibliques. Une vocation qui avec la création de l’État d’Israël s’est mue en une idéologie. Quelle place reste-t-il dès lors à une archéologie qui voudrait raconter l’histoire de la Palestine d’autant que les Palestiniens, perdant la majeure partie de leur territoire en 1948, se voient aussi privés de leur histoire sur cette portion de terre. Jusqu’à aujourd’hui cette question demeure posée pour les universitaires palestiniens dont les territoires ont été sous juridiction jordanienne, puis sous occupation militaire israélienne. Ils déplorent aujourd’hui que les accords transitoires avec les Israéliens qui avaient prévus la possibilité pour l’Autorité palestinienne de mener ses propres travaux dans certains secteurs, ne puissent être appliqués sur le terrain.
Des questions qui trouveront certainement un nouvel éclairage dans le second colloque qu’organisera l’Ifpo les 11 et 12 octobre 2013 à Paris avec pour thème: « La recherche scientifique en partenariat ».