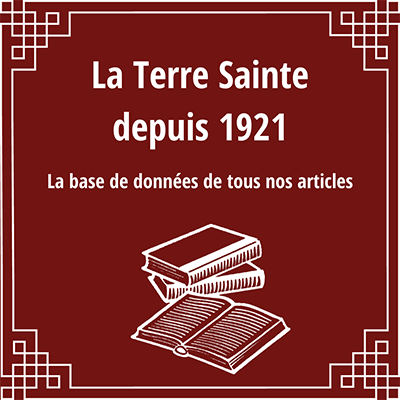À Douma en Palestine, Israéliens et Palestiniens plantent ensemble des oliviers
Une attaque incendiaire dans le village palestinien de Douma avait précédé le début de “l’Intifada des couteaux” à l’automne 2015. Quelques mois plus tard, l’association des Rabbins pour les Droits de l’Homme s’est rendue dans ce village hautement symbolique, afin d’y planter des oliviers. Reportage.
C’est à Douma, en Palestine, que l’Association Rabbins pour les Droits de l’Homme (Rabbis for Human Rights) avait choisi de planter des oliviers à l’occasion de la fête du Nouvel an des arbres. Douma, le village palestinien de Cisjordanie dans lequel des extrémistes juifs avaient incendié deux maisons habitées dans la nuit du 31 juillet 2015. Trois membres de la famille Dawabshé, un enfant de dix-huit mois et ses deux parents, sont morts des suites de leurs blessures.
Sous le soleil matinal, non loin des remparts de Jérusalem, le minibus de l’Association attend dans un parking. Abou Rami, le chauffeur palestinien, nettoie soigneusement les jantes du véhicule en attendant les participants. Ils arrivent au compte-gouttes, une dizaine au total. Ils parlent hébreu, mais anglais aussi. Tous ont l’air enthousiastes de participer à l’action de l’Association.
Le minibus démarre et descend la vallée, sortant de Jérusalem vers le nord. Le mur de séparation se dresse soudain. Sans s’arrêter, on passe le checkpoint vers les territoires palestiniens. Toujours facile dans ce sens-là. Au long de la route, régulièrement, des mobile-homes et des rangées de maisons au toit rouge émergent des collines, installations caractéristiques des implantations israéliennes en Cisjordanie. Sur le panneau indiquant la direction de la colonie de Rimonim, le nom en arabe a été barré à la peinture violette. En Cisjordanie, Palestiniens et Israéliens, qui vivent si proches les uns des autres, semblent pourtant appartenir à deux mondes opposés.
250 arbres arrachés
Encore une trentaine de minutes à travers les vallons palestiniens. Après les pluies d’hiver, le massif ressemble à s’y méprendre aux vertes et rocailleuses collines de Provence de Marcel Pagnol. Une fois arrivé à l’oliveraie de Douma, le minibus s’arrête, et la petite troupe descend. Une dizaine de véhicules stationne sur le bord de la route. Un autre minibus de l’Association des Rabbins pour les Droits de l’Homme arrive de Tel Aviv, une vingtaine de personnes à son bord. Des villageois et des journalistes sont aussi présents. C’est donc une soixantaine de personnes qui sont dans la plaine aujourd’hui. Parmi les volontaires, il n’y a que deux rabbins, les autres sont des laïcs.
Les plants d’oliviers, hauts d’une cinquantaine de centimètres, sont déchargés. Arik Ascherman, rabbin israélien d’origine américaine, cofondateur et figure incontournable des Rabbins pour les Droits de l’Homme, distribue quelques outils. Les volontaires s’équipent : pelles, pioches et bêches. Tout le monde se rend dans la plaine et commence à creuser, certains énergiquement, tandis que d’autres cherchent à entrer contact avec des Palestiniens, venus eux aussi planter.
Lire aussi >> Rabbins pour les droits de l’homme: Stop à la violence!
Plus de 250 arbres auraient été arrachés dans ce champ il y a cinq ans. Et l’Association compte en replanter aujourd’hui à peu près autant. Bassem, le propriétaire du terrain, a le sourire aux lèvres : “Bien sûr que je suis content”, s’exclame-t-il. Il s’agite pour aider les volontaires et s’assurer que les arbres sont correctement mis en terre. L’accueil des Palestiniens est chaleureux. Cette aide venue du ciel les enthousiasme.
Commandements de Dieu
Parmi les planteurs, Sarah Newman, une Américaine, grande brune et lunettes fumées, arrivée en octobre en Israël pour faire son alyah, explique sa présence aujourd’hui : “Je suis ici pour soutenir la communauté de Douma, notamment après ce qui s’est passé cet été, l’incendie […]. Tous les juifs ne sont pas des colons et tous les Palestiniens n’ont pas un couteau à la main. Je pense que la grande majorité d’entre nous veut vivre en paix” assène-t-elle.
Deux Palestiniens aident un Israélien à planter un olivier. Ils communiquent avec les mains pour s’accorder sur la largeur du trou à creuser. On sent malgré l’absence de paroles une bienveillance étonnante entre eux. Ils sont venus dans un même but : planter des oliviers là où ils avaient été arrachés cinq ans plus tôt. La terre est meuble et très vite, des dizaines d’arbres sont plantés.
Lire aussi >>
Après une heure sur le terrain, le rabbin Arik Ascherman tente de rameuter les planteurs, éparpillés aux quatre coins de la plaine, en criant en arabe et en hébreu. Il propose aux participants, Israéliens et Palestiniens, de se réunir. Il rappelle l’importance symbolique de l’action menée par l’Association ce jour-là : “Aujourd’hui, à l’endroit où des personnes mal intentionnées ont brûlé d’autres êtres humains. Ici, le lendemain d’un autre terrible meurtre à Jérusalem. Ici, dans une zone où des milliers d’arbres ont été déracinés, sciés, empoisonnés, dans cette lutte menée par des Israéliens afin de s’emparer de terres palestiniennes. Ici, alors qu’une vague de violence continue à déferler autour de nous. Ici, nous nous rappelons les commandements de Dieu que nous avons lus dans la Torah, dans toutes les synagogues du monde shabbat dernier : “Tu ne tueras point, Tu ne voleras point, Tu ne convoiteras pas le bien d’autrui”.
Des membres de la famille Dawabshé sont présents. On traduit le discours de chacun, les erreurs de traduction donnent lieu à quelques rires, dans chacune des langues. Les gens sont détendus, l’ambiance est bon enfant, mais les mots sont forts : “Ils arrachent les arbres et brûlent les hommes, mais aujourd’hui nous sommes ensemble, main dans la main pour tenter de panser les plaies de la tragédie qui s’est déroulée ici.”
“Ils ont brûlé le nourrisson, Ali Dawabshé »
Les participants, Palestiniens et Israéliens, juifs et musulmans, réunis en cercle, écoutent ensuite une prière préparée par l’Association, lue en arabe et en hébreu, “Nous espérons que les arbres que nous avons plantés donneront des fruits de paix […]”
Les volontaires sont ensuite invités à aller voir la maison incendiée à Douma. Ils arrivent en minibus devant la bicoque brûlée. Elle semble avoir été conservée telle qu’elle. Les murs blancs sont noircis, et à travers les vitres cassées on peut apercevoir un intérieur brûlé, orné de graffitis en arabe à la mémoire des victimes. Les inscriptions en hébreu signant le méfait sont encore là.
Lire aussi >> Israël règle ses comptes avec le terrorisme juif
En arabe sur la façade de l’entrée de la maison on peut lire : “Ils ont brûlé le nourrisson, Ali Dawabshé”, son nom. Un des membres de la famille, Abdeslam Dawabshé, ouvre la porte. À l’intérieur, tout est noirci et brûlé. Au milieu de la pièce, un tricycle d’enfant est encore là. Fauteuil cramé, télévision fondue, on essaye de s’imaginer la scène. Des cocktails molotov sont lancés en pleine nuit. Les parents se réveillent au milieu du feu, la mère s’empare d’une couverture dans laquelle elle croit avoir couché son enfant, mais réalise, une fois dehors, qu’il n’y est pas.
Sur le mur a été dessiné un lit de bébé, avec le petit Ali à l’intérieur. Une main israélienne armée d’une menorah, le chandelier juif, met le feu à la maison. Difficile de ne rien ressentir devant une telle scène. Quelques Israéliens ressortent de la maison les larmes aux yeux. La plupart des participants sont choqués : “Comment des êtres humains peuvent-ils faire ça ?” s’exclame une d’entre eux. “Comment des juifs peuvent-ils faire ça ?”
Lumière dans la nuit
Un jeune de la famille Dawabshé entre aussi, son émotion se lit dans ses yeux humides. Il montre l’étendue des dégâts à quelques personnes. Il faut sûrement beaucoup de courage pour accepter que des Israéliens entrent dans cette maison, alors que l’amalgame pourrait être vite fait entre colons et Israéliens. Abdeslam Dawabché dit lui aussi ressentir une grande tristesse à chaque fois qu’il revient, mais au seuil de la maison il confie : “Nous savons qu’il y a une partie du peuple israélien qui veut vivre en paix avec nous”.
Tout le monde remonte dans le minibus pour revenir au champ. Le porte-parole de l’Association est lui aussi sous le choc : “C’est terrible mais il ne faut pas oublier que c’est avant tout le régime israélien lui-même qui fait beaucoup plus de mal aux Palestiniens que les crimes commis par les extrémistes”.
Lire aussi >> Le mécontentement palestinien en Israël
Fondée en 1988, l’Association des Rabbins pour les Droits de l’Homme se définit comme la seule voix rabbinique spécialement dédiée à la défense des droits de l’homme. Elle réunit plus de cent rabbins israéliens issus de divers courants du judaïsme. Sa mission est d’agir et d’informer la société civile sur les violations des droits de l’homme, et de faire pression sur les institutions de l’État en faveur de la justice.
En attendant de repartir vers Jérusalem, un des jeunes Israéliens regarde par la fenêtre du minibus, en direction du champ. Les Palestiniens continuent à planter les oliviers. Peut-être se demande-t-il : “Et ces arbres-là, combien de temps avant qu’ils ne soient de nouveau arrachés ?”. Face à une situation apparemment désespérée, les Rabbins pour les Droits de l’Homme sont une lumière dans la nuit.
Dernière mise à jour: 09/01/2024 21:09