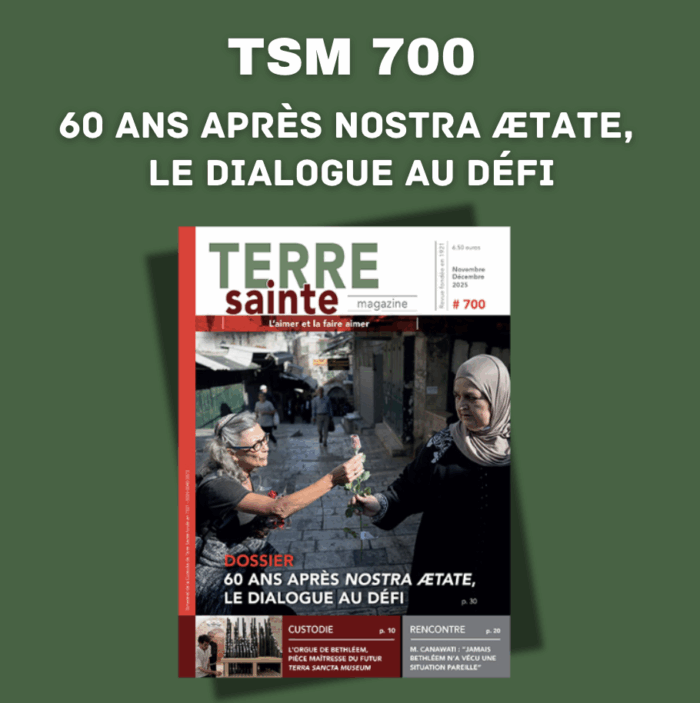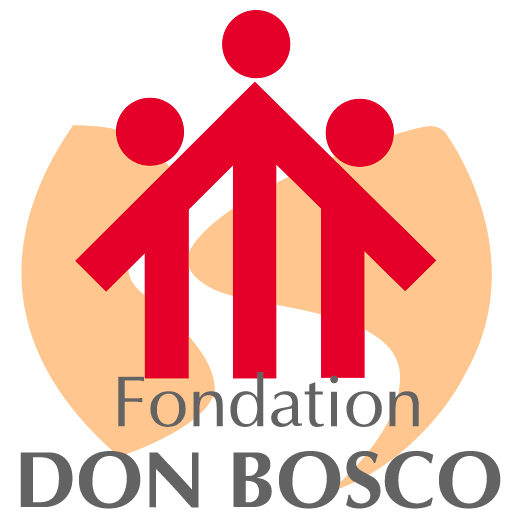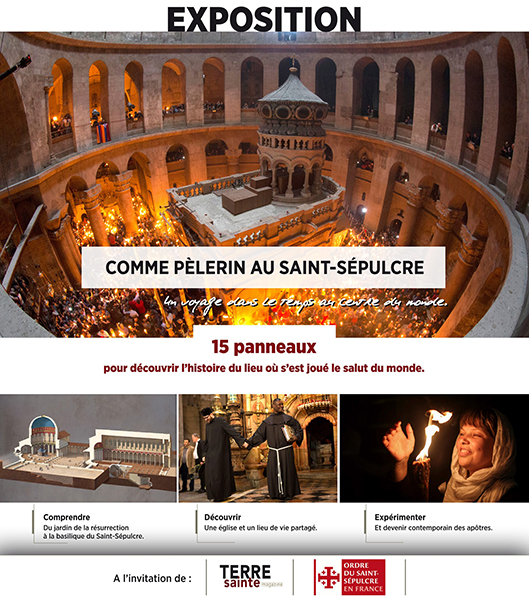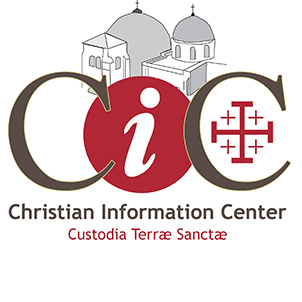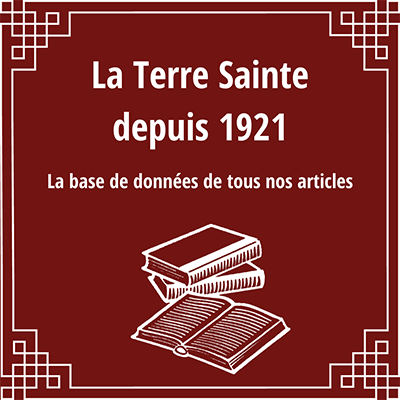Mont du Temple: à la recherche de la prière perdue

Chaque année, un nombre grandissant de juifs se rendent sur ce qu’ils nomment le Mont du Temple, qui pour le visiter, qui pour une prière intérieure, qui pour une prière ostentatoire. Pourtant, la prière des non-musulmans est interdite sur l’esplanade des mosquées depuis 1967. Qu’est-ce qui motive à braver le statu quo ? Qui interdit quoi, à qui ? Quel est le goût de cette prière interdite ?
« Je vais prier au Mont du Temple, je sens bien. J’y ressens davantage d’émotions”, explique Chaïm Berkovits. Pour cet historien et écrivain, qui se rend régulièrement sur ce qu’il appelle exclusivement le Mont du Temple, la prière des juifs y est essentielle. Il rappelle que “c’est l’endroit le plus saint du judaïsme car il abritait le Saint des saints”.
Le système pyramidal des saintetés est basique : plus on se rapproche du Saint des saints, plus la sainteté du lieu est importante. Conclusion : le Mont du Temple possède une sainteté plus élevée que le Kotel, le mur occidental, improprement appelé Mur des lamentations. Le rabbin Chaïm Goldberg, qui veut favoriser un plus grand respect des pratiques bibliques, ajoute que “c’est l’endroit le plus saint” par décision de Dieu, qui a décidé que “ce serait le sien”.
Les juifs le disent tous, il s’agit là d’un lieu à part. Ceux qui s’y rendent viennent y chercher une expérience spirituelle particulière et cette expérience est celle du dialogue avec Dieu. Or “le dialogue avec Dieu est fondamental dans le judaïsme”. Entre ce Mont du Temple et Dieu, c’est bien simple, selon Goldberg, il n’existe pas de ligne plus directe.
La « montée », de plus en plus fréquente
À l’approche des fêtes de Tichri, le premier mois de l’année dans le calendrier hébraïque, de nombreux juifs se rendront sur ce que le langage commun nomme “esplanade des mosquées” et les musulmans “le Noble sanctuaire”. Pour Souccot, la fête des Tentes, une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme le commande, des milliers de juifs monteront à Jérusalem pour accomplir la mitzva, le précepte religieux. Tandis que, durant des décennies, tous se contentaient de la place devant le mur occidental, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre sur l’esplanade des mosquées.
En 2009, environ 5 000 juifs avaient franchi le Rubicon dans l’année pour se rendre au plus près du lieu présumé du Saint des saints. Ils étaient 10 000 en 2014 et plus de 50 000 en 2023, soit une multiplication par 10 en l’espace de 15 ans. Bien que ces chiffres soient à tempérer au regard des 500 000 visiteurs annuels au mur occidental, ils n’en constituent pas moins une fragilisation du Statu quo de 1967, car la visite permise s’accompagne de plus en plus de prières interdites.

À la fin de la guerre des Six-Jours, en juin 1967, le ministre des Armées, Moshe Dayan, prit la décision de laisser l’administration du Mont du Temple sous le contrôle du Waqf, une fondation islamique, tout en permettant aux non-musulmans de visiter le site. L’arrangement stipulait que les musulmans pouvaient prier librement sur l’esplanade, tandis que les non-musulmans (y compris les juifs) étaient autorisés à s’y rendre à certaines heures, mais ne devaient pas y prier. Les juifs prieraient au mur occidental, vestige du soutènement de l’esplanade au-dessus de laquelle s’élevait le Second Temple.
Un accord contesté
L’accord ne fut pas inscrit dans la loi israélienne mais appliqué par les forces de sécurité israéliennes pour éviter des tensions religieuses. Finalement, c’est l’interdit des grands rabbinats de se rendre sur l’esplanade, de peur de fouler l’espace du Saint des saints dont on ne peut affirmer avec précision la localisation, qui dissuada le plus les juifs religieux. Pour Chaïm Berkovits, l’interdit rabbinique fait preuve “d’une prudence excessive”. Le rav Chaïm Goldberg pense, quant à lui, que “certains rabbins n’ont pas su à ce moment-là passer à autre chose”. Ils peineraient, selon lui, à tourner la page après des siècles de diaspora passés éloignés des Lieux saints.
C’est pourtant là que s’est écrit leur histoire, ici que le roi Salomon fit ériger le Premier Temple, un sanctuaire majestueux dédié à Dieu, détruit, reconstruit, puis à nouveau anéanti par les légions du général, et futur empereur, romain Titus en l’an 70. Le Temple a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire juive. Pour ceux des juifs qui se rendent sur l’esplanade afin de prier, il n’y a pas besoin d’occasions particulières : c’est la plus belle et la plus intense des prières. Pour la garantir, ils ont tracé des parcours sûrs avec l’aide de “rabbins reconnus”.
Lire aussi >> Prière polémique: Pourquoi un juif peut-il désirer prier sur l’esplanade?
Depuis une vingtaine d’années, ces mesures permettent de lever les réserves que beaucoup nourrissaient sur le risque à fouler un lieu interdit, tout en restant soumis à quelques autres règles. Les juifs qui entendent prier lors de leur visite doivent se purifier avant d’entamer leur pieuse ascension : hommes et femmes doivent s’immerger dans un mikvé — bain rituel juif — après avoir soigneusement vérifié leur propreté corporelle. Certains choisissent d’aller plus loin, renonçant à porter des objets en cuir comme les chaussures ou les ceintures. Une abstinence sexuelle de 24 heures avant l’immersion est également recommandée.
Ainsi, les visiteurs avancent en silence, souvent en petits groupes. La prière à voix haute est toujours interdite par la police israélienne. Certains fidèles sont accompagnés de guides religieux, garants du respect des règles de pureté rituelle et du respect scrupuleux des zones autorisées. Dans les faits, un nombre grandissant de juifs conduits par des mouvements plus idéologues, comme la yeshiva Har HaBayit (littéralement la Montagne de la Maison que l’on traduit en français Mont du Temple), vont plus loin : ils s’autorisent des prosternations dans certains recoins, à genoux, front au sol, voire allongés.
Religion et politique
Ces gestes restent marginaux et isolés, mais témoignent d’une ferveur religieuse qui cherche à se réapproprier l’endroit comme lieu de prière, malgré les restrictions. Éventuellement, ils récitent des prières à voix haute. La police israélienne, censée les réprimander, les laisse faire et s’en prend plutôt aux musulmans qui se plaignent de cette violation du Statu quo.

Il faut dire que si le Mont du Temple revêt pour les juifs une signification religieuse profonde, il est aussi un symbole puissant de souveraineté nationale. C’est ainsi que le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, se rend régulièrement sur l’esplanade et a affirmé à plusieurs reprises : “Aujourd’hui, grâce à Dieu, il est possible de prier sur le Mont du Temple et de s’incliner.”
Tandis que le député Zvi Sukkot, membre du parti ultranationaliste HaTzionout HaDatit, a été filmé en contrebas du Dôme du Rocher avec un drapeau d’Israël, déclarant : “Le Mont du Temple est à nous”. Certains courants messianiques vont jusqu’à revendiquer ouvertement la construction d’un Troisième Temple en lieu et place du Dôme du Rocher.
Lire aussi >> Ultras et « pyromanes » du Mont du Temple
Pour la majorité des juifs orthodoxes, la prière sur l’esplanade demeure “une offense à la sacralité du lieu le plus saint du peuple juif” et les deux grands rabbinats continuent officiellement de l’interdire. Les prières juives sur l’esplanade alimentent des tensions à la croisée des enjeux religieux et géopolitiques, tensions loin d’être accessoires. Pour les Palestiniens, ces manifestations sont perçues comme une atteinte au Statu quo et à ce qui leur reste de “souveraineté” à Jérusalem, en plus d’être une provocation sur le site qu’ils considèrent tout entier comme une mosquée.
Quand le Hamas revendiqua son “opération” du 7 octobre, il la désigna sous le nom de “Déluge d’Al-Aqsa”, du nom de la mosquée au dôme gris tenue pour être le troisième lieu saint de l’islam, expliquant défendre “notre terre, nos lieux saints, notre mosquée Al-Aqsa” et s’opposer aux “incursions” israéliennes. Si des juifs plus fanatiques, devant une police moins vigilante, alors que certains membres du gouvernement et de la Knesset attisent le feu, devaient s’en prendre aux mosquées elles-mêmes, ce ne seraient plus sept millions de musulmans palestiniens qui monteraient au créneau, mais un milliard six cents millions de musulmans qui pourraient être franchement énervés.