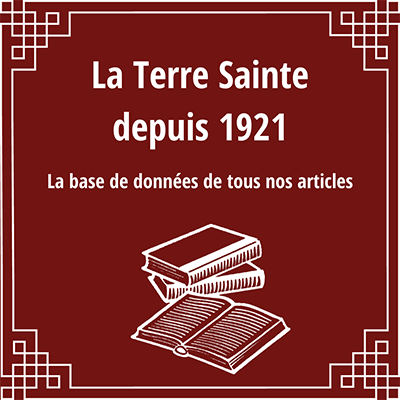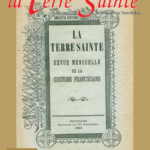Quand on réside à l’étranger, il arrive occasionnellement qu’on ait le sentiment de manquer quelque chose. Tous vos amis et vos proches vous en parlent,
Quand on réside à l’étranger, il arrive occasionnellement qu’on ait le sentiment de manquer quelque chose. Tous vos amis et vos proches vous en parlent, la presse de votre pays s’en fait l’écho à longueur de colonnes et pour informés que vous soyez, l’événement vous échappe car il faudrait être sur le territoire national pour y communier. Le plus souvent on arrive très bien à vivre sans, d’autant plus si notre présence sur la terre d’accueil est un choix.
C’est justement ce choix qui, chez beaucoup de religieux de Terre Sainte, avivait ce sentiment de manquer quelque chose en ne voyant pas le film « Des hommes et des dieux ».
Grâce au Centre Culturel Français Romain Gary, la curiosité des Français expatriés dans la Ville Sainte a pu être rassasiée. C’est un film en version sous-titrée en hébreu que nous avons vu. Reçu plutôt, en cadeau, en plein cœur, interrogeant en nous le choix initial, fait il y a des années et reposé sans cesse au rythme des secousses politiques : celui de ce pays et de ses habitants. Dans la salle, il y avait le doyen de ceux qui ont fait le choix de vivre en communion avec le peuple juif au point de devenir israélien. Et des religieux qui ont connu trois ou quatre guerres depuis leurs couvents de Jérusalem-Est. Tous nous avons entendu cette pensée de Pascal méditée par frère Luc, le médecin dans le film, et trop souvent vérifiée ici : « Les hommes ne font jamais le mal si complètement et joyeusement que lorsqu’ils le font par conviction religieuse ». À ceci près que, comme religieux, nous savons aussi d’expérience que nous pouvons avoir, ou avoir eu, de ces convictions religieuses-là. Cela fait moins sourire.
À l’issue du film, planait un long silence. La lettre Testament du prieur Christian de Chergé résonnait encore. Il est peu probable, du moins dans un futur immédiat, que nous risquions ici notre vie pour notre foi. Il est incontestable que, de ce point de vue, nous vivons dans le pays le plus sûr du Moyen-Orient qu’il s’agisse d’Israël ou des Territoires palestiniens et ce quand bien même la pression monte des deux côtés contre la minorité chrétienne, y compris étrangère. Personnellement, j’ai quitté la salle dans la joyeuse impatience de ce moment où « je pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui Ses enfants de l’Islam (et du Judaïsme) tels qu’il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de Sa Passion, investis par le Don de l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. » À la fois rien ne me presse pour le face à face, je continuerai donc de regarder de trois quarts et derrière le voile ces deux peuples que j’aime de façon égale quoique différentes.
Dernière mise à jour: 21/11/2023 14:32