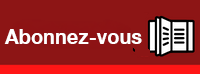Après dix-huit mois d’impasse politique, c’est à la faveur
de la crise du coronavirus que les ennemis d’hier se sont finalement entendus pour former un gouvernement d’union nationale.
Sa pérennité est fragile. Retour sur les ingrédients d’une situation inédite qui montre la fragilité politique de l’État hébreu.
Jamais Israël n’avait connu une si longue crise politique. Le 17 mai, après trois élections sans issue, le pays s’est enfin doté d’un gouvernement qui s’annonce déjà comme celui de tous les superlatifs : le plus pléthorique (36 ministres et 16 vice-ministres), le plus dispendieux et sans doute le plus improbable. Il vient en effet sceller l’alliance des deux grands rivaux d’hier, le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou et le chef du parti centriste Bleu-Blanc Benny Gantz, incapables chacun d’atteindre la majorité, mais que rien ne disposait à s’entendre.
Au contraire, ces deux là viennent de passer 500 jours de campagne à dire tout le mal qu’ils pensaient l’un de l’autre ; Netanyahou n’ayant pas de mots assez durs contre l’ancien chef d’état-major Gantz – dont il fait désormais son vice-Premier ministre et ministre de la Défense – tandis que ce dernier a martelé qu’il ne siégerait pas avec un homme corrompu comme Netanyahou, à qui il offre aujourd’hui son cinquième mandat. Plusieurs députés Bleu-Blanc ont préféré quitter le parti.
Impensable, leur union n’aurait pu voir le jour si l’épidémie de coronavirus ne les avait décidés à “se mettre sous la civière”, selon l’expression locale empruntée aux militaires, pour affronter ensemble la pandémie et la crise économique. Il faut dire que ce “gouvernement d’urgence” les libère aussi tous deux. À Gantz, il permet de sortir du dilemme de former un gouvernement minoritaire avec le soutien historique, mais décrié par sa base, des arabes.
Lire aussi >> Netanyahou le retour: Israël à droite toute
À Netanyahou, il offre comme par miracle de rester au pouvoir tout en y attirant une partie de l’opposition pour mieux l’étouffer. Bleu-Blanc hérite de postes prestigieux (Affaires étrangères, Justice) sur lesquels Netanyahou garde la main.

De multiples facteurs pourraient faire chuter ce gouvernement fragile. Le budget notamment. Sur la photo, des travailleurs indépendants manifestent à Tel Aviv revêtus de sacs poubelles alors que le gouvernement ne les aide pratiquement pas.© Miriam Alster/Flash90
Quant aux travaillistes, ils reçoivent l’Économie et le Travail ; cadeaux empoisonnés au temps du covid-19. Pour tous, ce gouvernement d’union nationale éloigne le spectre de quatrièmes élections. Mais pour combien de temps ?
L’opinion lui prédit une espérance de vie de 18 mois, soit jusqu’à mi-mandat. Selon l’Institut Midgam, seuls 38 % des Israéliens croient que Netanyahou cédera à ce moment son fauteuil à Gantz, conformément à leur accord de rotation. Mais la coalition peut très bien voler en éclats dans trois mois lors du vote du budget et à tout moment sur des dossiers sensibles comme l’annexion des colonies.
Autant de menaces sur l’État de droit qui pourraient devenir insupportables à certains.
Autant dire que le pays est loin d’être sorti de l’impasse. La stature écrasante de Netanyahou, mis en examen dans trois affaires pour corruption, fraude et abus de confiance, continue de polariser les débats. À cet égard, les deux derniers scrutins étaient des référendums sur son nom (qu’il a perdus). Jamais dans l’histoire d’Israël un Premier ministre n’avait été inculpé dans l’exercice de ses fonctions, ce qui a convaincu Gantz, Moshe Yaalon et Gabi Ashkenazi, deux autres anciens chefs d’état-major et le centriste Yaïr Lapid de s’unir pour lui faire barrage. Netanyahou aurait pu choisir de se retirer, ouvrant ainsi la voie à des alliances avec son parti, le Likoud. Mais le “Roi Bibi” comme on l’appelle à droite, où il règne sans partage par le respect et la crainte qu’il inspire, refuse de céder.
La Cour suprême a beau ne pas s’opposer à ce qu’il dirige le pays, son inculpation soulève de sérieuses questions sur le contrôle du pouvoir en Israël. Encore plus depuis l’ouverture de son procès le 24 mai devant la Cour du district de Jérusalem.

Protégé par ses gardes du corps, Benjamin Netanyahou un mois après avoir obtenu la signature d’un gouvernement d’unité nationale, même derrière le masque ne peut cacher la joie de son triomphe quand il se rend à la Knesset.© Flash90
Netanyahou multiplie les attaques contre la gauche, la presse, la police et le parquet, accusés de fomenter un “coup d’État” contre lui. Il a déjà prévu de limiter le pouvoir des juges et d’adopter une loi permettant de contourner la Cour suprême. Autant de menaces sur l’État de droit qui pourraient devenir insupportables à certains.
Lire aussi >> Réforme de la justice: le processus s’accélère, la mobilisation grandit
L’autre grand facteur de cette crise était le refus du nationaliste Avigdor Liberman de rejoindre son ancien allié Netanyahou dans un “gouvernement halakhique”. Le slogan recouvre le conflit le plus ravageur de la société israélienne, à l’exception du conflit palestinien : la querelle laïcs-religieux. Là encore, la nouvelle coalition ne règle rien. Les pires craintes de Liberman sont même confirmées car les deux partis ultra-orthodoxes Shas (oriental) et Yahadout HaTorah (ashkénaze) y obtiennent des postes-clé dans l’exécutif et en commissions législatives, d’où ils peuvent bloquer toute réforme n’allant pas dans leur sens. Et elles sont nombreuses, de l’éducation à l’armée. Si la tentation du statu quo est forte, la dissolution pourrait s’avérer encore une fois le seul moyen de trancher des différends profonds.
Entente de façade le temps d’affronter la crise, ce 35e gouvernement pourrait donc vite ramener les électeurs devant les urnes. Malgré son large socle (72 députés sur 120), il tient par ce même fil fragile qui fait les coalitions depuis 30 ans en Israël, simples alliances d’intérêts particuliers. La faute au déclin des deux grands partis idéologiques, le Likoud mais surtout le parti travailliste, fondateur de l’État autrefois triomphant, “renversé” en 1977 et aujourd’hui réduit à peau de chagrin. Mécaniquement ont émergé au centre et à gauche des petits partis-charnière, faiseurs de roi au destin éphémère. Environ 200 partis ont été créés et 110 ont accédé au pouvoir depuis 1948. Bâtis sur une revendication ethnique, religieuse ou sectorielle, voire un seul nom (dernièrement les partis de Tzipi Livni ou Ehud Barak), négociant à prix fort leur entrée dans une coalition, ils ajoutent à l’instabilité structurelle du régime.
Une société fracturée
Sur le papier, les Israéliens ont une démocratie représentative parfaite, “la seule du Moyen-Orient” aiment-ils à répéter, avec un parlement unique élu à la proportionnelle intégrale, un gouvernement fort et un président au rôle honorifique. Le tout devrait inciter à la modération, au compromis. Il se révèle hystérique et pratiquement ingouvernable. Plusieurs réformes ont été envisagées. David Ben Gourion imaginait par exemple des législatives par scrutin géographique et non par listes pour décourager les petits partis. L’élection directe du Premier ministre a même été tentée de 1996 à 2001, sans succès. Plus effectif, le seuil d’éligibilité a été augmenté à 3,25 %, ce qui reste l’un des plus bas au monde.
Pour recouvrer une stabilité, l’Israel Democracy Institute propose que le chef du parti arrivé en tête devienne Premier ministre sans vote d’investiture, mais puisse être renversé sur une motion de confiance. Dans un tel scénario, Netanyahou serait Premier ministre (sa liste a obtenu 36 sièges) bien que la majorité des électeurs a voté pour le bloc de centre-gauche. Crise insoluble ?
Ses racines plongent en fait plus loin encore dans une société profondément fracturée. À tel point que le président Reuven Rivlin a mis en garde contre “le sectarisme et la séparation” dans un discours de 2015 où il décrivait quatre “tribus d’Israël” : les juifs laïcs, les religieux, les ultra-orthodoxes et la minorité arabe (20 % de la population). Encore faudrait-il ajouter une multitude de groupes culturels qui dessinent de nouveaux clivages entre juifs ashkénazes, mizrahim (orientaux), russophones, éthiopiens… À se demander comment ces communautés cohabitent.
le président Reuven Rivlin a mis en garde contre “le sectarisme et la séparation” dans un discours de 2015 où il décrivait quatre “tribus d’Israël” : les juifs laïcs, les religieux, les ultra-orthodoxes et la minorité arabe (20 % de la population).
Un répit
Les électeurs juifs se réfugient dans un vote identitaire, déterminé par leur origine, leur religion, leur lieu de résidence (de Tel-Aviv la libérale à Jérusalem la religieuse) et leur position sur le conflit palestinien, toujours plus marquée à droite, notamment chez les jeunes. Le discours populiste de Netanyahou joue précisément de ces divisions en appelant le “second Israël” à prendre sa revanche sur l’“État profond” ; à savoir l’élite ashkénaze, laïque, citadine et libérale dans laquelle il omet de s’inclure. De son côté, la communauté arabe opère aussi des changements majeurs : moins abstentionniste, toujours identitaire mais de plus en plus sécularisée, elle vient d’envoyer 15 députés à la Knesset – un record. Ce qui rend insensée la formation d’un gouvernement “d’union nationale” sans un seul représentant arabe.
Alors que les Israéliens se sont sentis solidaires les uns des autres pendant l’épidémie du covid-19 qui les visait tous indistinctement, juifs comme arabes, le gouvernement né de cette crise ne prend pas la mesure de l’enjeu démocratique. Sans réforme du système électoral ni renouvellement des décideurs, il ne peut promettre rien d’autre qu’un répit avant la prochaine crise politique.
L’AUTEUR
Frédérique Schillo
Frédérique Schillo est historienne, spécialiste d’Israël et des relations internationales. Elle réside en Israël.
Elle est l’auteur de La politique française à l’égard d’Israël, 1946-1959 (André Versaille, 2012) et a coécrit avec Marius Schattner La Guerre du Kippour n’aura pas lieu
(André Versaille, 2013). Elle a contribué à Jérusalem (Bouquins/Robert Laffont, 2018) et Dans les archives secrètes du Quai d’Orsay (L’Iconoclaste, 2019).
Dernière mise à jour: 08/03/2024 12:43