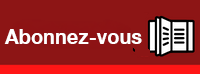Une rue anonyme du quartier de Zeitoun, non loin du centre historique de Gaza-ville, un dimanche matin. C’est calme. Derrière un haut mur d’enceinte et un solide portail, un bâtiment blanc, à l’architecture sobre et moderne. C’est l’église de la Sainte-Famille de Gaza. Le gardien est méfiant – tout le monde n’entre pas. Le portail s’ouvre brièvement pour une petite voiture – huit personnes en sortent.
Il est dix heures. La messe de la seule église catholique de l’enclave, assiégée par Israël depuis 2007, commence. À l’intérieur, les bancs sont clairsemés. Les chrétiens de Gaza, orthodoxes compris, sont un millier, et les latins, 134 – dont 14 religieux – alors que l’enclave compte deux millions d’habitants, à majorité musulmans. Une goutte d’eau dans le troisième territoire le plus densément peuplé au monde.
Lire aussi >> 70% des chrétiens de Gaza autorisés à sortir de l’enclave pour les fêtes
Les fumées d’encens épaississent l’atmosphère. Juste retour – il renvoie à l’Antiquité, quand la ville était le débouché des routes commerciales provenant d’Asie et d’Arabie.
Plutarque l’avait surnommée Aromatophora, la dispensatrice de parfums, et plus tard elle devint célèbre pour ses vins raffinés, très recherchés dans l’empire romain. À la fois port sur la Méditerranée et carrefour entre l’Égypte et la Palestine, l’Afrique et l’Asie, Gaza devint la charnière des empires et des nations, monnayant ou subissant, selon les revers de fortune, sa position privilégiée.
Avec les fumées d’encens les prières s’élèvent, accompagnées par la voix grave de l’organiste. Au premier rang, les servants de messe, dans leurs chemises immaculées et leurs robes écarlates, se dissipent, comme tous les enfants du monde. Ils se font reprendre en douceur par des religieuses, assises derrière eux. L’arabe cède la place au grec pour le Kyrie eleison, l’église se remplit encore, et la goutte d’eau semble se transformer alors en petite bulle de chrétienté, au milieu d’un territoire sous le contrôle de l’organisation islamiste Hamas depuis 2007, assiégé par Israël au même moment, victime de quatre guerres, qui ont causé la mort de 3 500 personnes.
La messe suit son cours, la prière eucharistique, la paix du Christ, le Notre Père, puis la communion. Les fidèles s’alignent dans l’allée centrale, sous le regard de saint Hilarion, l’un des plus grands moines de Gaza, disciple d’Antoine le Grand, premier ermite du territoire, et qui donna son nom au plus grand et plus ancien monastère de Palestine.
Un pasteur dévoué
La messe se conclut. Le père Gabriel Romanelli donne le programme de la semaine. Il est dense. La paroisse organise des activités pour petits et grands, hommes et femmes, cours de théologie, connaissance de la liturgie, mais aussi sport, musique… Cet activisme date de 2008, après la mise en place du siège. Les chefs religieux n’abandonnent pas leurs fidèles. Le patriarcat latin de Jérusalem envoie le père Jorge Hernandez, un prêtre dynamique originaire d’Argentine. Il est membre de l’institut du Verbe incarné, congrégation à la plus stricte orthodoxie. Il lance nombre d’initiatives, fonde une troupe scoute, pour la plus grande joie d’une communauté isolée et inquiète de son avenir. Depuis, la population chrétienne baisse moins vite. Et pourra, peut-être, se maintenir.
Le père Gabriel, visage rond et regard perçant par-dessus ses lunettes, est le dernier de cette lignée de prêtres entreprenants. Lui aussi Argentin, il vit au Moyen-Orient depuis 26 ans – il en a le double, 52, aujourd’hui. Il est arrivé à Gaza en 2019. “Je vis comme le reste de la communauté. Assiégé. Les fidèles ne peuvent même pas sortir pour aller à la messe de Noël. La dernière fois, c’était il y a deux ans”, dit-il. Mis à part la courte frontière au sud de la bande, côté égyptien, Israël contrôle tous les accès à Gaza, et accorde des permis au compte-gouttes, la plupart du temps pour des raisons de santé, ou pour une poignée de travailleurs. Soupape indispensable pour un territoire dont plus de la moitié de la population active est au chômage – l’un des taux les plus élevés au monde, à cause d’une situation économique complètement dégradée. “Ce n’est pas facile d’être minoritaire, encore moins à Gaza. Mais l’Église tient à rester ici. Nous avons des groupes Facebook, WhatsApp, pour rester en contact en permanence. Ni le coronavirus, ni la dernière guerre n’ont fait fermer la paroisse. Pendant la pandémie, nous organisions des leçons de théologie, de chant, mais aussi des prières, et même des lotos, le tout en ligne. Quant au dernier conflit, on appelait tout le monde quotidiennement. On apportait des choses à boire et à manger à ceux qui en avaient besoin. On a hébergé des familles dans la paroisse”, ajoute le père Gabriel.
Des vies liées aux conditions politiques
Récupérer de ces deux crises fut difficile. L’Église a organisé des séjours à la mer tous les dimanches. Les fidèles, dont certains ne s’étaient pas vus depuis de longs mois, ont pu renouer des liens. “C’est notre rôle ici : spirituel, mais aussi humain”, estime le père Gabriel.
La messe terminée, les fidèles sortent pour prendre un café sur le parvis. Le rituel est presque aussi important que celui de la liturgie. Parmi l’assemblée qui cligne des yeux sous le soleil, un homme, petites lunettes, cheveux courts, vient de revêtir la soutane. Il s’appelle Abdallah Jeldah, et c’est le premier séminariste originaire de Gaza depuis des décennies – peut-être depuis l’établissement de l’église latine ici au XIXe siècle, se plaît à imaginer le père Gabriel. “J’ai ressenti la vocation à 14 ans. Je l’ai dit à mes parents, et ils ne voulaient plus que j’aille à la messe ! Je suis l’aîné des garçons et j’étais censé me marier, travailler, avoir des enfants. Mais c’est ainsi. J’ai laissé le temps passer, et à 18 ans, je les ai convaincus”, raconte le jeune religieux de 23 ans. Dans un mois et demi, il quitte Gaza pour l’Italie. Pour toujours : “Je ne retournerai pas à Gaza. Un messager ne revient pas chez lui”, dit-il.
Une famille rentre chez elle – celle de Kamal Anton, 69 ans et les yeux bleu éclatant, qui vit à Tell el-Hawa, l’un des beaux quartiers de Gaza. Comme de nombreux Palestiniens, son histoire est celle d’un long exil. Ses parents sont originaires de Saint-Jean d’Acre. En 1948, lors de la Nakba, la “catastrophe”, ils fuient les combats de la première guerre israélo-arabe, comme 700 000 de leurs compatriotes, et se réfugient au Liban. Kamal y naît en 1952 et se marie 20 ans plus tard. En 1982, il part en famille au Yémen. Enfin en 1994, alors que la paix semble possible, le clan s’installe à Gaza – “Nous étions si heureux de revenir sur notre terre ! Même si les Israéliens avaient installé des check-points partout”. Il est à l’époque fonctionnaire de la toute jeune Autorité palestinienne. Mais tout dégénère très vite et la famille se retrouve prisonnière.
Et avec les musulmans ?
L’appartement est grand, rempli de vierges ornées de chapelets. Tout le monde est installé dans de profonds canapés bleus. C’est un moment où on prend le repas ensemble. Kamal et sa femme, Nahida, ont eu sept enfants. Seuls trois sont restés à Gaza. Les relations avec le Hamas sont cordiales. L’organisation islamiste laisse la liberté de culte aux chrétiens et envoie même des délégués pour les grandes fêtes religieuses.
Quant aux relations avec les musulmans, là encore, pas d’hostilité. “Nous partageons les mêmes problèmes : le blocus et la crise économique”, dit Hanna Mikhail, 50 ans, le gendre de Kamal. Son père est originaire de Haute-Égypte ; il en a gardé la peau sombre. Lors de la dernière guerre, en mai 2021, la famille chrétienne a hébergé ses voisins musulmans. “C’était plus rassurant d’être ensemble. Les explosions étaient terrifiantes, plus fortes que pendant le conflit précédent. On ne se sentait à l’abri nulle part”, se rappelle-t-il, faisant défiler les vidéos sur son téléphone. Dans l’une d’entre elles on voit une série de bombardements avancer comme un feu roulant, pendant que derrière tout le monde hurle. On se rassure bien vite en reprenant le thé. Ainsi passe le dimanche chez les Anton, entre l’évocation des souvenirs et les rêves d’évasion.
Retour à l’église. Son parvis est toujours aussi animé. Les scouts ont fini de répéter la fanfare. Ils jouent avec une bouteille d’eau. D’autres suivent des cours de liturgie dispensés par une religieuse, dans l’établissement. Derrière, les Sœurs de la Charité, la congrégation fondée par mère Teresa, s’occupent d’une trentaine d’enfants handicapés, dans des locaux immaculés et parfaitement équipés, une bulle de paix dans la bulle de chrétienté. Le soleil se couche. Le calme se répand dans la ville.
Soudain Abdallah, le jeune séminariste, surgit de nulle part et court après les enfants comme si leur vie était en danger. “Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous !” On s’inquiète un instant – une nouvelle guerre ? Un couvre-feu ? Non, plus important peut-être : “Plus vite ! Le classico, le classico !” Ce soir, le Real Madrid joue contre le FC Barcelone et la paroisse, qui ne connaît pas les coupures de courant, diffuse le match via un vidéoprojecteur. La salle résonne des encouragements des spectateurs. L’une des religieuses s’est même jointe discrètement à l’assemblée. Mais cette fois-ci, elle laisse les enfants se dissiper.