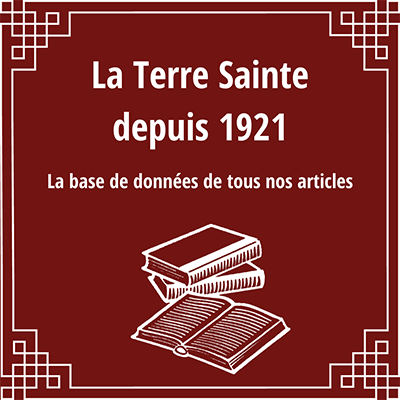P. John Paul: « Le défi du dialogue oecuménique, c’est d’arriver à l’unité dans la diversité »

L'Institut oeucuménique de Tantur fête ses 50 ans en 2022. L'occasion de revenir, avec son recteur, le père John Paul, sur les évolutions et les défis d'un centre qui fait de la rencontre et du dialogue oecuménique ses valeurs cardinales.
L’Institut œcuménique Tantur a été imaginé dans les années 1960, alors que la période de réflexion ouverte par le Concile Vatican II amène les Eglises à s’éloigner de l’exclusivité confessionnelle pour se tourner vers la rencontre et de dialogue. L’idée d’un lieu oeuvrant à la l’unité des Eglises par la rencontre fait alors son chemin dans l’esprit du pape Paul VI grâce à l’intermédiation d’observateurs orthodoxes, anglicans et protestants.
C’est après un passage en Terre Sainte, en 1964, et une rencontre avec le patriarche grec orthodoxe Athénagoras de Constantinople sur le mont des Oliviers, que Jérusalem apparaît comme la ville toute trouvée pour héberger un institut oecuménique commun. Le pape Paul VI confit le projet au père Ted Hesburgh, CSC, et à l’Université de Notre Dame. L’Institut lancera ses premiers programmes en 1972, ce qui fait de 2022 l’année du jubilé d’or de sa fondation.
Tantur est dirigé depuis 2020 par le père John Paul, jésuite originaire des Etats-Unis, dont la famille a émigré du Liban et de la Syrie avant sa naissance. Pour Terre Sainte Magazine, il revient sur l’essence de la mission de l’Institut et se livre sur sa vision de l’oecuménisme en Terre Sainte.

Célébration des 50 ans de Tantur, Plusieurs jours de travaux, rencontres et visites étaient au programme des célébrations des 50 ans de l’Institut œcuménique de Jérusalem connu sous le nom de Tantur. Ils se sont déroulés dans une atmosphère cordiale, laissant la place aussi à une prière commune. L’unité à Jérusalem continue de tracer son sillon.
TSM : L’Institut œcuménique de Tantur a été pensé comme un endroit où la réconciliation des Eglises se vivrait à travers la rencontre. Cinquante ans après sa création, comment cela se passe-t-il ?
P. John Paul : La rencontre a toujours fait partie de l’esprit de Tantur. C’est la manière ce concept a été mis en place qui a changé. Pendant les 15 premières années, les études théologiques, la recherche et le dialogue, surtout entre théologiens catholiques et protestants, était au coeur de la mission, dans le but de créer des ponts, d’étendre leur compréhension. La dynamique a changé ensuite parce que l’expérience était limitée aux chercheurs. L’Institut a donc pris un virage en concevant une série de programmes où des gens de différentes traditions religieuses pourraient se rencontrer, vivre ensemble en communauté, partager leurs expériences de foi…
« Vivre la rencontre » fait donc partie intégrante de nos programmes. Cela signifie faire l’expérience d’une personne ou d’une chose qui nous est totalement étrangère. Et plutôt que d’être sur la défensive par rapport à cette adversité, d’apprendre à l’approcher avec le désir de comprendre pourquoi l’autre croit ceci, vit cela, fait ainsi… C’est un échange mutuel. Les deux personnes sortent changées du processus, avec une plus grande compréhension du parcours de chacun.
Lire aussi >> L’institut oecuménique de Tantur a 40 ans
Nous rendons cela possible grâce à des programmes immersifs : des excursions, des cours sur la géographie biblique, sur les Ecrits, sur l’Islam, sur les racines juives du christianisme, sur les Eglises orientales… Nos participants sont immergés dans cette rencontre qui permet un renouveau des cœurs et des esprits. Ce qui est unique avec les programmes de Tantur, c’est que nos excursions ne sont pas du tourisme sur les lieux Saints. Ce sont de véritables pèlerinages spirituels : il ne s’agit pas seulement de cumuler des connaissances, mais de questionner ce qu’on lit et ce qu’on voit.

Quelle est la réalité de l’oecuménisme aujourd’hui en Terre Sainte ?
Les gens, ici, font la distinction entre l’oecuménisme, connoté négativement, et le dialogue oecuménique. Je commence à réaliser, après mes 2 ans et demi en tant que recteur, que les connexions personnelles avec les représentants des différentes Églises sont vraiment importantes dans la construction d’un dialogue. L’expérience oecuménique se vit à travers des moments de partage et de découverte des réalités, des prières de chacun. Les gens ont envie de partager leurs traditions. C’est là que la construction de ponts peut vraiment se faire, et que des relations profondes peuvent se nouer. Ce ne sont pas seulement des organisations catholiques qui cherchent à se rapprocher d’organisations luthériennes, ce sont des démarches individuelles qui aident à soutenir ce que Tantur cherche à construire.
L’oecuménisme est-il un concept occidental, qu’on cherche à appliquer à l’Orient, ou bien les Eglises orientales sont-elles aussi à l’initiative du dialogue ?
C’est une démarche qui va dans les deux sens. Quand, dans les années 1964, le pape Paul VI a rencontré le patriarche grec-orthodoxe Athénagoras à Jérusalem, ils venaient tous les deux de réaliser l’importance d’approfondir le dialogue, la compréhension, et donc la réconciliation. Je m’aperçois, ces dernières années, que les papes et les différents patriarches ont un désir mutuel de se rencontrer et de grandir ensemble.
Lire aussi >> Le pape à Jérusalem en juin avec le patriarche russe, une bonne idée ?
Je n’avais pas pensé, étant jeune, être témoin de la chute du mur de Berlin. Et pourtant c’est arrivé. Je relis ça à la situation ici, où il y a des résistances à la volonté grandissante de permettre que quelque chose advienne. Je ne pensais jamais être témoin de la réconciliation des Eglises orientales et occidentales. Et pourtant, je ne peux que constater que cela arrive.
Vous croyez en l’unité des Eglises ?
Oui, je crois que c’est possible, même si le chemin est long et difficile. Pour de nombreuses Eglises, l’oecuménisme implique, à tort, un certain « égalitarisme » dans la théologie, dans les pratiques, ou la spiritualité, au mépris des différences fondamentales. Le dialogue oecuménique, à l’inverse, se focalise sur les choses en commun, tout en embrassant les différences et les points sur lesquels le rapprochement est possible pour créer une plus grande compréhension mutuelle. Il y a eu des documents, par exemple à propos de l’acceptation du baptême chez les anglicans, luthériens et catholiques. Le défi du dialogue oecuménique, c’est d’arriver à voir l’unité dans la diversté. De comprendre et apprécier le fait que malgré la diversité, il peut y avoir quelque chose en commun.

Comment se passe la rencontre et le dialogue avec les autres religions ?
Les deux font partie intégrante des programmes proposés à Tantur. On va faire appel à des gens issus d’autres religions pour parler de leurs expériences et traditions. Ce qui me frappe toujours, c’est la manière dont les questions, posées d’un côté et de l’autre, aident à la connaissance mutuelle. Ce n’est pas toujours un dialogue direct en tant que tel, mais plutôt une démarche : comment je me mets à l’écoute de l’autre. Tantur a aussi cette image d’un oasis d’hospitalité. On fait le choix de ne pas prendre parti, d’être un terrain neutre qui accueille tout le monde.
Quels sont vos objectifs pour les années à venir ?
Je voudrais que la richesse de nos programmes soit accessible à plus de gens. Qu’on renoue avec la culture de l’oecuménisme, en touchant plus de traditions religieuses à travers le monde. J’aimerai aussi que l’on bâtisse des formations pour les évêques de différentes Églises, qu’ils puissent approcher les dynamiques de l’expérience partagée. Nous offrons quelque chose d’unique, de vraiment différent : la possibilité d’étudier directement sur le terrain. J’aimerai enfin ouvrir les programmes, les formations, les lieux, aux chrétiens locaux, et surtout à la jeunesse.
Lire aussi >> Rafi Ghattas : “Les jeunes sont le présent de cette terre. Pas son futur”
J’ai l’espoir que Tantur devienne un espace d’accueil et de ressources spirituelle pour eux. Beaucoup n’ont pas reçu d’éducation religieuse autre que de maigres cours de catéchisme. Certains ne connaissent pas les lieux saints. Le christianisme est né ici. Il faut nourrir les pierres vivantes de cette terre. Ils sont en demande d’une éducation historique et spirituelle. Je suis persuadé que Tantur peut être une ressource, un environnement hospitalier, sûr et accueillant pour les personnes qui veulent apprendre à grandir. ♦
Dernière mise à jour: 22/04/2024 16:54