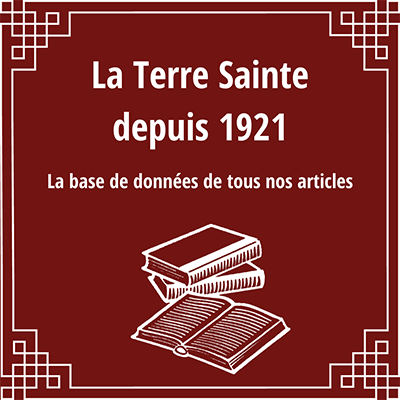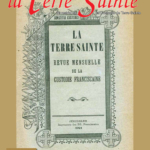Antioche aux origines de l’Eglise melkite catholique,
Avec la conquête ottomane (1516-1918) tout l’Orient dépendait d’une seule autorité, celle du sultan lequel fit de Constantinople non seulement la capitale politique d’un immense empire, mais aussi la capitale religieuse de l’Orient, comme Rome l’était pour l’Occident. Le patriarche œcuménique fut appelé à exercer une autorité sur les hiérarques melkites. Leur confirmation et parfois leur élection dépendaient désormais du Phanar. La hiérarchie d’Alexandrie et de Jérusalem s’hellénisa complètement, tous leurs sièges épiscopaux furent attribués à des Grecs. L’Hellénisme n’eut pas de prise sur Antioche dont les patriarches étaient choisis dans le clergé indigène ; ils conservèrent pour la plupart des liens avec Rome.
Après l’échec d’une tentative d’union avec Rome, des missionnaires (Jésuites, Capucins, Carmes, Franciscains) se mirent au service de la hiérarchie locale et coopérèrent avec elle. Des pasteurs qui n’étaient pas en communion formelle avec Rome encourageaient leurs ouailles à s’adresser aux missionnaires. Le peuple sentait la nécessité d’une intelligence plus profonde de la foi traditionnelle qu’il vivait malgré mille ans de répression. Il aspirait à la trouver auprès de religieux plus instruits que son clergé. Des deux côtés, on était assuré de participer à une même foi. Cependant, une fraction attirée par le renom de la culture occidentale et sa civilisation prit en bloc ce que la latinité lui apportait. C’est ainsi qu’après quelques décennies l’on vit apparaître une nouvelle manière de concevoir la foi traditionnelle. Le comportement de ces nouveaux « catholiques » fut considéré comme une trahison et une mutation de la foi ancestrale par une fraction attachée à son passé. Ainsi la communion dans la foi avec la catholicité qui n’avait cessé de fleurir dans le patriarcat d’Antioche fut mise en question et deux manières de la concevoir firent leur apparition. L’identité antiochienne se perdit. Une fraction de ses fidèles pencha vers Byzance et devint plus constantinopolitaine qu’antiochienne, et l’autre vers Rome avec une forme de relation plus romaine que fidèle à la foi de l’Église locale. De sorte qu’à la mort du patriarche Athanase en 1724, une double lignée de patriarches fut instaurée, l’une orthodoxe et l’autre catholique. Elles durent jusqu’à nos jours.
Date fatidique que celle de 1724, deux hiérarchies parallèles, deux communautés sœurs qui se déchirent sous l’œil bienveillant des Turcs, qui accordent le siège patriarcal et les évêchés aux plus offrants. Les martyrs et les confesseurs ne manquèrent ni à l’une ni à l’autre. Deux routes divergentes et deux destinées conduisaient désormais les deux Églises, la catholique et l’orthodoxe.
L’Église Grecque-Melkite-Catholique s’organisa. De nouveaux Ordres monastiques furent fondés, un clergé éduqué à Rome dispensait l’enseignement dans des écoles nouvellement fondées. Un séminaire fut ouvert. Malgré une crise de croissance l’Église melkite trouva son équilibre, des conciles locaux la dotèrent d’une organisation solide et, ainsi, elle s’étendit et se développa. Au XlXe siècle, elle eut deux grands patriarches : Maximos Mazloum (1833-1855) et Grégoire Joseph (1864-1897).
Mgr Mazloum perfectionna la législation canonique de son Église. Il étendit sa sollicitude au patriarcat d’Alexandrie, car fuyant les persécutions des orthodoxes, des catholiques de Syrie et du Liban avaient émigré en Égypte. Mazloum leur sacra un évêque, leur envoya des prêtres et dota les nouvelles paroisses d’églises et de fondations charitables. Il fit de même pour le patriarcat de Jérusalem. Mais Mazloum est surtout connu pour avoir été l’artisan de la reconnaissance par le sultan de l’indépendance complète de son Église, tant au point de vue civil qu’au point de vue ecclésiastique (1848).
Durant 33 ans, Mgr Grégoire Joseph, mesurant ses actions à leurs conséquences possibles sur l’œuvre capitale de l’union des Églises, travailla à réaliser un vaste plan de restauration de son Église dans le sens de la pure tradition orientale. n
Extrait de Mgr Joseph Nasrallah, Histoire de l’Église Melkite des origines à nos jours
Dernière mise à jour: 21/11/2023 11:44