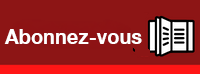Dix ans après son premier voyage, Katia Chapoutier est retournée dans la ville trois fois sainte. Des retrouvailles que la journaliste chronique d'une plume candide et rieuse sans être simpliste, dans son dernier ouvrage, "Toujours Lost in Jérusalem".
Katia Chapoutier est journaliste et réalisatrice de documentaires. Elle collabore régulièrement avec France Télévisions, Arte et TF1. Elle a publié Lost in Jérusalem en 2013, dans la foulée d’une série de déplacements dans la ville sainte. L’ouvrage est mis à jour avec le récit de son retour, 10 ans plus tard, au format poche et sera disponible à partir du 9 juin 2022 : Toujours Lost in Jerusalem (Editions Le Passeur).
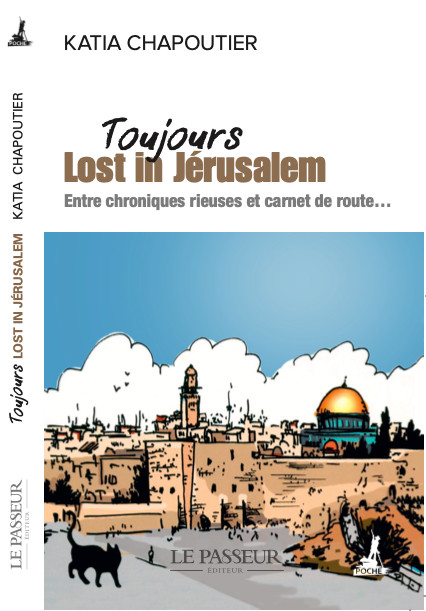
Dix ans séparent vos deux visites à Jérusalem. Avez-vous trouvé la ville changée ?
Oui, mais cela tient en partie au fait que j’y suis retournée en période de crise sanitaire. Jérusalem était vide, je n’avais jamais vu ça. Ça m’a permis de mieux apprécier certains lieux. Le Saint-Sépulcre par exemple, qui m’avait laissé cette impression de Gare de l’Est à heure de pointe. J’ai découvert un lieu à la fois touchant et intéressant. Au-delà de ça, j’ai été frappée par la progression des colons juifs en vieille ville, qui s’installent de plus en plus profondément dans des quartiers qui ne sont pas les leurs. Ils sont plus présents, plus démonstratifs. À l’inverse, on sent bien que les Palestiniens, qu’ils soient chrétiens ou musulmans perdent du terrain. Le cloisonnement entre les communautés est très palpable.
On découvre Jérusalem et la Terre Sainte à travers vos yeux, et on sent un certain émerveillement. Qu’est ce qui vous fascine autant dans cette ville ?
Le fait qu’on soit bousculé par chaque rencontre. Dans mes échanges avec les habitants de la ville, il y a rarement de « small talk », de discussions superficielles. La question : « Qu’est ce que tu fais ici, qu’est ce que tu viens chercher ? » finit toujours par arriver. L’intimité est vite très forte, que ce soit du point de vue spirituel ou humain. Les conversations sont profondes, elles ont du sens. Il y a quelque chose que j’aime beaucoup faire là-bas, c’est m’installer à un endroit, et observer le mouvement autour. Je peux rester des heures comme ça. L’absurde est toujours au coin de la rue à Jérusalem. À chaque fois que j’y suis, c’est comme si le destin me faisait des clins d’œils… Cela ne m’est arrivé dans aucun autre pays, et pourtant j’ai eu la chance de beaucoup voyager pour réaliser mes films. C’est quand même fou que la première personne que j’entende parler français à mon retour, soit la dernière personne que j’ai vue, il y a dix ans. Comme si la boucle était bouclée…
Et à l’inverse, y a-t-il des choses qui vous déplaisent ?
Jérusalem, c’est un rapport amour/haine. Je déteste ces murs qui se dressent entre les gens à cause des religions. Même si on essaie d’être ouvert d’esprit, curieux et avenant, on se heurte à d’immenses plexiglas qui rendent certaines communautés inaccessibles. Je me souviens avoir croisé deux jeunes filles de la communauté juive ultra-orthodoxe et de leur avoir fait un grand sourire. Elles ont détourné la tête. C’est le paradoxe de cette ville monde, où chacun vit entouré de ses murs.
La deuxième version de votre livre s’intitule : « Toujours lost in Jérusalem ». Même après plusieurs visites, il reste difficile de prétendre connaître cette ville ?
Oui, et c’est ce qui rend cette ville si attractive ! Plus on creuse, moins on peut prétendre connaître Jérusalem. Parce que plus on avance, plus on comprend les mille subtilités qui rendent chaque communauté, chaque situation, chaque lieu, uniques. Et puis, je n’ai aucun sens de l’orientation. Je me perds tout le temps dans la vieille ville, et je continuerai toujours même si je mettais des petits cailloux sur mon chemin (rires).
Comment avez-vous écrit ces chroniques ? À chaud lors de vos séjours, ou bien à tête reposée une fois de retour en France ?
J’ai écrit le soir. J’avais tellement de choses en tête en rentrant à l’hôtel que je jettais tout sur le papier, en restant au plus près de mes émotions, sans trop rationaliser. Je voulais garder un regard candide. Je racontais aussi ce que je vivais à ma mère. Elle avait le droit à tous les détails et à toutes les fautes d’orthographe (rires). J’ai repris les textes ultérieurement, pour lisser. Mais je tiens à ce que mon écriture reste celle du cœur. Je n’ai pas de bagage en sciences politiques, alors je raconte ce que j’apprends au fil de l’eau et à l’occasion de mes tournages. Appréhender la réalité par le ressenti est un choix. C’est intéressant, aussi, pour une destination aussi abstraite que Jérusalem. Ça aide à la comprendre, de manière bienveillante.
Le livre termine sur l’annonce de votre voyage à Tel Aviv, dans le cadre d’un tournage. Déplacement que vous avez depuis réalisé. Tel-Aviv, Jérusalem, deux salles, deux ambiances ?
À Tel-Aviv, j’ai eu l’impression d’être dans un autre pays. En plus c’était la fête juive de Pourim. Le décalage est vertigineux. On était logé à côté du marché. La nuit, c’était une boîte de nuit géante ! On m’a beaucoup demandé : « Alors, tu as testé ce bar ? Et cette boîte de nuit ? » À Jérusalem, on ne te demande jamais si tu as bien fait la fête. Ici, c’est omniprésent. J’ai beaucoup navigué dans la communauté juive de gauche, j’ai vu des gens libres, avec le contact facile. J’ai aimé Tel-Aviv, mais je ne m’y suis pas autant sentie chez moi qu’à Jérusalem. C’est peut-être bizarre dit comme ça, mais je me sens à ma place à Jérusalem. En y revenant, 10 ans après, j’ai eu la sensation de retrouver un amour de jeunesse. Alors clairement, je n’attendrai pas une nouvelle décennie pour y retourner !